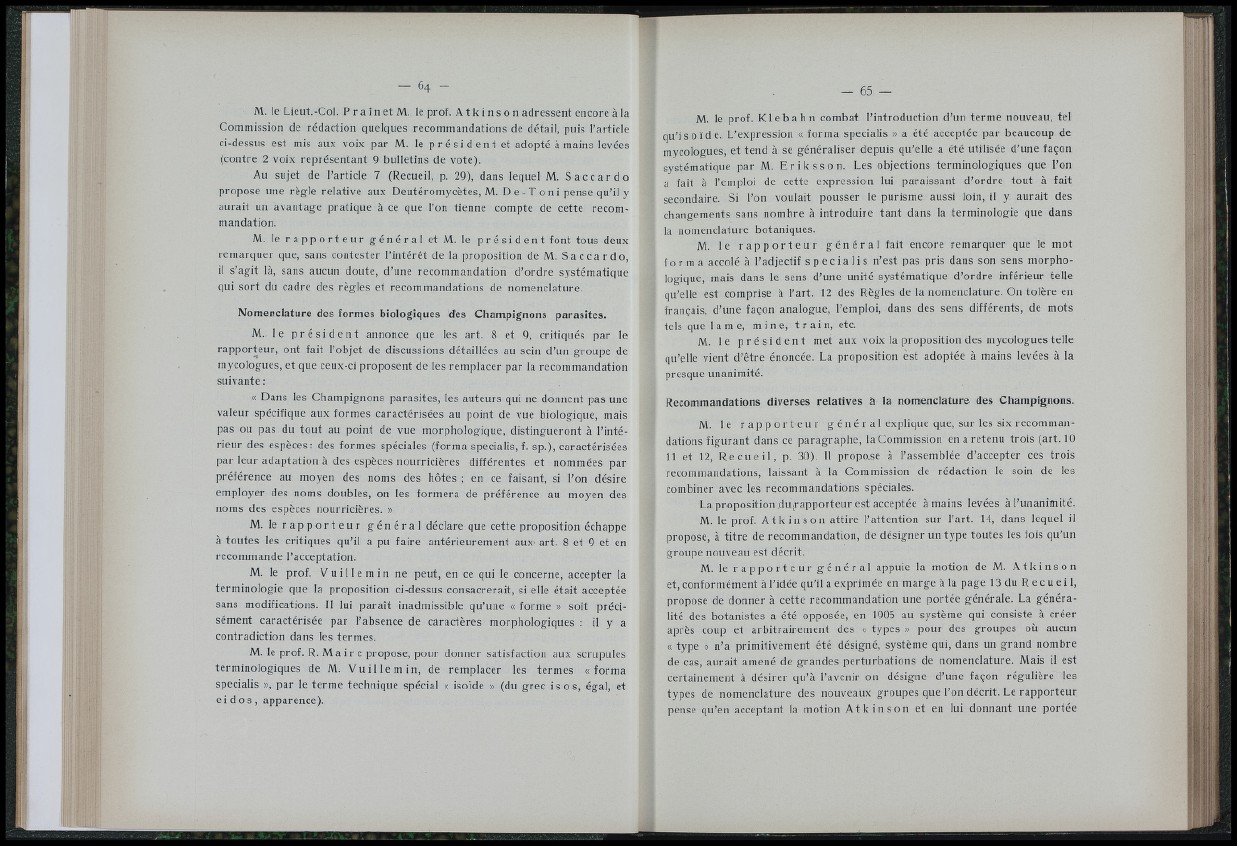
M. le Lieut.-Col. P r a î n et M. le prof. A t k i n s o n adres sent encore à la
Commission de rédaction quelques recommanda t ions de détail, puis l’article
ci-dessus est mis aux voix par M. le p r é s i d e n t et adopté à mains levées
(contre 2 voix repré s entant 9 bulletins de vote).
Au sujet de l’article 7 (Recueil, p. 29), dans lequel M. S a c c a r d o
propose une règle rela tive aux Deutéromycètes , M. De - T o n i pense qu’il y
aurai t un avantage prat ique à ce que l’on t ienne compte de cette r e commandation.
M. le r a p p o r t e u r g é n é r a l et M. le p r é s i d e n t font tous deux
rema rque r que, sans contester l’intérêt de la propos ition de M. S a c c a r d o ,
il s’agit là, sans aucun doute, d’une re commanda t ion d’ordre sys témat ique
qui sor t du cadre des règles et re commanda t ions de nomenclature.
Nomenclature dés formes biologiques dés Champignons parasites.
M. le p r é s i d e n t annonce que les art. 8 et 9, critiqués par le
rappor teur , ont fait l’objet de discussions détaillées au sein d’un groupe de
mycologues, et que ceux-ci proposent de les remplacer par la recommanda t ion
suivante :
« Dans les Champignons parasi tes, les auteurs qui ne donnent pas une
valeur spécifique aux formes caractér isées au point de vue biologique, mais
pas ou pas du tout au point de vue morphologique, di s t ingueront à l’intér
ieur des espèces: des formes spéciales ( forma specialis, f. sp.), caractér isées
par leur adapta t ion à des espèces nour r icières dif férentes et nommées par
préférence au moyen des noms des hôtes ; en ce faisant, si l’on désire
employer des noms double s, on les fo rme r a de préférence au moyen des
noms des espèces nour ric ières. »
M. le r a p p o r t e u r g é n é r a l déclare que cette proposi t ion échappe
à toute s les critiques q u ’il a pu faire ant é r ieurement aux> art. 8 et 9 et en
recommande l’acceptation.
M. le prof. V u i l l e m i n ne peut , en ce qui le concerne, accepter la
terminologie que la proposition ci-dessus consacrerait, si elle était acceptée
sans modifications. II lui p a ra î t inadmissible qu’une « forme » soit préci s
ément caractér isée par l’absence de caractères morphologiques : il y a
cont radict ion dans les termes.
M. le prof. R. M a i r e propose, po u r donner satisfaction aux scrupules
terminologiques de M. V u i l l e m i n , de remplacer les te rme s « f o rma
specialis », par le te rme technique spécial « isoïde » (du grec i s o s , égal, et
e i d 0 s , apparence) .
M. le prof. K l e b a h n combat l’int roduct ion d’un te rme nouveau, tel
qu’i s o ï d e . L’express ion « forma specialis » a été acceptée par beaucoup de
mycologues, et tend à se général iser depuis qu’elle a été utilisée d ’une façon
systématique par M. E r i k s s o n . Les objections terminologiques que l’on
a fait à l’emploi de cette expres s ion lui parai ssant d’ordre tout à fait
secondaire. Si l’on voula it pousser le pur isme aussi loin, il y aurai t des
changements sans nombre à int rodui re t a n t dans la terminologie que dans
la nomenclature botaniques.
M. le r a p p o r t e u r g é n é r a l fait encore r ema rque r que le mot
f o r m a accolé à l’adjecti f s p e c i a l i s n’est pas pris dans son sens mo rp h o logique,
mais dans le sens d’une unité sys témat ique d ’o rd r e inférieur telle
qu’elle est comprise à l’art. 12 des Règles de la nomenclature. On tolère en
français, d’une façon analogue, l’emploi, dans des sens différents, de mots
tels que l ame , mi n e , t r a i n , etc.
M. l e p r é s i d e n t met aux voix la proposi t ion des mycologues telle
qu’çlle vient d’êt re énoncée. La propos i t ion est adoptée à mains levées à la
presque unanimité.
Recommandations diverses relatives à la nomenclature des Champignons.
M. l e r a p p o r t e u r g é n é r a 1 explique que, sur les six r e c omma n dations
f igurant dans ce pa ragraphe , la Commission en a retenu trois (art. 10
11 et 12, R e c u e i l , p. 30). Il propo.se à l’assemblée d ’accepter ces trois
recommandat ions, laissant à la Commis sion de rédact ion le soin de les
combiner avec les recommandat ions spéciales.
La p roposi t ion d u ^ a p p o r t e u r est acceptée à main s levées à l’unanimité.
M. le prof. A t k i n s o n at t i re l’at tent ion sur l’art. 14, dans lequel il
propose, à t i t re de recommandat ion, de désigner un type toutes les fois qu’un
groupe nouveau est décrit.
M. le r a p p o r t e u r g é n é r a l appuie la mot ion de M. A t k i n s o n
et, conformément à l’idée qu ’il a expr imée en ma rge à la page 13 du R e c u e i 1,
propose de donner à cette re commanda t ion une por tée générale. La g é n é r a lité
des botanis tes a été opposée, en 1905 au système qui consiste à créer
après coup et a rb i t ra i rement des « types » pour des groupes où aucun
« type » n’a pr imi t ivement été désigné, système qui, dans un g r an d nombre
de cas, aurai t amené de grande s p e r turba t ions de nomenclature. Mais il est
cer tainement à désirer qu’à l’avenir on désigne d ’une façon régul ière les
types de nomenclature des nouveaux groupes que l’on décrit. Le rap p o r te u r
pense qu’en acceptant la mot ion A t k i n s o n et en lui donnant une por tée
I" r