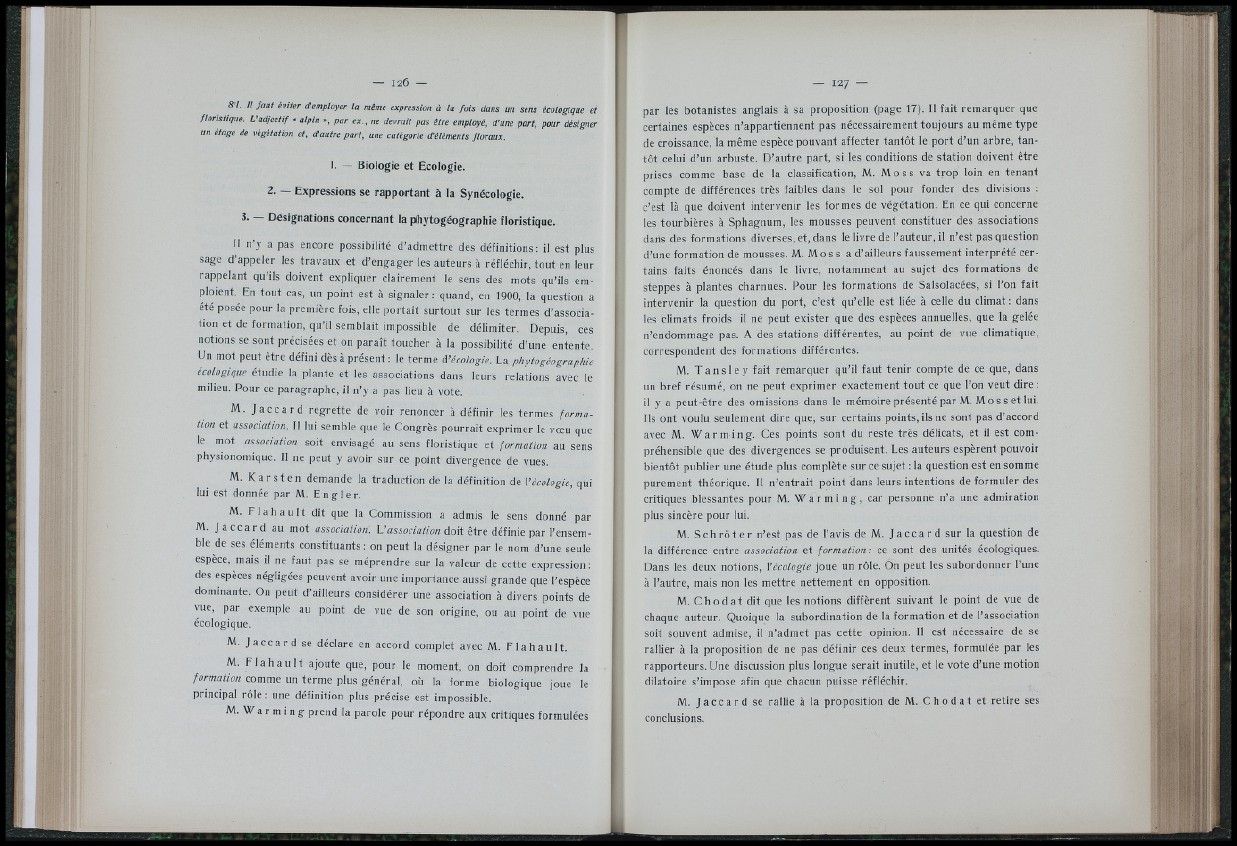
8’1. Il faut éviter d'employer la même expression à la fois dans un sens écologique et
floristique. L’adjectif ^ alpin », par ex., ne devrait pas être employé, d ’une part, pour désigner
un étage de végétation et, d’autre part, une catégorie d'éléments floraux.
I. Biologie et Écologie.
2. — Expressions se rapportant à la Synécologie.
3. — Désignations concernant la pihytogéographie floristique.
Il n’y a pas encore possibilité d’adme t t r e des définitions: il est plus
sage d’appeler les t r av a u x et d’e n g a g e r les auteur s à réfléchir, tout en leur
rappelant qu’ils doivent expliquer clai rement le sens des mots qu ’ils emploient.
En tout cas, un point est à s ignaler : quand, en 1900, la question a
été posée pour la première fois, elle por ta i t sur tout sur les te rmes d ’as sociation
et de format ion, q u ’il semblai t impossible de délimiter. Depuis, ces
notions se sont précisées et on p a ra î t toucher à la possibilité d ’une entente.
Un mot peut êt re défini dès à prés ent : le t e rme d ’écologie. La phytogéographie
écologique étudie la plante et les associat ions dans leurs relat ions avec le
milieu. Pour ce pa ragraphe , il n’y a pas lieu à vote.
M. J a c c a r d re g r e t te de voir renoncer à définir les te rme s fo rm a tion
et association. Il lui semble que le Congrès pour ra i t expr imer le voeu que
le mot association soit envisagé au sens floristique et formation au sens
physionomique. Il ne peut y avoir sur ce poin t divergence de vues.
M. K a r s t e n demande la t raduc t ion de la définition de \’écologie, qui
lui est donnée par M. E n g l e r .
M. F l a h a u l t dit que la Commission a admis le sens donné par
M. J a c c a r d au mot association. V association doit êt re définie par l’ens emble
de ses éléments const i tuants : on peut la désigner par le nom d ’une seule
espèce, mais il ne faut pas se mé prendre sur la valeur de cette expres s ion:
des espèces négligées peuvent avoir une impor tance aussi g r ande que l’espèce
dominante. On peut d’ailleurs cons idérer une associa tion à divers points de
vue, par exemple au poin t de vue de son origine, ou au poin t de vue
écologique.
M. J a c c a r d se déclare en accord complet avec M. F l a h a u l t .
M. F l a h a u l t ajoute que, pour le moment , on doit comprendre la
formaüon comme un te rme plus général , où la forme bio logique joue le
principal rôle : une définition plus précise est impossible.
M. W a r m i n g prend la parole pour répondre aux critiques formulées
par les botanis tes anglais à sa propos i t ion (page 17). Il fait rema rq u e r que
certaines espèces n’appar t iennent pas nécessai rement toujour s au même type
de croissance, la même espèce pouvant affecter t a n tô t le p or t d’un arbre, t a n tôt
celui d’un arbus te. D’aut re par t , si les conditions de stat ion doivent êt re
prises comme base de la classification, M. M o s s va t ro p loin en tenant
compte de différences t rè s faibles dans le sol pour fonder des divisions :
c’est là que doivent interveni r les forme s de végétation. En ce qui concerne
les tourbiè re s à Sphagnum, les mous ses peuvent cons t i tuer des associations
dans des format ions diverses, et, dans le livre de l’auteur , il n’est pas question
d’une format ion de mousses. M. M o s s a d’ailleurs faus sement inte rpré té c e r tains
fait s énoncés dans le livre, n o tammen t au sujet des format ions de
steppes à plantes charnues. Pour les format ions de Salsolacées, si l’on fait
intervenir la question du por t, c’est qu’elle est liée à celle du climat : dans
les climats froid s il ne peut exister que des espèces annuelles, que la gelée
n’endommage pas. A des stat ions dif férentes, au point de vue climatique,
cor respondent des format ions dif férentes.
M. T a n s l e y fait r ema rq u e r q u ’il faut teni r compte de ce que, dans
un bref résumé, on ne peut expr imer exac tement tout ce que l’on veut dire :
il y a peut -ê t re des omissions dans le mémoi re pré s enté par M. M o s s et lui.
Ils ont voulu seulement dire que, sur certains points, ils ne sont pas d ’accord
avec M. W a r m i n g . Ces points sont du res te t rès délicats, et il est compréhensib
le que des divergences se produisent . Les auteur s espèrent pouvoir
bientôt publ ier une étude plus complète sur ce sujet : la question es t en somme
purement théor ique. Il n’ent ra i t point dans leurs intentions de formuler des
critiques ble ssantes pour M. W a r m i n g , car personne n’a une admi rat ion
plus sincère pour lui.
M. S c h rô t e r n’est pas de l’avis de M. J a c c a r d sur la quest ion de
la différence ent re association et formation : ce sont des unités écologiques.
Dans les deux notions, [’écologie joue un rôle. On peut les subordonne r l’une
à l’aut re, mais non les me t t r e n e t teme n t en opposit ion.
M. C h o d a t dit que les not ions dif fèrent suivant le point de vue de
chaque auteur . Quoique la subordina t ion de la format ion et de l’associa tion
soit souvent admise, il n ’adme t pas cet te opinion. II est nécessaire de se
rallier à la proposi t ion de ne pas définir ces deux te rmes , formulée par les
rappor teurs. Une discussion plus longue serait inutile, et le vote d’une mot ion
dilatoire s’impose afin que chacun puisse réfléchir.
M. J a c c a r d se rallie à la propos i t ion de M. C h o d a t et ret i re ses
conclusions.
■