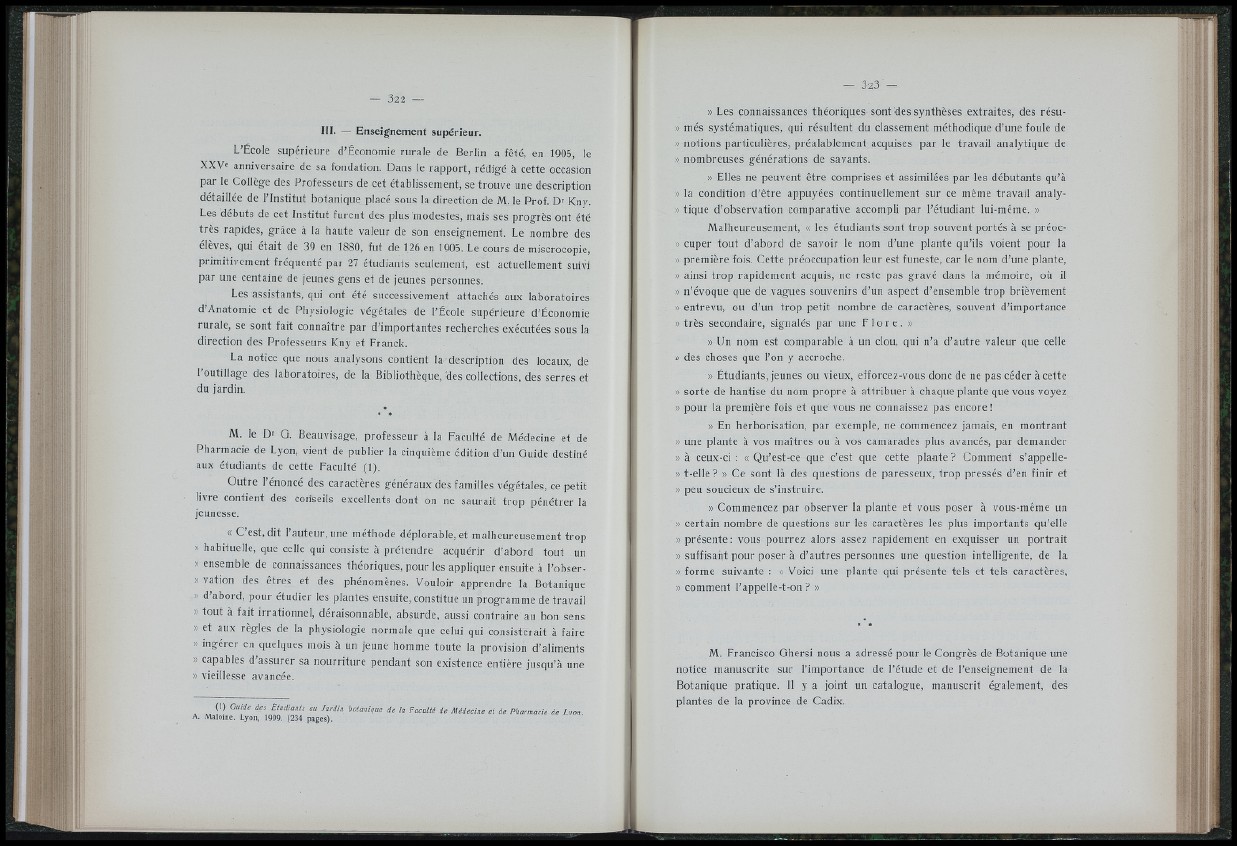
III. — Enseiginement supérieur.
L’Lcole supér ieure d’Économie rurale de Berlin a fêté, en 1905, le
anniversaire de sa fondation. Dans le rappor t , rédigé à cette occasion
par le Collège des Profes seurs de cet établissement, se t rouve une description
détaillée de ITnsti tut botanique placé sous la direction de M. le Prof. Dr Kny.
Les débuts de cet Ins t i tut furent des plus modestes, mais ses progrè s ont été
t rè s rapides, grâce à la haute valeur de son enseignement . Le nombre des
élèves, qui était de 39 en 1880, fut de 126 en 1905. Le cours de miscrocopie,
pr imi t ivement f réquenté par 27 étudiants seulement, est actuel lement suivi
par une centaine de jeunes gens et de jeunes personnes.
Les assis tants, qui ont été successivement at tachés aux laboratoi res
d’Anatomie et de Physiologie végétales de l’Lcole supér ieure d’Lconomie
rurale , se sont fait connaî t re par d’impor tante s recherches exécutées sous la
direction des Profes seurs Kny et Lranck.
La notice que nous analysons cont ient la descr ipt ion des locaux, de
1 outi llage des laboratoires, de la Bibliothèque, des collections, des ser res et
du jardin.
M. le Dr G. Beauvisage, profes seur à la Laculté de Médecine et de
Pharmacie de Lyon, vient de publier la cinquième édition d’un Guide destiné
aux étudiants de cette Laculté (1).
Out re l’énoncé des caractères gén é ra u x des familles végétales, ce petit
livre cont ient des conseils excellents dont on ne saurai t t rop péné t re r la
jeunesse.
« C’est, dit l’auteur , une mé thode déplorable, et ma lheureus ement t rop
» habituelle, que celle qui consiste à pré tendre acquér i r d ’abord tout un
» ensemble de connaissances théor iques, pour les appl iquer ensuite à l’obser -
» vat ion des êt res et des phénomènes . Vouloir apprendre la Botanique
» d’abord, pour étudier les plantes ensuite, constitue un p ro g r amme de travai l
» to u t à fait ir rationnel, déraisonnable, absurde, aussi cont rai re au bon sens
» et aux règle s de la physio logie normale que celui qui consisterait à faire
» ingérer en quelques mois à un jeune homme toute la provision d’aliments
» capables d’a s surer sa nour r i ture pendant son existence ent ière jusqu’à une
» vieillesse avancée.
(1 ) Guide des É tu d ia n ts au Jardin botanique de la F a cu lté de Méd ec in e et de Pharmacie de Lvon
A. M a lo i n e . L y o n , 1909. (2 3 4 p a g e s ) .
» Les connaissances théor iques sont des synthèses ext rai tes, des résu-
» més systémat iques, qui résul tent du classement méthodique d’une foule de
» notions particulières, préalablement acquises par le t ravai l analytique de
» nombreuses généra t ions de savants.
» Llles ne peuvent êt re comprises et assimilées pa r les débutant s qu’à
» la condition d’êt re appuyées cont inuellement sur ce même t ravai l analy-
» tique d’observat ion comparat ive accompli par l’étudiant lui-même. »
Malheureusement , « les étudiants sont t rop souvent por tés à se préoc-
» cuper to u t d’abord de savoir le nom d’une plante qu’ils voient pour la
» première fois. Cet te préoccupat ion leur est funeste, car le nom d’une plante,
» ainsi t ro p rapidement acquis, ne res te pas gravé dans la mémoire, où il
» n’évoque que de vagues souvenirs d’un aspect d’ensemble t rop br ièvement
» ent revu, ou d’un t rop pet it nombre de caractè res, souvent d’impor tance
» t r è s secondaire, signalés par une F l o r e . »
» Un nom est comparable à un clou, qui n’a d ’aut re valeur que celle
» des choses que l’on y accroche.
» Etudiants, jeunes ou vieux, efforcez-vous donc de ne pas céder à cette
» sor te de hant ise du nom propre à a t t r ibue r à chaque plante que vous voyez
» pour la première fois et que vous ne connaissez pas encore !
» En herbor isat ion, par exemple, ne commencez jamais , en mont rant
» une plante à vos ma î t re s ou à vos camarades plus avancés, par demander
» à ceux-ci : « Qu ’est-ce que c’est que cette plante ? Comment s’appelle-
» t-elle ? » Ce sont là des questions de pares seux, t ro p pressés d’en finir et
» peu soucieux de s’in strui re.
» Commencez pa r observer la plante et vous poser à vous -même un
» cer tain nombre de questions sur les caractères les plus impor tant s q u ’elle
» présente ; vous pour re z alors assez rapidement en exquisser un p o r t ra i t
» suffisant pour poser à d’aut res personnes une question intelligente, de la
» forme suivante : « Voici une plante qui présente tels et tels caractères,
» comment l’appelle -t-on ? »
M. Francisco Ghersi nous a adres sé pour le Congrès de Botanique une
notice manuscr i te sur l’impor tance de l’étude et de l’enseignement de la
Botanique prat ique. Il y a joint un catalogue, manuscr i t également, des
plantes de la province de Cadix.