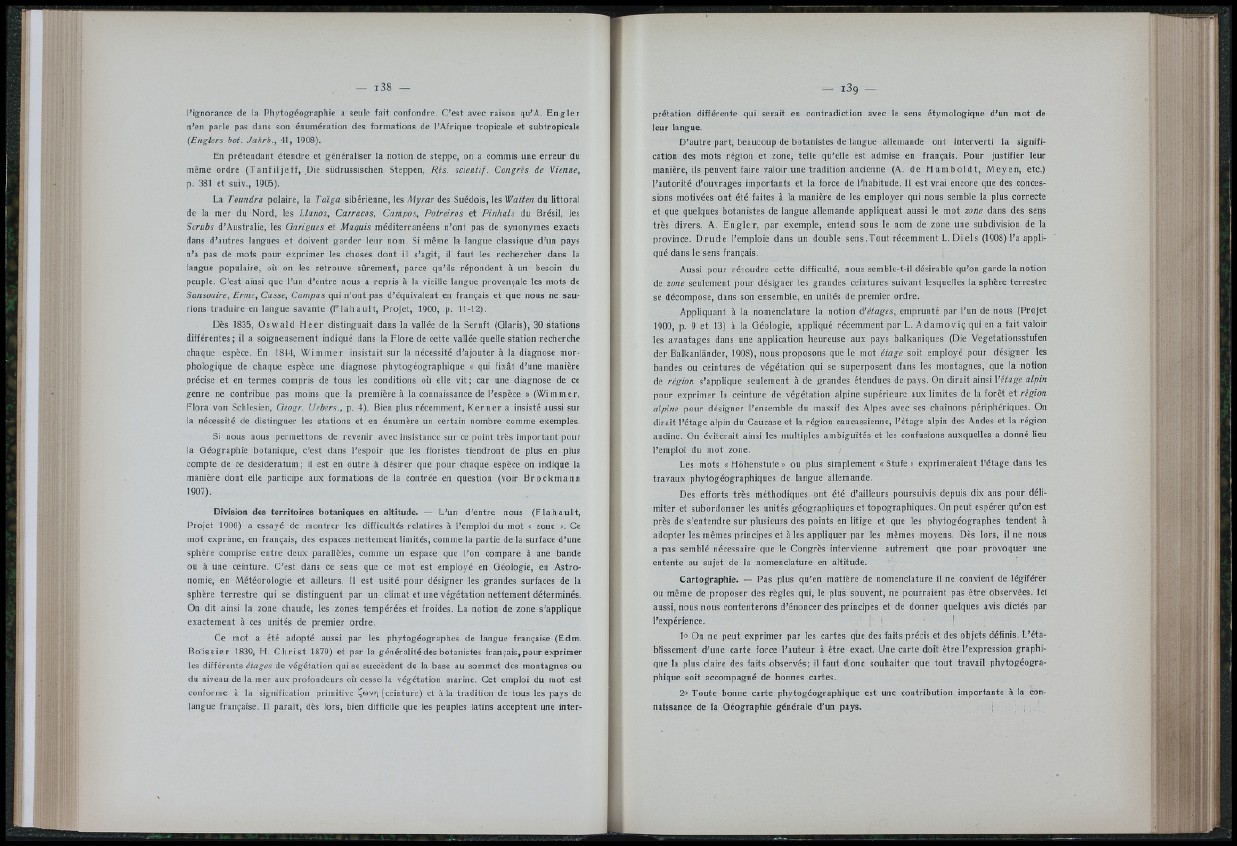
l’ignorance de la Phytogéographie a seule fait confondre. C'est avec raison qu’A. E n g l e r
n’en parle pas dans son énumération des formations de l’Afrique tropicale et subtropicale
{Englers hot. Jahrb., 41, 1908).
En prétendant étendre et généraliser la notion de steppe, on a commis une erreur du
même ordre (T a n f i l j e f f , .Die südrussischen Steppen, Rés. scientif. Congrès de Vienne,
p. 381 et suiv., 1905).
La Toundra polaire, la Taïga sibérienne, les Myrar des Suédois, les Watten du littoral
de la mer du Nord, les Llanos, Carracos, Campos, Potreiros et Pinhals du Brésil, les
Scrubs d’Australie, les Carigues et Maquis méditerranéens n’ont pas de synonymes exacts
dans d’autres langues et doivent garder leur nom. Si même la langue classique d’un pays
n’a pas de mots pour exprimer les choses dont il s ’agit, il faut les rechercher dans la
langue populaire, où on les retrouve sûrement, parce qu’ils répondent à un besoin du
peuple. C’est ainsi que l’un d’entre nous a repris à la vieille langue provençale les mots de
Sansouire, Erme, Casse, Campas qui n’ont pas d’équivalent en français et que nous ne saurions
traduire en langue savante ( F l a h a u l t , Projet, 1900, p. 11-12).
Dès 1835, O sw a ld H e e r distinguait dans la vallée de la Sernft (Qlaris), 30 stations
différentes; il a soigneusement indiqué dans la Flore de cette vallée quelle station recherche
chaque espèce. En 1844, W im m e r insistait sur la nécessité d’ajouter à la diagnose morphologique
de chaque espèce une diagnose phytogéographique « qui fixât d’une manière
précise et en termes compris de tous les conditions où elle vit; car une diagnose de ce
genre ne contribue pas moins que la première à la connaissance de l’espèce » (Wimm e r ,
Flora von Schlesien, Ceogr. Uebers., p. 4). Bien plus récemment, K e r n e r a insisté aussi sur
la nécessité de distinguer les stations et en énumère un certain nombre comme exemples.
Si nous nous permettons de revenir avec insistance sur ce point très important pour
la Géographie botanique, c’es t dans l’espoir que les floristes tiendront de plus en plus
compte de ce desideratum ; il est en outre à désirer que pour chaque espèce on indique la
manière dont elle participe aux formations de la contrée en question (voir B r o c k m a n n
1907).
Division des territoires botaniques en altitude. — L’un d’entre nous (F l a h a u l t ,
Projet 1900) a essayé de montrer les difficultés relatives à l’emploi du mot « zone ». Ce
mot exprime, en français, des espaces nettement limités, comme la partie de la surface d’une
sphère comprise entre deux parallèles, comme un espace que l’on compare à une bande
ou à une ceinture. C’est dans ce sens que ce mot est employé en Géologie, en As tronomie,
en Mé téorologie et ailleurs. 11 est usité pour désigner les grandes surfaces de la
sphère terrestre qui se distinguent par un climat et une végétation nettement déterminés.
Gn dit ainsi la zone chaude, les zones tempérées et froides. La notion de zone s ’applique
exactement à ces unités de premier ordre.
Ce mot a été adopté aussi par les phytogéographes de langue française (Edm.
B o i s s i e r 1839, H. C h r i s t 1879) e t par la généralité des botanistes français, pour exprimer
les différents étages de végétation qui se succèdent de la base au sommet des montagnes ou
du niveau de la mer aux profondeurs où cesse! la végétation marine. Cet emploi du mot est
conforme à la signification primitive (ceinture) et à la tradition de tous les pays de
langue française. Il paraît, dès lors, bien difficile que les peuples latins acceptent une interprétation
différente qui serait en contradiction avec le sens étymologique d’un mot de
leur langue.
D’autre part, beaucoup de botanistes de langue allemande ont interverti la signification
des mots région et zone, telle qu’elle est admise en français. Pour justifier leur
manière, ils peuvent faire valoir une tradition ancienne (A. de H u m b o l d t , M e y e n , etc.)
l’autorité d’ouvrages importants et la force de l’habitude. II est vrai encore que des concessions
motivées ont été faites à la manière de les employer qui nous semble la plus correcte
et que quelques botanistes de langue allemande appliquent aussi le mot zone dans des sens
très divers. A. E n g l e r , par exemple, entend sous le nom de zone une subdivision de la
province. D r u d e l’emploie dans un double s e n s .T o u t récemment L. D i e l s (1908) l’a appliqué
dans le sens français. ;
Aussi pour résoudre cette difficulté, nous semble-t-il désirable qu’on garde la notion
de zone seulement pour désigner les grandes ceintures suivant lesquelles la sphère terrestre
se décompose, dans son ensemble, en unités de premier ordre.
Appliquant à la nomenclature la notion à’étages, emprunté par l’un de nous (Projet
1900, p. 9 et 13) à la Géologie, appliqué récemment par L. A d a m o v i ç qui en a fait valoir
les avantages dans une application heureuse aux pays balkaniques (Die Vegetationsstufen
der Balkanländer, 1908), nous proposons que le mot étage soit employé pour désigner les
bandes ou ceintures de végétation qui se superposent dans les montagnes, que la notion
de région s ’applique seulement à de grandes étendues de pays. Gn dirait ainsi Vétage alpin
pour exprimer la ceinture de végétation alpine supérieure aux limites de la forêt et région
alpine pour désigner l’ensemble du massif des Alpes avec ses chaînons périphériques. Gn
dirait l’étage alpin du Caucase e t la région caucassienne, l’étage alpin des Andes et la région
andine. Gn éviterait ainsi les multiples ambiguïtés et les confusions auxquelles a donné lieu
l’emploi du mot zone. /
Les mots «Höh en s tufe» ou plus simplement «S tu fe» exprimeraient l’étage dans les
travaux phytogéographiques de langue allemande.
Des efforts très méthodiques ont été d’ailleurs poursuivis depuis dix ans pour délimiter
et subordonner les unités géographiques et topographiques. Gn peut espérer qu’on est
près de s ’entendre sur plusieurs des points en litige et que les phytogéographes tendent à
adopter les mêmes principes et à les appliquer par les mêmes moyens. Dès lors, il ne nous
a pas semblé nécessaire que le Congrès intervienne autrement que pour provoquer une
entente au sujet de la nomenclature en altitude.
Cartograipihie. — Pas plus qu’en matière de nomenclature il ne convient de légiférer
ou même de proposer des règles qui, le plus souvent, ne pourraient pas être observées. Ici
aussi, nous nous contenterons d’ énoncer des principes et de donner quelques avis dictés par
l’expérience. ' i ' |
lo Gn ne peut exprimer par les cartes que des faits précis et des objets définis. L’éta-
bfissement d’une carte force l’auteur à être exact. Une carte doit être l’expression graphique
la plus claire des faits ob se rv é s ; il faut d.onc souhaiter que tout travail phyto g éo g ra phique
soit accompagné de bonnes cartes.
2o Toute bonne carte phytogéographique est une contribution importante à la connaissance
de la Géographie générale d’un pays. j ■if4