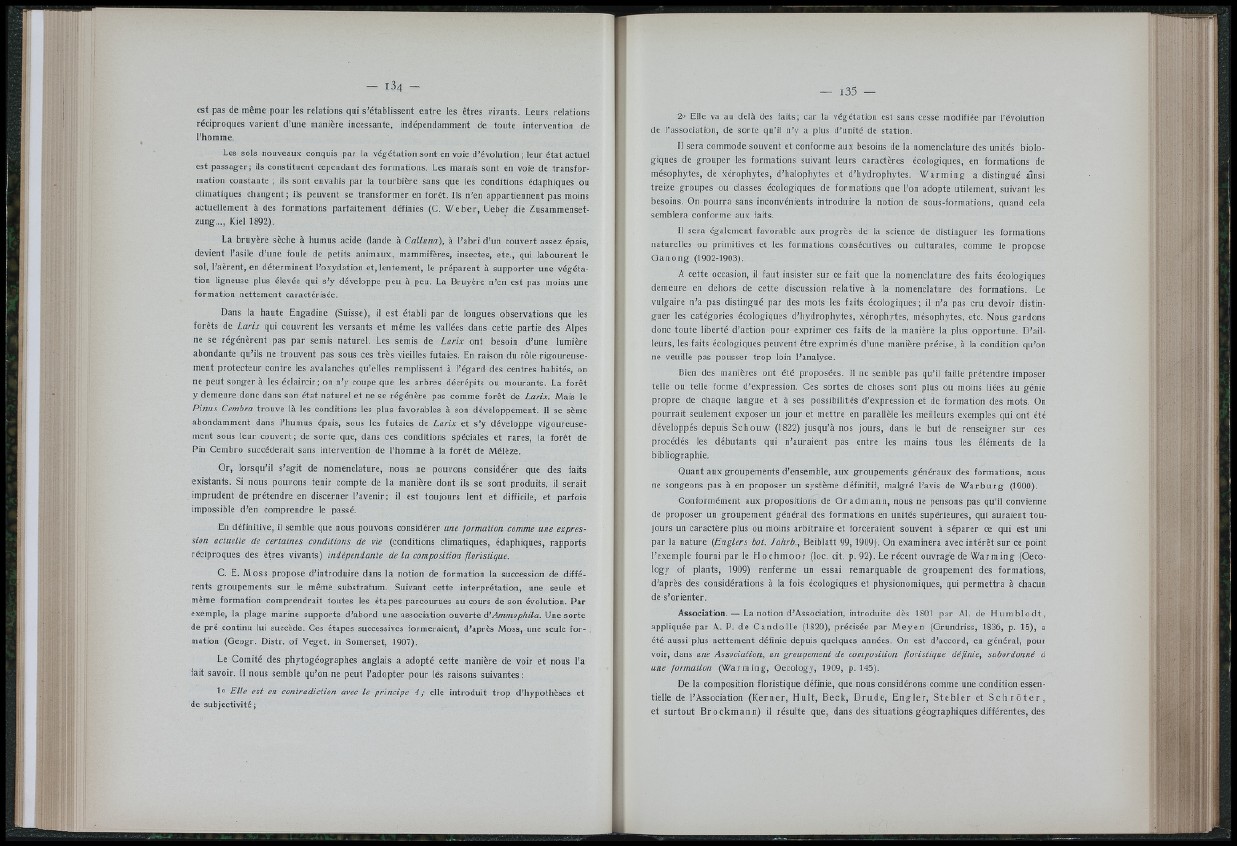
est pas de même pour les relations qui s ’établissent entre les êtres vivants. Leurs relations
réciproques varient d’une manière incessante, indépendamment de toute intervention de
l’homme.
Les sols nouveaux conquis par la végétation sont en voie d’évolution ; leur état actuel
est passager; ils constituent cependant des formations. Les marais sont en voie de transformation
constante ; ils sont envahis par la tourbière sans que les conditions édaphiques ou
climatiques changent; ils peuvent se transformer en forêt. Ils n’en appartiennent pas moins
actuellement à des formations parfaitement définies (C. W e b e r , Ueber die Zusammensetzung...,
Kiel 1892).
La bruyère sèche à humus acide (lande à Calluna), à l’abri d’un couvert assez épais,
devient l’asile d’une foule de petits animaux, mammifères, insectes, etc., qui labourent le
sol, l’aèrent, en déterminent l’oxydation et, lentement, le préparent à supporter une v ég é ta tion
ligneuse plus élevée qui s ’y développe peu à peu. La Bruyère n’en est pas moins une
formation nettement caractérisée.
Dans la haute Engadine (Suisse), il es t établi par de longues observations que les
forêts de Larix qui couvrent les versants et même les vallées dans cette partie des Alpes
ne se régénèrent pas par semis naturel. Les semis de Larix ont besoin d’une lumière
abondante qu’ils ne trouvent pas sous ces très vieilles futaies. En raison du rôle rigoureusement
protecteur contre les avalanches qu’elles remplissent à l’égard des centres habités, on
ne peut songer à les éclaircir; on n’y coupe que les arbres décrépits ou mourants. La forêt
y demeure donc dans son état naturel et ne se régénère pas comme forêt de Larix. Mais le
Pinus Cembra trouve là les conditions les plus favorables à son développement. Il se sème
abondamment dans l’humus épais, sous les futaies de Larix e t s ’y développe vigoureusement
sous leur couvert; de sorte que, dans ces conditions spéciales et rares, la forêt de
Pin Cembro succéderait sans intervention de l’homme à la forêt de Mélèze.
Or, lorsqu’il s ’agit de nomenclature, nous ne pouvons considérer que des faits
existants. Si nous pouvons tenir compte de la manière dont ils se sont produits, il serait
imprudent de prétendre en discerner l’avenir; il est toujours lent e t difficile, et parfois
impossible d’en comprendre le passé.
En définitive, il semble que nous pouvons considérer une formation comme une expression
actuelle de certaines conditions de vie (conditions climatiques, édaphiques, rapports
réciproques des êtres vivants) indépendante de la composition floristique.
C. E. M o s s propose d’introduire dans la notion de formation la succession de différents
groupements sur le même substratum. Suivant cette interprétation, une seule et
même formation comprendrait toutes les étapes parcourues au cours de son évolution. Par
exemple, la plage marine supporte d’abord une association ouverte d ’Ammophila. Une sorte
de pré continu lui succède. Ces étapes successives formeraient, d’après Moss, une seule formation
(Geogr. Distr. of Veget. in Somerset, 1907).
Le Comité des phytogéographes anglais a adopté cette manière de voir et nous l’a
fait savoir. Il nous semble qu’on ne peut l’adopter pour les raisons suivantes :
1° Elle est en contradiction avec le principe 4 ; elle introduit trop d’hypothèses et
de subjectivité;
2o Elle va au delà des faits; car la végétation est sans cesse modifiée par l’évolution
de l’association, de sorte qu’il n’y a plus d’unité de station.
Il sera commode souvent et conforme aux besoins de la nomenclature des unités biologiques
de grouper les formations suivant leurs caractères écologiques, en formations de
mésophytes, de xérophytes, d’halophytes et d’hydrophytes. W a rm in g a distingué ainsi
treize groupes ou classes écologiques de formations que l’on adopte utilement, suivant les
besoins. On pourra sans inconvénients introduire la notion de sous-formations, quand cela
semblera conforme aux faits.
Il sera également favorable aux progrès de la science de distinguer les formations
naturelles ou primitives et les formations consécutives ou culturales, comme le propose
G a n o n g (1902-1903).
A cette occasion, il faut insister sur ce fait que la nomenclature des faits écologiques
demeure en dehors de cette discussion relative à la nomenclature des formations. Le
vulgaire n’a pas distingué par des mots les faits écologiques ; il n’a pas cru devoir distinguer
les catégories écologiques d’hydrophytes, xérophytes, mésophytes, etc. Nous gardons
donc toute liberté d’action pour exprimer ces faits de la manière la plus opportune. D ’ailleurs,
les faits écologiques peuvent être exprimés d’une manière précise, à la condition qu’on
ne veuille pas pousser trop loin l ’analyse.
Bien des manières ont été proposées. 11 ne semble pas qu’il faille prétendre imposer
telle ou telle forme d’expression. Ces sortes de choses sont plus ou moins liées au génie
propre de chaque langue et à ses possibilités d’expression et de formation des mots. On
pourrait seulement exposer un jour et mettre en parallèle les meilleurs exemples qui ont été
développés depuis S c h o u w (1822) jusqu’à nos jours, dans le but de renseigner sur ces
procédés les débutants qui n’auraient pas entre les mains tous les éléments de la
bibliographie.
Quant aux groupements d’ensemble, aux groupements généraux des formations, nous
ne songeons pas à en proposer un système définitif, malgré l’avis de W a r b u r g (1900).
Conformément aux propositions de G r a dm a n n , nous ne pensons pas qu’il convienne
de proposer un groupement général des formations en unités supérieures, qui auraient tou jours
un caractère plus ou moins arbitraire et forceraient souvent à séparer ce qui est uni
par la nature {Englers bot. Jahrb., Beiblatt 99, 1909). On examinera avec intérêt sur ce point
l’exemple fourni par le H o c h m o o r (loe. cit. p. 92). Le récent ouvrage de W a rm in g (Oecology
of plants, 1909) renferme un essai remarquable de groupement des formations,
d’après des considérations à la fois écologiques et physionomiques, qui permettra à chacun
de s ’orienter.
Association.— La notion d’Association, introduite dès 1801 par Al. de H u m b l o d t ,
appliquée par A. P. d e C a n d o l l e (1820), précisée par M e y e n (Grundriss, 1836, p. 15), a
été aussi plus nettement définie depuis quelques années. On es t d’accord, en général, pour
voir, dans une Association, un groupement de composition floristique définie, subordonné à
une formation (W a rm in g , Oecology, 1909, p. 145).
De la composition floristique définie, que nous considérons comme une condition es sentielle
de l’Association (Ke rn e r , H u i t , B e c k , D r u d e , E n g l e r , S t e b l e r et S c h r ö t e r ,
et surtout B r o c km a n n ) il résulte que, dans des situations géographiques différentes, des