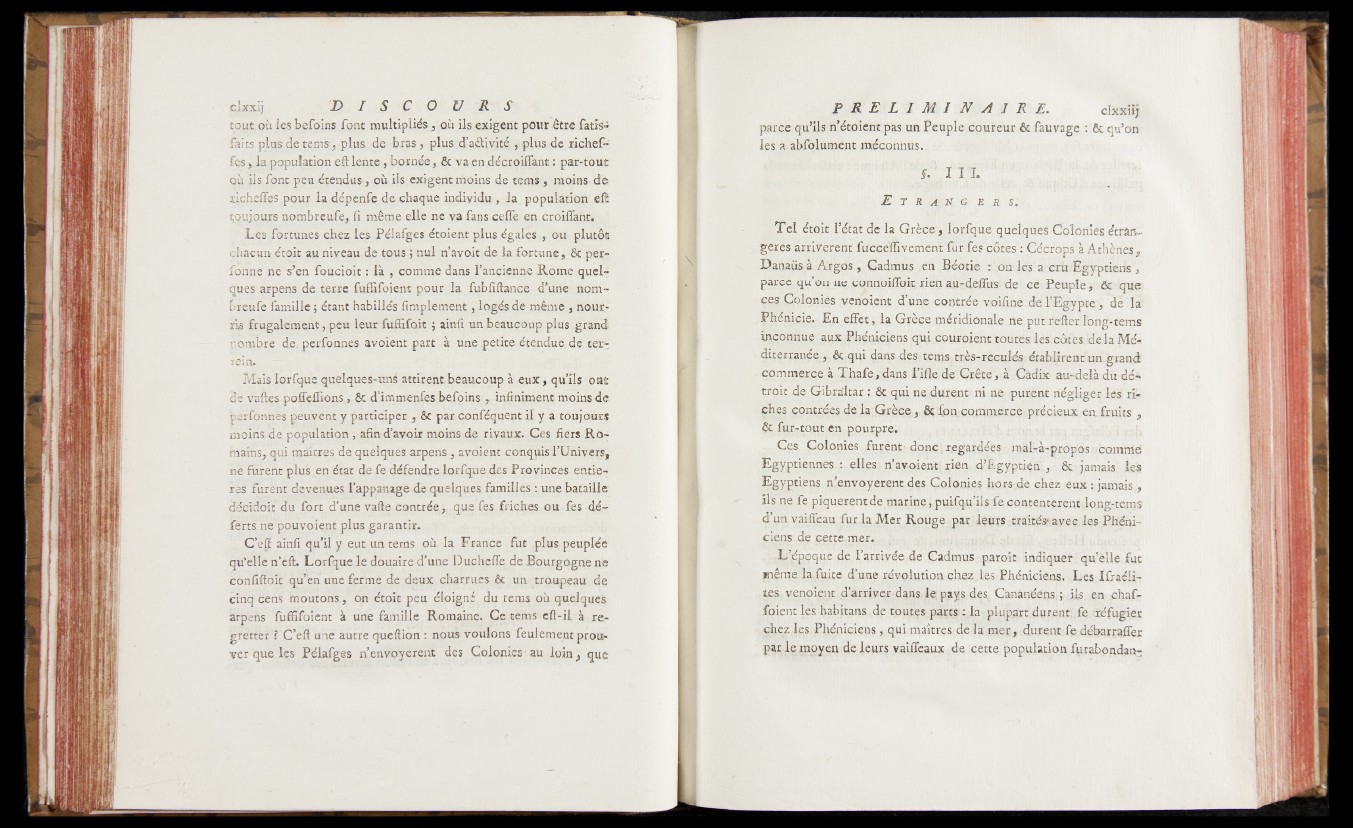
clxxij D I S C O U R S
tout où les befoins font, multipliés^ -où ils exigent pour être fatis-
faits plus de tem.sJ, plus de bras , plus d’aâivité plus de richef-
fes, la population efl lente , bornée, & va.en décroififant : par-tout
où ils font peu étendus, où ils exigent moins de tems , moins de
rlchefies pour la dépenfe de chaque individu , la population eH
toujours nombreufe, fi même elle ne va fansceflh«en eroiflant.
Les fortunes chez les Pélafges étoient plus égales , ou. plutôt
chacun était au niveau de tous ; nuln’avait de la fortune, & per-,
fonne ne s’en foucioit : là , comme dans l’ancienne Rome quelf
ques arpens de terre fuffîfoient pour la fubfiftance d’une nom-
oreufe famille ; étant habillés Amplement, logés de même , nourris
frugalement, peu leur fuffifait ; ainfi un beaucoup plus grand
nombre de, perfonnes avoient part à une petite étendue, de ter-
reîa.
Mais lorfque quelques-uni attirent beaucoup à eux, qu’ils ont
âe Vallès poffeflions& d’immenfes befoins , infiniment moins de
perfonnes peuvent y participer , & par conféquent il y a toujours
moins de population, afin d’avoir moins de rivaux. Ces fiers Romains,
qui maîtres de quelques arpens, avoient conquis l ’Univ-ers,
ne fuient plus en état de fe défendre lorfque des Provinces entières
furent devenues l’appamge de quelques famille?,rune bataille
décidoit du fort d’une vafte contrée, que fes friches ou fes dé-
fért& ne pouvoient plus garantir.
G’efi ainfî qu’il y eut un tems où la. France fut .plus, peuplée
qu’elle n’eft. Lorfque le douaire d’une Duchelfe de Bourgogne ne
confiffôit qu en une ferme de deux charrues & un troupeau de
cinq cens boutons, an était peu éloigné .du tems où quelques
arpens fuffifoient à une famille Romaine. Ce temscft-il à regretter
rC ’eft une autre queftiôn : nous voulons feulement prouver
que les Pélafges n’envoyerent des Colonies • au loin, que
P R E L I M I N A I R E. clxxiî;
parce qu’ils n’étôienf pas un Peuple coureur & fauvage : ôc qu’on
les a.abfolument méconnus..
' §. \ I I I .
E T R A . N. G E R
Tel étoit l’état de la Grèce , lorfque quelques Colonies étrangères
arrivèrent fuccefïivement fur fes côtes : Cécrops à Athènes,
Dan.àùs à;A'?gqs , Cadmus .en .Béotie jïèon lès'aîerù.Egypâôrfe ,
parce qu’on ne connoiffoit rien aurdeffusi de ■ c e . Peuple, & que.
çe5;Çloloniés yenoient d’une contrée voifine de l’Egypte, "de la
En effet, p* Grèce méridionale ne put-refterlong-tems
i%qon^^,§ux^hénÂ^en^;q^;C9^oienttcM^iés'r^h»iddb-Més
diterrançe., &qui dans, des (terns^s-reculés. étabhrentun grand
commerce à Thafe^dans l ’ifle dè'Grète ^à Cadix auedeià.dû détroit
de Gibraltar : & qjii ne durent ni ne purent négligerles riches
çonjttéçS’de la ; £rrèc«e, & ion ; commerce-? précieux en fruits tf
& fur-tout en : pourpre;'; :
Çqs Colonies furent' dqnç' regardées .•Mt-à-propdsj’ibanmid
Egyptiennes : ellçp; n’avojent. rien l ’Egyptiéh,. &• jamais, les
Egyptiens n’envoyerent des Colonie? horede chez eux jamais.,
ils ne fe piquèrent de marine , puifquUlsXooQOtentçrent Jong-temS
d’un vaiffeau fur la Mer Rouge, par ; leurs ; traité^ayeçles Phéniciens,
de çettemer.; : \
L ’époque de l’arrivéele Càdhiüs^paroît indiquer qu’élle fut
même la fuite d’une révolution chez.lés Phéniciens.- Les Ifraéli-
tes venqient d’arriver dans lé; pays d ^ Cananéens* iüils. en chaf-
foient les habitants , dp toutes, parts :1a plupart dur.entnfe «réfugier
chez 4qs; Phéniciens ,:qui.mhtrésle là mer > lufentife défearrafler
par le moyen de leurs yaiffeaux l e cette population furabondan^