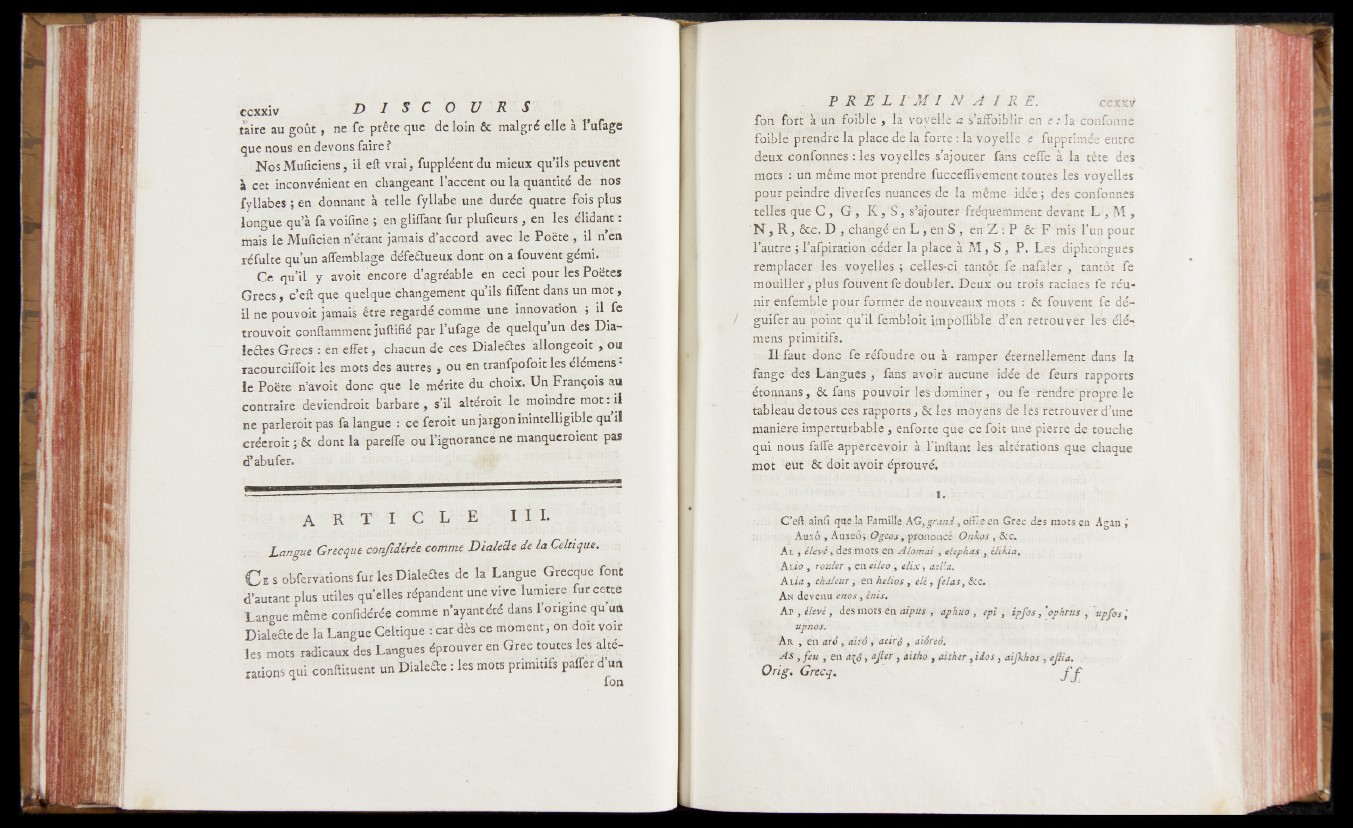
ècxxiv D I S C O U R S
taire au goût, ne fe prête que de loin & malgré elle à Tufage
que nous en devons faire ?
NosMuficiens, il eût vrai, fuppléentdu mieux qu’ils peuvent
à cet inconvénient en changeant l’accent ou la quantité de ! nos
fyllabes ; en donnant à telle fyllabe une durée quatre -fois plus
longue qu’à fa voifine >\en gliffant fur plufieurs, en les élidant :
mais le Muficien ».étant jamais d’accord avec le Poëte., il n’en
réfulte qu’un affemblage défeftueux dont on a fouvent gémi.
Ce qu’il y avoit encore d’agréable en ceci pour les Poëtes
Grecs, c’eft que quelque changement qu’ils fiffent dans un mot,
il ne pouvoit jamais être regardé comme une innovation ; il fe
trouvoit conftamment juftifié par l’ufage de quelqu un des Diale
£tes Grecs ; en effet, chacun de ces Dialectes allongeait^ ou
racourciffoit les mots des autres , ou en tranfpofoitles élémens •
le Poëte n’avoit donc que le mérite du: choix. Un François au
contraire deviendroit barbare, s’il altéroit le moindre mat : il
ne parlerait pas fa langue : ce ferait un-jargon inintelligible qu il
créeroit ; & dont la pareffe ou l’ignorance ne manqueraient pas
d’abufer.
A K T I C L E I I I .
Langue Grecque confidérèe comme V iàlecle dé la fàîptqve.
C e s obfervations fur les DialeRes de la Langue Grecque font
d’autant plus utiles quelles répandent une vive lumière fur cette
Langue même confidérée comme n’ayant été dans f origine qu’un
Dialeaede la Langue Celtique : car dès ce moment, on doit voit
les mots radicaux des Langues éprouver en Grec toutes lés i t é rations
qui conftituent un D ia le^ : les mots primitifs paffer d un
P R E L P M I N A I R E . cexxv
fon fort aHm.fpible , la v6 y elle Vz faffbiblir en e : la confonnê
fbible prendre la place.de la forte : la voyelle e fupprimée entre
deux confonnes : les voyelles s’ajouter fans celle à la tête des
motsftfuh même mot prendre fucceffivement toutes les voyelles
pour peindre diverfes nuances dé la même idée; des confonnes
telles que C , G ,- K , ‘S^' s’âjouter fréquemment devant L , M ,
N ,R , ôcc. D , changé en L , en' S , en‘ Z : P & F mis l’un pour
l ’autre j l ’âfpiration céder la place à M -, S , P. Lès diphtongues
remplacer les <.YO,yçlles-; celles-ci tantôt; fe -nafaler , tantôt fe
mouiller ,1 plus fouveftt fe doubler. Deux -ou.trois racines fe réunir
erifemble pour former de nouveaux mots : & fouvent fe dé-
/ guifer au point"qu’il fémbloit impôlîibïe d’en retrouver les élé-_
mens primitifs.
i Il-faut dème Le .réfoudre ou à ramper éternellement dans la
fange1 'des Langues;,' fans": avoir aucune idée de feurs rapports
étoqnans , & fans pouvoir ldPdcfiâiittèâr j 1 ou -fe -‘ifetidrè ’propre le
tableau détôus'cés rapports, ôt lès môyëftS de les retrouver d’une
maniéré imperturbable, enforte qùe= ce foit- une pierre de touche
qui nous faffe appercevoir, à l’inftant les altérations que chaque
mot eut ôt doit avoir éprouvé.
i.
: r ; C’eft: aînfi que,la Famille,AG, grand, offre en Grec des mots en Agan,
, A-uxpj, Auxeo; O g c o sprononcé Onkos , &c.
Al , élevé -, des iiip.cs. en'Alomai , elephas , êlikia,
Kûo , rouler , en eileo,, e lix , atl'.a.
A l ia , chaleur, en helios , e li, fêlas, &c.
An devenu enos, énis.
Ap , élevé, des mots en aipàs , ophuo , epi , ipfôs, ’opkrus y upfos’
j iiptios.
Ar. , en a rô , a irà , aeirô , aléreé.
A s t feu , en , ajler} àitho , aitker, idos, aijkhos , ejlia.
Orig, Grecq. J J