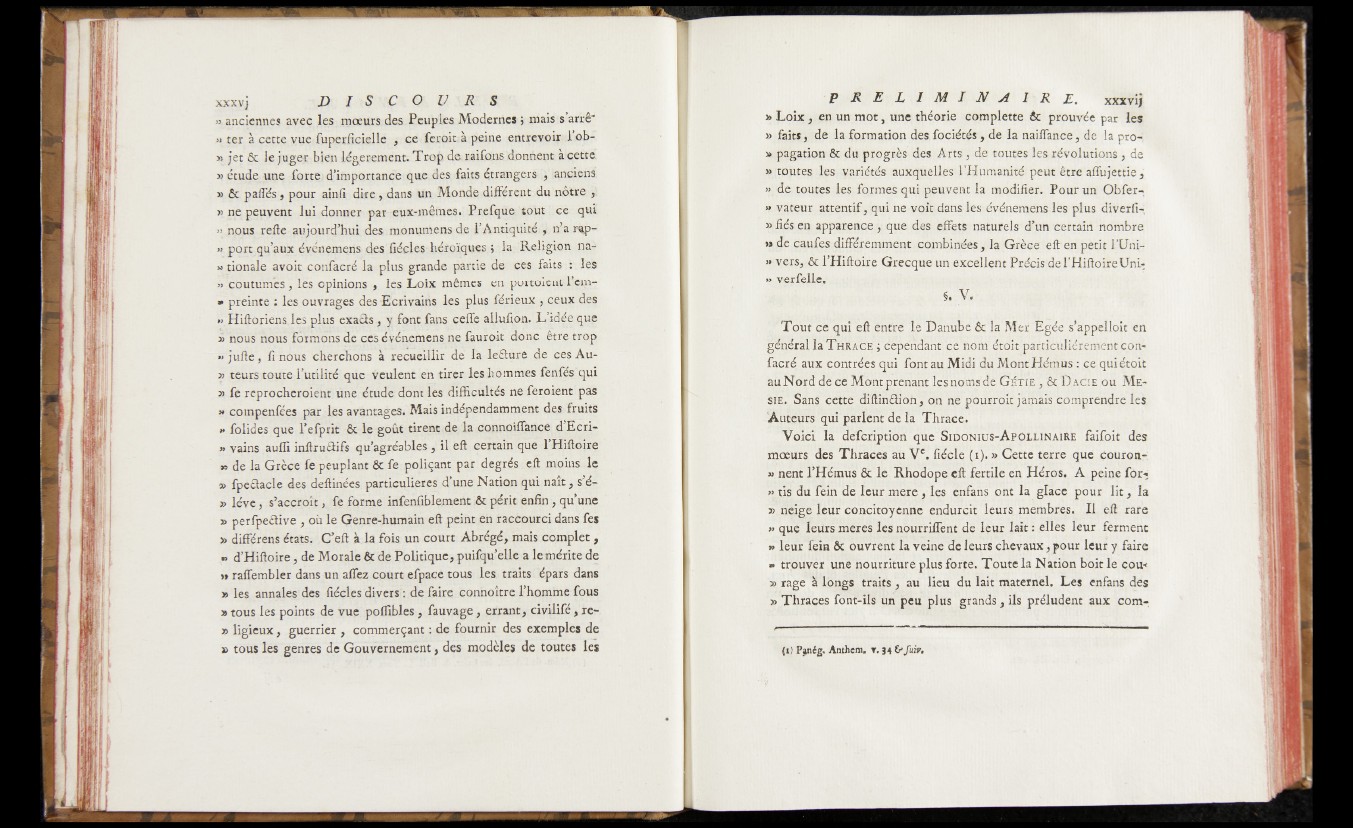
xxxvj D I s e O U R S
« anciennes avec les moeurs des Peuples Modernes ; mais s’arrê'
« ter à cette vue fuperficielle , ce fer oit; à peine entrevoir 1 ob-
» jet & lejugej bien légèrement. T ïq|> de raifonsjdjcmôepta.'ceétci
» écudejune fortfe; d'importance-que; des; faits étfSùgersuj^anciens
» 6c paffés, pour ainft dite, dans un Mondé différent du nôtre jjl
» ne peuvent lui donner par eux-mêmes. Prefque tout ce qui
» npus relie aujourd’hui des. ..n&drai#$£<}5.-<ië- l'Aitèqtita&Vb ®?a r^p-
» port qu’aux événemçns des fiécles-hérçiques * la; Religion na-*
» tionale avoir confacré la plus grande partie de ces faits : les
« coutumes, les o p i n i o n s L o i x mêmes e^portoientl’em-
» preinte : les ouvrages des Écrivains les plus féri.eux , ceux des
» Hiftoriens,les plus exaéis .? y font fans ceffe Lfd^e quç
» nous nous formons de ces événemens ne fauro-it donc êtrestr^p
» jufte, fi nous cherchons à recueillir de fà le'Sure de ces Au-
» teurs toute l’utilité que veulent en tirer les hommes fènfés’qui
» fe reprocheroient Une étude dont les difficultés ne feraient; pâà
» compenses par les avantages. Mais indépendamment des fruits
» folides que l’efprit 6c le goût tirent .de- la connoiffance d’Ecri-
» vains auffi inftruéiifs qu’agréables , il eft certain que 1 Hiftbire
» de la Grèce fe peuplant ôc fe poliçant par degrés eft moins le
» fpeâacle des deftinées particulières d’une Nation quimaît, s’é>
» lève, s’accroît, fe forme infenfiblement ,6c périt enfin, qu’une
» perfpedive , où le Genre-humain eft peint en raccourci dans fes
» différens états. C’eft à la fois un court Abrégé, mais complet,
» d’Hiftoire, de Morale 6c de Politique, puifqu’elle a Témérité de
» ralfembler dans un alfez court efpace tous les traits épars dans
» les annales des fiécles divers : défaire connoître l’homme fous
» tous les points de vue poffibles, fauvage, errant, civUifé, re-.
» ligieux, guerrier , commerçant : de fournir des exemples de
» tous les genres de Gouvernement, des modèles de toutes les
P JR E L I M. 1 N A 1 JR. E. xxxvij
» L o ix , en un mot, une théorie complette 6c prouvée par les
» faits, de la formation des fociétés, de la naiffance, de la pro-;
» pagation 6c du progrès des Arts , de toutes les révolutions , de
» toutes les-variétés auxquelles l’Humanité peut être affujettie ,
». de toutes les. formes qui peuvent la modifier. Pour un Obferh.
vateur attentif, qui ne voit dans les événemens les plus diverfi-
».fiés en apparencey que dés effets naturels d’un certain nombre
» de caufes différemment combinées , la Grèce eft en petit l ’Uni-
» vers, :ôc l’Hiftoire Grecque un excellent Précis de l’Hiftoire Uni-
» verfelle,; ,
;w-..
Tout ce qui êft entre le Danube 6c la Mer Egée s’appelloit en
général la T hrace ; cependant, cë nom étoit particuliérement confacré
aux contrées qui font au Midi du Mont Hémus ; çe qui étoit
au Nord de ce Mont prenant lesnoms de Gétie , ôc DaCie ou Me-
sie. Sans cette diftin&ioh, on ne pourroit jamais comprendre les
.’Auteurs qui parlent de la Thrace.
Voici la dëfcriptiori que Sidoniüs-Apollinaire faifoit des
moeurs des Thraces au V e. fiécle (1). » Cette terre que courons
» nent l ’Hémus 6c le Rhodope eft fertile en Héros. A peine for-*
» tis du fein de leur mere, les enfans ont la glace pour li t , la
» neige leur concitoyenne endurcit leurs membres. Il eft rare
» que leùrs mères les nourriffent de leur lait : elles leur ferment
» leur feia ôc ouvrent la veine de leurs chevaux,pour leur y faire
» trpuvér une nourriture plus forte. Toute la Nation boit le cou-«
» rage à longs traits , au lieu du lait maternel. Les enfans des
» Thraces font-ils un peu plus grands,ils préludent aux com-
(t) Pjn ig. Anthera, v. 34 (y fuir.