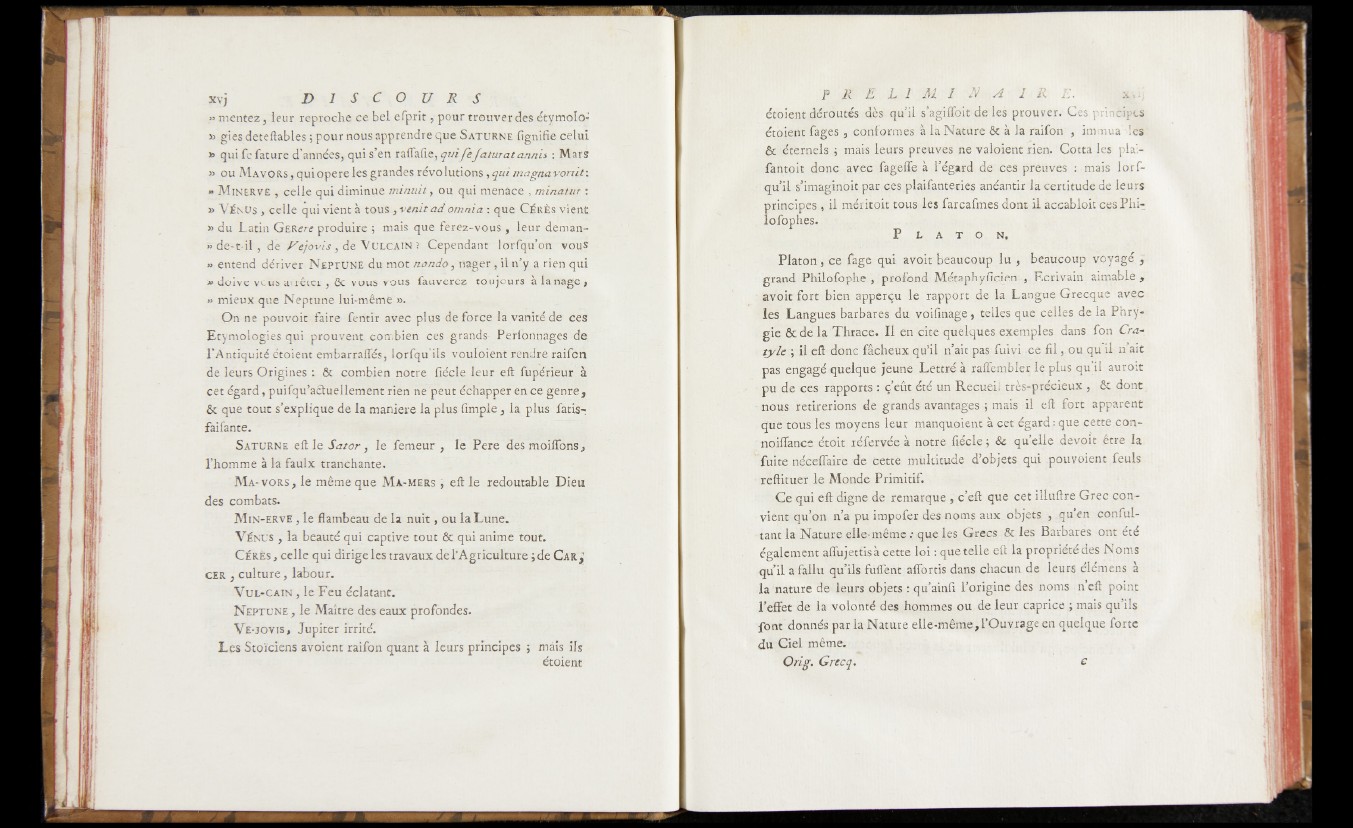
xvj D I S C O U R S
» mentez, leur reproche ce bel efprit y pour trouver des. étymolo-
» giesdeteftables ; pour nous apprendre que Saturne lignifie celui
» qui fe fature d’années, qui s’en raffafie, qyi-fkfattirât annis : Mars
» ou Mavors , qui opéré les grandes révolutions y qui magnavartitv
» Minerve , celle qui diminue minuit, ou qui menace , minatur :
» VÉNUS * celle qui vient à touS-yvenit ad omnia : qûè GÉRÈCfienÇ,
» du Latin GERcre produire ; mais que fere^-vous , leur deman-
» de-t-ii, de Vejov'ts, de Vuecain^ Cependant lcrrfqu'on vous
» entend dériver Neptune du mot /zaWp,nagert iln’yarignqui
» doive vous arrêter, & vous vous fauverez toujours à fanage,
» mieux que Neptune Jui-mêmé x>» v
On ne pouvoir faire fentïr avec plus de force la vanité de ces
Etymologies qui prouvent combien ces, grands- Perfonnages de
l ’Antiquité étoient embarraffés, lorfquTls’V^uloïentrendié raîlbn
de leurs Origines : & combien notre fiécle leur eft fupérieur à
cet égard, puifqu’aêluellement rien ne peut échapper"en ce genre
& que tout s’explique de la manière la plus (impie, la plus fatià^
faifante.
Saturne eft le Sator, le femeur , lé Pere des moiïTons,
l ’homme à là faulx tranchante.
Ma-vqrs , le même que Mx-mers ; eft le redoutable Dieu
des combats.
Min-erve , le flambeau de la nuit, ou la Lune.
Vénus , la beauté qui captive tout & qui anime tout.
Cérês , celle qui dirigeles travaux de l’Agriculture ; de Car,"
cer , culture, labour.
V ul-cain , le Feu éclatant.
Neptune , le Maître des eaux profondes.
Ve-jovis, Jupiter irritée
Les Stoïciens avoient raifon quant à leurs principes ; mais Ils
étoient
P R E L 1 M I N A I R E. xuj
étoient déroutés dos, qu’il s’agiffoitde les prouver.' Ces principes
étoierit- fages , conformes à là Nature & à la raifon , immua les
& éternels.^ mais leurs preuves ne valoientrien. Cotta les plai-
fantoit donc, avec fageffe à l’égard de ces preuves : mais lorsqu'il
s’imaginoit pfwc.qes plaifanteries anéantir la certitude de leurs
principes,3; il méritoit tousdes farcafmes dont il accabloit ces Phi-
lofophes. •
P L A T*hQ N,
Platon, icq-fage qui avo.it beaucoup lu , beauçoup voyagé ^
grand Phiiofqphc , ‘profond Métaphy ficien-., Ecrivain aimable ,
■ ^tvoit'fort bien appérqu le rappbjrt de la Langue Grecque1 avec
les Langues;barbares du voifinage , telles qü£ celles de la Phrÿ«
. gie & deUa'Thrace, Il en cite quelques exemples dans fon Cra-
il eft- donc fâcheux qu’il n’.ait pas fuivi .ce,fil, ou qu il n’ait
pas „engagé quelque jeune Lettré, à raffembleçle plus qu’il auroit
• pu de ces - rapports : ç’eut été un Recueil très-précieux , & dont
nous .retirerions de grands avantages;} mais il eft fort apparent
c^é:tOTs:les moyens leur manquaient- à cet égard : que cette.con-
noiflance étôit, xéfervée à notre fiécle ; & qu’elle devoit être la
fuite néceffaire de Cette multitude d’objets qui pouvoient.feuls.
reftituer le Monde Primitif.’. <
Ce qui eft digne de remarque, c’eft que cet illuftre Grec con-
vièràqu’on n’a pu impofer des noms aux objets , qu’en confui-
-tant la Nature ellermêmc .* que les. Grecs & les Barbares-ont été
également afîujetfisà cette loi : que telle eft la propriété des Noms
qu’il a fallu quils füfient alfortis dans chacun de leurs élémens à
la nature de leurs objets rqu’àinfi l’origine des noms -n’eft point
l ’effet de la volonté des hommes ou de.leur caprice,; mais qu’ils
font' donnés par la Nature elle-même, l’Ouvrage en quelque forte
du Ciel même.
Orig. Grecq. c