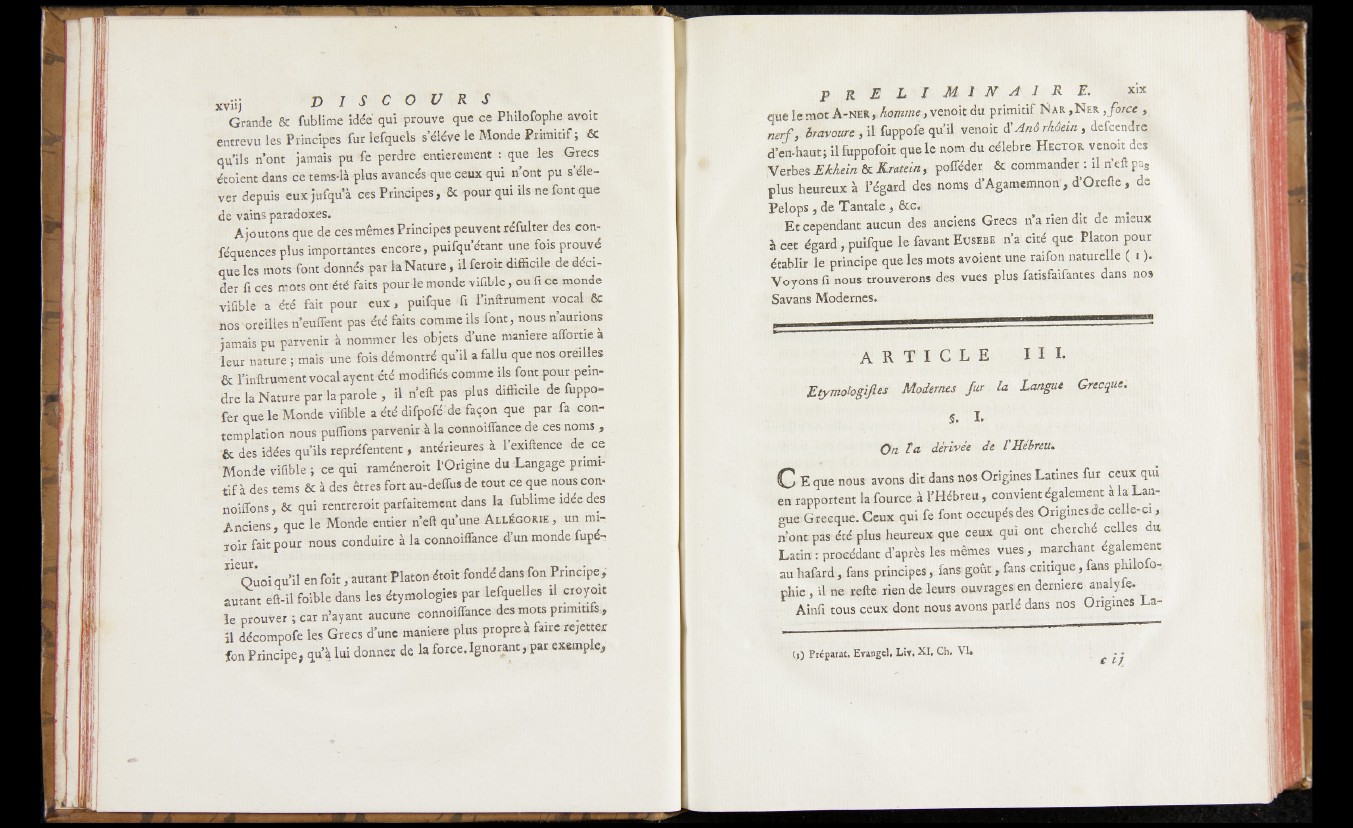
xviij D I S C O U R S
Grande & fubiime idée qui prouve que ce Philofophe avoir
entrevu les Principes -fur lefqueis s’élève le Monde Primitif ; 6c
qu’ils n’ont jamais pu *e perdre .entièrement : >que les Grecs
ét oient dans ce tems-là plus avancés-queceuxqui rt-ont pu s’élever
depuis eux jufqu'à ces Principes, & pour qui ils nefbnt que
de vains paradoxes.
Ajoutons que de ces mêmes Principes peuvent réfulter des con-
féquences plus importantes encore, puifqu’étant une fois prouvé
que les mots^font donnés par la Nature, il feroit difficile dedéci-
der li ces mots ontétë faits pour-le monde vifible,ou fi ce monde
vifible a été fait pour eux , puifque fi i’inftsuroeiït -vocal r&
nos'oreilles n euffent pas été faits comme ils font, nous nkurions
jamais pu parvenir à nommer les objets d’une maniéré affome à
leur nature ; mais une fois démontré qu il a fallu que nos. oreilles
& l’inftrument vocal ayent-ëté modifiés comme ils font pour peindre
la Nature parla parole , il n’eft pas plus difficile de fuppq-
fèr que le Monde vifîble a été difpofé‘de 'ffiçon que par fa contemplation
nous puïfioBS -parvenir à la c@nnoiffiance.de ces noms ,
fie des idées qu’ils repréfentent , antérieures à l’exiftence de ce
Monde vifible ; :ce qui raméneroit l’Origine du Langage primitif
à des tems & à des êtres fort au-deflusde tout ce que nauseon-
noiflbns , & qui rentrerait parfaitement dans k fubiime idée des
Anciens, que le Monde entier rneft qu’une Allégorie, un miroir
frit pour nous conduire à la con&oiflance d’un monde.fupé-r
Quoiqu'il enfoit ,nütant Platonétoit^fondé dans fon Principe,,’
tant éft-ïl foible dans les étymologies par .lefquelles il ctoyoït
prouver ; car n’ ayant aucune connoiflance des mots pnimtife,,
décompofe les Grecs d’une maniéré plus propre* fairerrejetter
n Principe ? qu’à lui donner de k force. Ignorant , par exemple,
P R E L I M I N A I R E , xix
que le metA.-iw^pLmme-,,yçsmt du primitiC ^ AR $Èj£
nerc y bravoure, il fuppofo qu’il venoit à’ArpârAôân, defeendre
d’emhaut; il fuppofoit que le nom du célébré Hector venoit des
.Verbes Ekhein & Kratein,: pofféder, & commander : il n’eft pas
plus heureux à l’égard des noms d’Agamemnon', d’Orefte, de
Pelops, de Tantale, &c„ ^ j . ..
Et cependant aucun des anciens Grecs n’a r.ien dit de mieux
à cet égard, puifque le kvant Eusebe n’a cité que Platon pour
établir le principe que les mots avoient une raifon naturelle ( i ).
Voyons fi nous trouverons des vues plus fatisfaifantes dans, nos
Savans Modernes*.
A R T I C L E I I I.
Etymologifies Modernes far la Langue Grecque,
$ . 1 .
On l a dérêvée de t Hébreu,
C E que nous avons dit dans nos Origines Latines fur ceux qui
en rapportent la fource, à ^Hébreu, convient également à la Lan-
gue Grecque. Ceux qui fe font occupés des O r ig in e s ^ c ^ c i? .
nonc pas: été; plus heureux que ceux qui ont cherché celles du
Latirï : procédant d’après les mêmes vues., mâchant également
auhakrd,.fans principes, P^dotophie
, S ne. refte rien de leurs ouvrages! en dernier«- analyfe.
Ainfi tous ceux dont nous avons parlé dans nos Origines a
c % (j) Préparât. Evangel, Li y, XI, Ch; VU