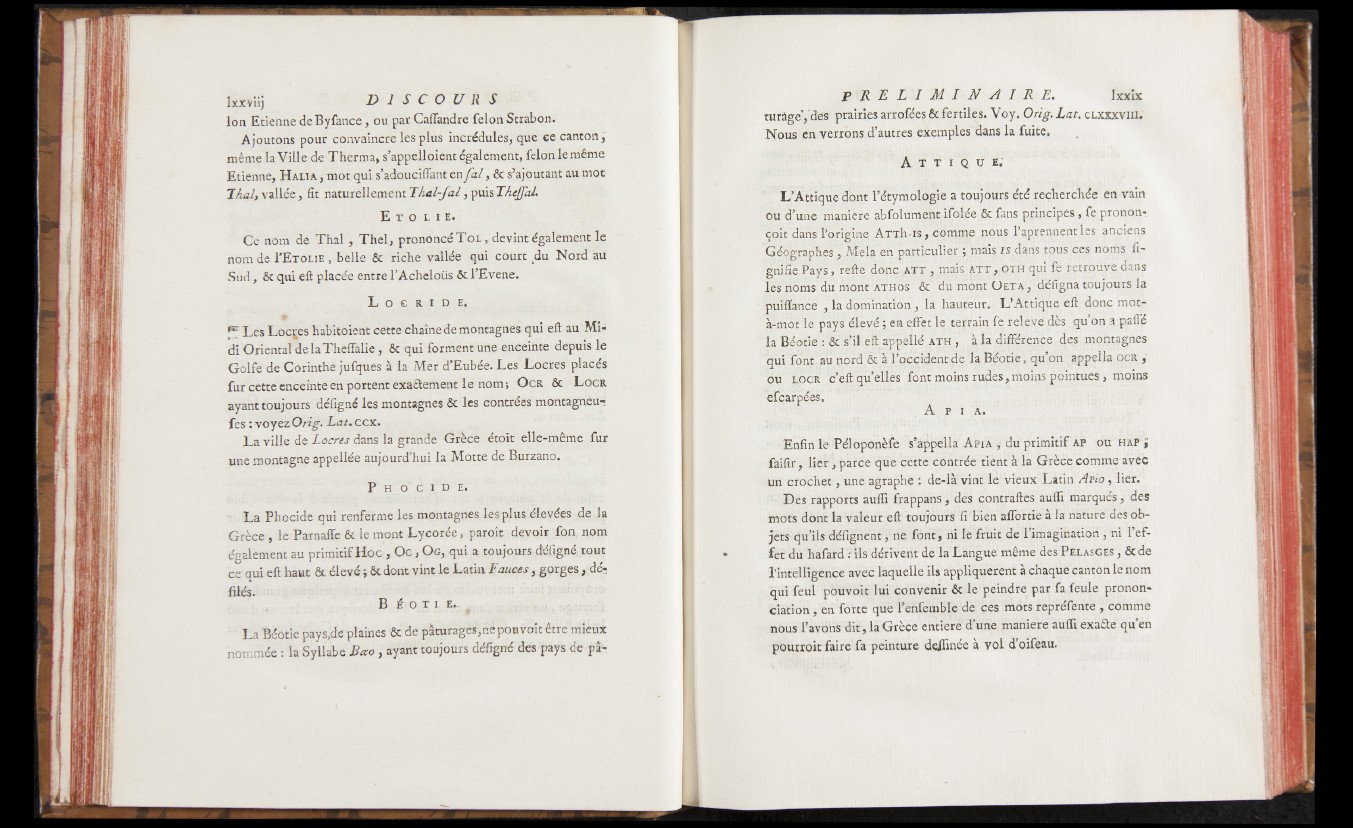
lxxviij D I S C O U R S
Ion Etienne deByfance , o u par Caffandre félon Strabon.
Ajoutons pour convaincre les plus incrédules, que ee canton;
même la Ville de Thermà, s'appelaient également, félon ie même
Etienne, Halia, mot qui s’adquciflant en fa l, ÔC s’ajoutant au mot
lkal> vallée, fit naturellement Thal-fal, puis TheJJaL
E r o H E .
Ce nom de T h a ï, Thel, prononcé T o t , devint également le
nom dé I’Etolie , belle Ôc riche vallée qui' court du Nord au
Sud, & qui eft placée entre l’Acheloüs ôc l’Evene.
L o € R i D Eé
^ Les Locres habitoierit cette chaîne de montagnes qui eft au Midi
Oriental cle la Theffalie, ôc qui forment une enceinte depuis le
Golfe de Corinthe jufques à la Mer d’Eubée. Les Locres* placés
fur cette enceinte en portent exa&ement 1 e nom ; Ocr 6c L ocr
ayant toujours défigné les montagnes ôc les eontrées montagnêu-
fes : voyez Orig. Lat. ccx. ,
La ville de Locrès dans la grande Grèce étoit elle-même fur
une montagne appellée aujourd’hui la Motte de Burzano.
P h o C i ,d E.
- La Phocide qui renferme les montagnes ksfplus élevées de la
Grèce, le Parnaffe ôc le mont Lycorée * paroît :4évc>ir fôn; nom
également au primitif Hoc,, O c , O s , qui a, toujours défigné jtout
ce qui eft haut ôt élevé ; ôtdont vint le Latin Fouets, gorges, défilés.
B é't> n l
La Béôtie pays,de plaines & de pâturages, h^ponvtnt êtféhiieuX
nommée : la Syllabe B a o , ayant toujours défigné des pays de pâ*
P R E L I M I N A I R E . lxxîx
turâgeydés prairies arrofées 6c fertiles. Voy. Orig. Lat. clxxxviu.’
Nous .en verrons d’autres exemples dans la fuite.
A T T I Q U E.
L ’Âttique dont1 l’étymologie a toujours été recherchée en vain
bu d’une maniéré âbfolumentifolée Ôc fans principes, fe pronon-,
çoit dans l’origine AttIi-is, comme nous l’éprennent les anciens
Ge^ra^hes , Mêla en particulier ;. mais is.dans tous.ces noms fi-
gnifie Pays, refte donc att -, mais att , oth qui fe retrouve dans
ïes^nénls du mont ath<»v ôc du mont Ô eta , défigna toujours la
puîftance" ^ladomination , la hauteur. L ’Attique eft donc motr
à-fnot le pays élevé \ en effet le terrain fe rçleve dès qu’on a palfé
la Béotie : ôc. s’il eft appgllé ,ath , à la différence des montagnes
qui font au nord ôc à l’occident de là Béotie ', qu’on appella oçr
ou ipcâ .c’eft quelles ' font' moins rudes, moins pointues, moins
efearpées.
A P I A.
Enfinle Péloponèfe s’appella A pia , du primitif ap ou hap ji
faifir , lier, £arcé que cétte contrée tient à la Grèce comme avec
un crochet, une agraphe : de-là vint lé’ vieux Latin A?io, lier.
Des rapports aufïi frappans, des contraftes auffi marqués, des
mots dont la valeur eft toujours1 fi bien affortie a la nature des objets
qu’ils défignènt; rië font, ni le fruit de 1 imagination, ni 1 effet
du hafard .•’Ils dérivent de la’Lahguemémê'aeisPËLÀsGES, ôede
l’intelligence avec laquelle ils appliquèrent à chaque canton le nom
qui feül; poüvoit lui convenir ôc le peindre par fa feule prononciation,
en forte que l’enfemble de tes mots repréfente, comme
nous l’avbns dit , là Grèce entieïè d une maniéré aufïi exaête qu en
pomroit faire fa peinture de/finée à yol d’oifeau.