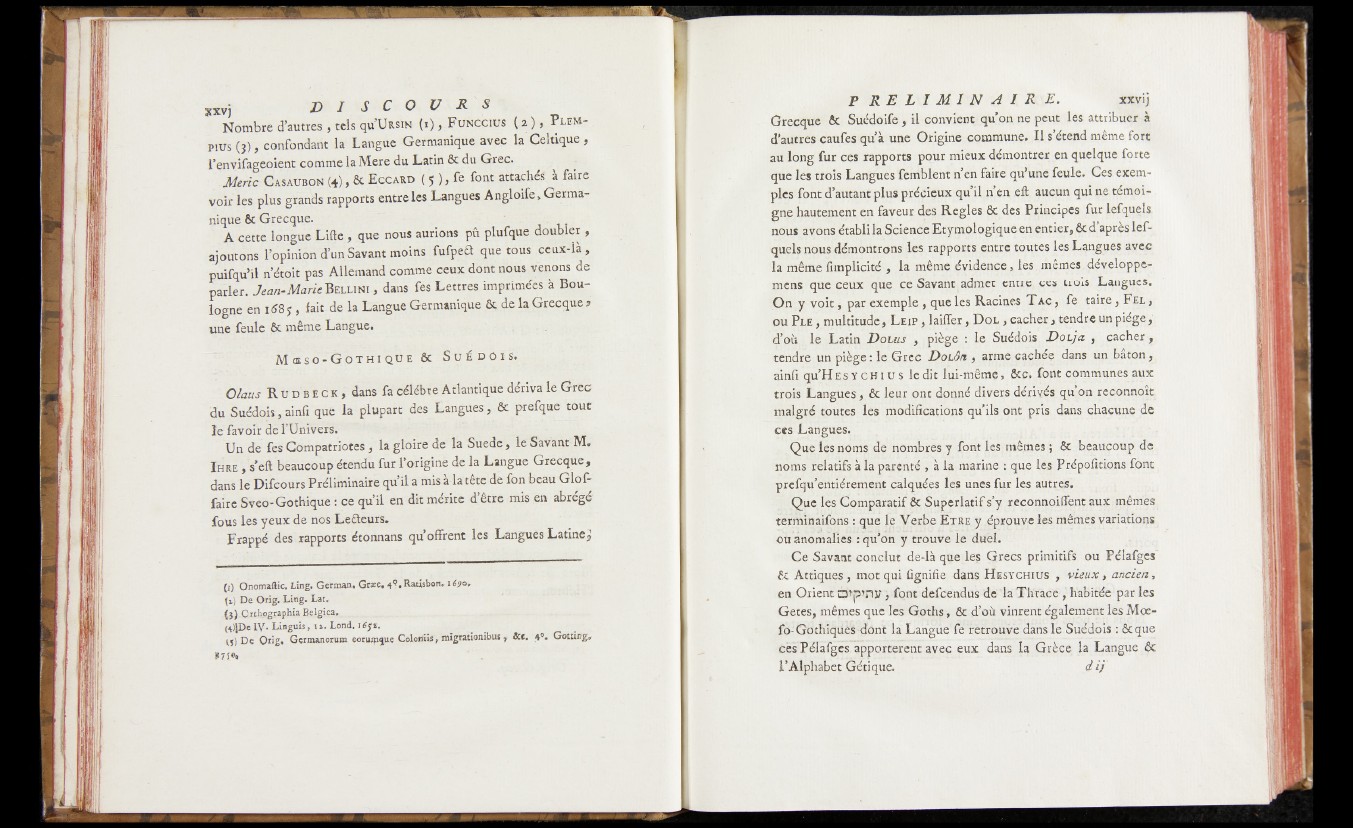
XXVJ D I S C O U R S
Nombre d’autres , tels qu’ÜRSiN (i) ,_Funccius fa ) | ^LENt'
pius (3), confondant la Langue Germanique avec la Celtique ,
l’envifageoient comme la Mere du Latin & du Grec.
Meric Casaubon (4), & Eccard ( 5 ), fe font attachée à faire
voir les plus grands rapports entre les Langues A ngloife > Germanique
& Grecque. , - . | g “f ‘ ;
A cette longue Lifte, que nous aurions pû plufque doubler ,
ajoutons l’opinion d’un Savant moins fufpeft que tous ceux-là ,
puifqu’il n’étoit pas Allemand comme ceux dont nous venons de
parler. Jean-MarieBtLLim, dans fes Lettres impriméesjà Boulogne
en 16S j , fait- de la Langue Germanique &, de la Grecque 9
une feule ôt même Langue.
M OEso-G othique & S u é d o i s .
JOlaus R udbeck, dans fa célébré Atlantique dériva le Grec
du Suédois, ainfî que la plupart des Langues , & prefque tout
le favoir dé FUnivers.
Un de fes Compatriotes, la gloire de la Suedé , le Savant M.
Ihre , Veft beaucoup étendu fur l’origine de la Langue Grecque,
dans le Difcours Préliminaire qu’il a mis a latête de fon beau Glof-
faire Sveo- Gothique : ce qu’il en dit mérite d être mis en abrégd
fous les yeux de nos Leâcurs.
Frappé des rapports étonnans qu’offrent les Langues Latine £
(1) Onomafiic. ting. German. Grase. 49.Ratisbon. \6r>,
(1) De Orig. Ling. Lat.
f}.).Qr£jy!grapWa Belgica.., j J
(4^DeIV. Liaguis, **• Lon&.riji. ~
U) De Orig. Germanorum eorujp^ue Coloöüä, migrauonibus, &e. 4°. Gotüifg»
P R E L I M I N A I W jL xxvij
Grecque & Sdédoife , ^il<qönyientiijiwlälr#e peut les attribuer à
d’autres caufes qu’à une Origine commune. Il s’étend m|me fore
au long fur ces rapports pour mieux démontrer en quelque fqrte
filé les trois'LanguesTemblenîtfén fàiré qu4me feule. Ces exemples
font d’autant plus précieux qu’il n’en eft;i queun qui ne témoigne
hautement en faveur deîî.Regles & des Principes fur lefquels.
nous avons établila Science Etymologique en entier, 6td apres lefquels
nous démontrons les rapports entre toutes les Langues avec
la même fimplicifé , la même éyi^epee ^ jés ^inêmes^éyeloppe-
mens que ceux que fce Savant-,admet en«?, ces,trois Langues.
On y voit., par exemple, queues Racines T ac, >|^ taire, Fel,-
ou Ple , multitude, L eip ^laiffer, Dol ^ cacher, tendre unpi^gq,
d’où., le ,Latin D olus , piège : le Suédois Dohja , cacher-,
tendre un piège : le Grec Dotôn , arme çaçhéç dans qnrMtfn',
ainftqu’H E*&,y ch 1 le dit lui-même, &C* forit commîmes aux
trois Langues, & leur ont donné divers déjciyé^ qu^oureconnqît
malgré toutes les modifications qu’ils ont pris dans chacuns de
ces Langues.,
Que les noms, de nombres y font lesfipêpes ; & b,eau,çoup de
noms relatifs à la parenté , à la marine : qu.e les Prépofi tionsfpnt
prefq^entièrement calquées les unes fur les autres.
Que lès* Comparatif & Superlatif s’y reconnoiffçnt.aux memes
terminaifons : que le Verbe Etre y ^prouve les mêmejs variations
ou anomalies : qu on y trouve le dubl.
Ce Savant conclut tferlà qq.e le§ ^r-éôs primiifs ou Pélafges
.& Attiques, mot qui ûgnifie dans Hesychius , vieux > ancien,
en Orient Ôfp»Fiy,-'}dfât défôèndüs dë'la ThŸàéé3,“habitée par les
Getes, mêmes que les Gothg, & d’où vinrent également les Mge-
fô- Gothiques dont la LahgueTe retroùve dâns le Suédois : Ôcque
ces Pélafgès apportèrent avec eux dan$ la Grèce la Langue êc
1* Alphabet Gétique. A * lî