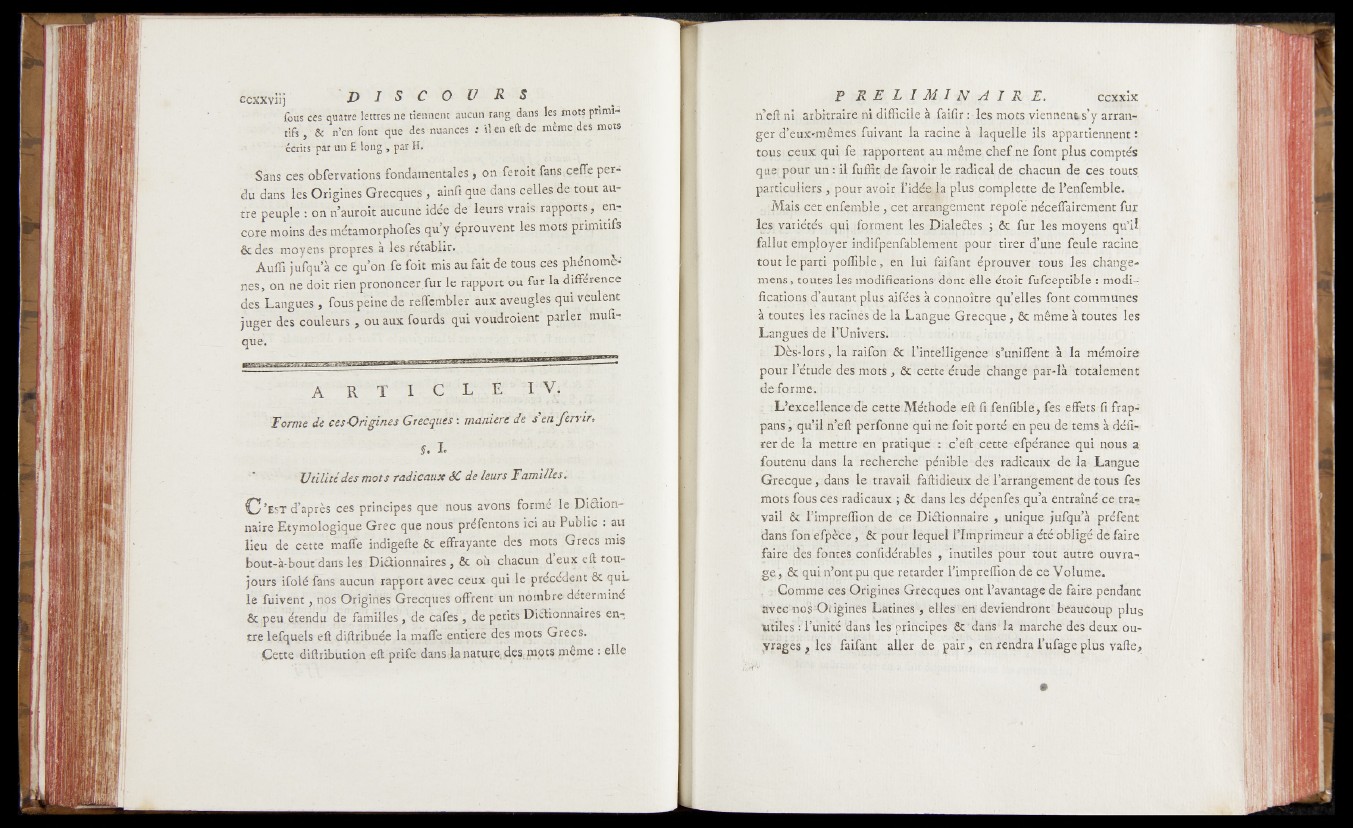
ecxxviî) D I S C O U R S
/ 'fous êfesi quatre lettres né tiennent aùcùrt rang dans les inot$ primitifs
n’earfoat' que dës'nuances : il-en eft-de-même.des mots
' '&kits"|>àT ünvÈ kjng ', pat H.
Sans ces observations. fondamentales * on ferait fan? «çeffe perdu
dans lès Origines Grecqües-, ainft que dans celles de tout autre
peuple’: on n’auroit âücunè idée de leurs:vràis.rapports^.en-
cpre moins des;nï,étan?prphofes,qu y éprouvent les mots primitifs
Auffi jufqu^ ce qu’on.fe foit rais au fait de tous ces phénomè-’
nés, on ne doit rien prononeer.fur le rapport du fur la différence
4es. Langues, fous peine de reffembler aux aveugles qui valent
juger des couleurs , ou aux fourdsi'ÿïî voudrômnt' parlëi: {mpfi-
qUe.
A R T I C ; L È. 'J : î :/Vf ' |
Dorme de ccs-Origines Grecques : mdrtierè dt s en 'jervir»
§. L
Utilité des mot s radicaux SC de-leurs Familles.. .
O ’est d’après ces principes que nous, avons focine de
naire Etymologique Grec que nous préfentons ici au Public' : au
lieu de cette maffe indigëfle & effrayante des mots .Grecs mi«
bout-à-boutdans les Dictionnaires, & où chacun d çuÿ eft toujours
ifolé fans aucun rapport avec ceux qui le précédent •& quL
le fuivent ,.n6sOrigiriës Orecqù’éâ offrent’Un nombre déterminé
& peu. &endu ^e.^f^ulïes^-âie' cafés , de petits Dictionnaires entre
lefquejs eft diftyibuée .la.maffq entière des.mots Grecs.
Gette diftribution e&pâfe danSijâ natufeidiçSi^qts piêpae : elle
P R E L I M I N A I R E . ccxxix
n’eft ni arbitraire, ni difficile à Jaifir ; -.les, mots yiennen^s’y arranger’d’eux
mêmps Suivant, la racine à laquelle ils appartiennent *
tous ceux qui, ïfe rapportent au mêpae,chef j^e, font plus comptés
que^pour un : il defiyoir fe, radical de chacun çleçes touts.
particuliers.,^pour .avoir l’idé^Ja plus complette de l’enfemble.
.a^y^ais cet.enfemble-,, cet arrangement repofé néceffairemènt fur
les-variétés qui jforment les Dialectes,. ;,êt fur les moyens qu’il,
fallut-employer indifpenfablement ^pour tirer d’une feule racine
tout le parti pofTible^ ;en lui faifant éprouver.-tous les .chànge-
mens.,;toutes les ■ modifîcaiidhs'uont elle étoit fufceptiblé : modi-;
ficarionsf d’autant plus aifées à çpnnoître .qu’elles font communes
à toutes les racine? ne la Langup Grecque, Ôc même à toutes les
Langues ‘dêilüjfilvdrs.. .
£. jpè?-lorsla raifohi .ôc l ’mtelligende’'!s’unid’ent à la mémoire
pour;lJétude; des mots, & cette étude changé par-là' totalement
deiforme. îj
| L ’excelknce’de cette.'Méthode ;eâiii;fenfiblè j f©s effets fi frap-
pans , qu’ilhei3; përfonne qui ne-.faitporté;en peuî-deitems àc déft-.'
rer de la mettresen pratique : c. eft ecefcte-efpérance qui nous a
ibutenu dans la recherche pénible ^des radicaux: dû la* Langue.
Grecque,; dans le travail, faftidieux dé l ’arrangement de tous fes
mots fous ces radicaux ; & dans lçs-.dépenfesqu’a entraîné ce trar
vail & l’impreffion de ce DiQionnaire y unique jufqu’à préfent
dans fortéTpëéë, ôëpout lequel l’Imprimeur a été*obligé de faire.
faire des fontes confidérabfes , 'inutiles pour tout autre ouvrage,
*, ôc qufn’qn t puique retarder rirriMCpoudê^e Volume; **'
11 Gomme ces Qrigi-nes!Grecques ont l’avantage de faire.pendant
avecmos-Otigines Latines*y elles? ten deviendront- beaucoup plus
Utiles :Tiinité dans les principes ôt 'dàfis la imafrche’ délidëux. ouvrages
î les faifant aller de. p a ir ë n rendra l’ufage plus vafte.