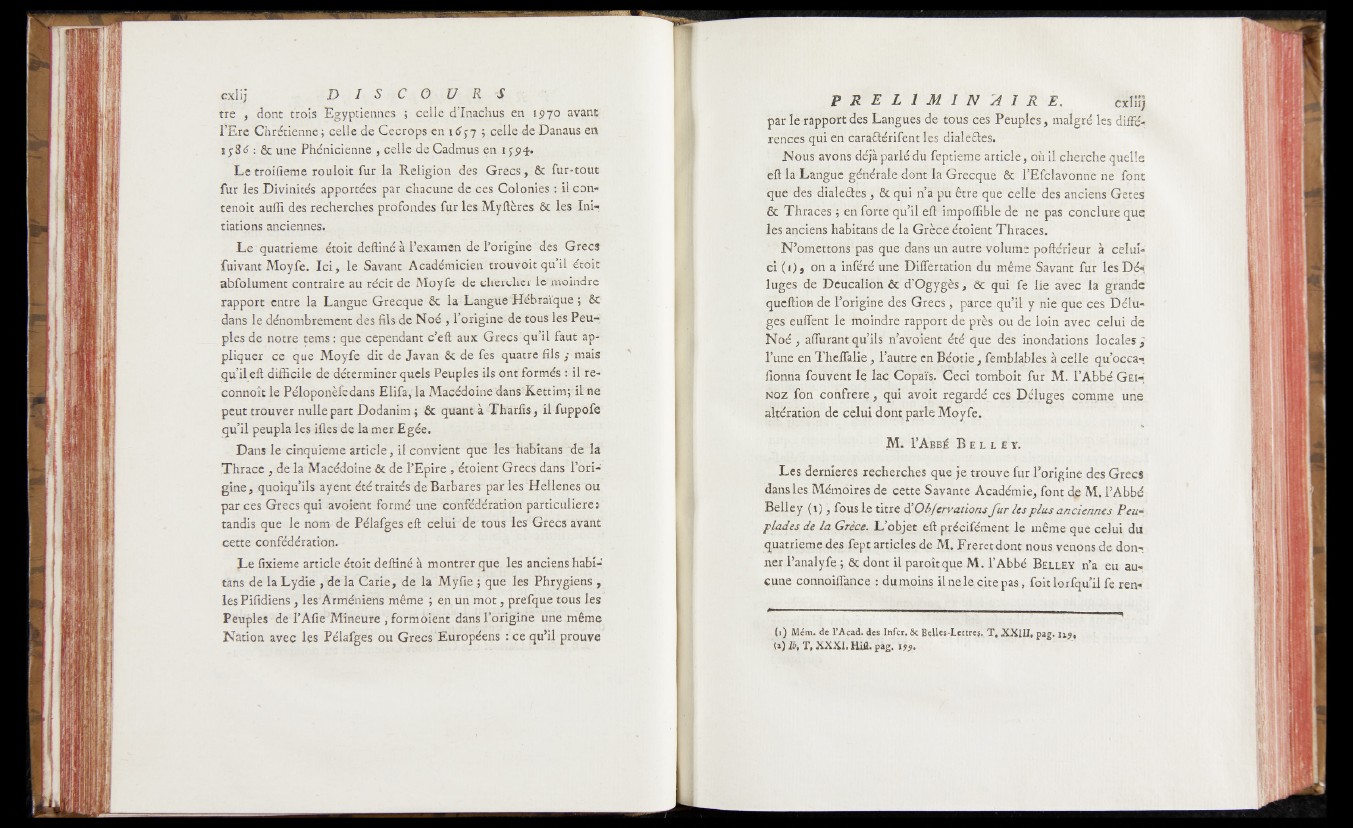
cxlij D I s C O U R -S
tte , dont trois Egyptiennes ; celle d’Inachus en 1970 avant-;
fEre Chrétienne; celle de Cecrops en i£y7 ; celle de Danaus en
1 y 8 6 : & une Phénicienne , celle de Cadmus en
Le troifieme rouloit fur la Religion des G r e c s & fur-tout
fur les Divinités apportées par chacune de ces Colonies : il con-
tenoit aufli des recherches profondes fur les Myftères ôt les Inir
dations anciennes#
Le quatrième étoit deftiné à l’examen de l’origine ' dés Grecs
fuivant Moyfe. Ic i, le Savant Acàdémicientrouvoit qu’il étoit
abfolument contraire au récit de Moyfe de chercher le moindre
rapport entre la Langue Grecque & la LangUe'ifébrâïque ; 6c
dans le dénombrement des fils de Noé , l’origine-de tous les P eu-;
pies de notre tems : que cependant c’eft aux Grecs qu’il faut ap^
pliquer ce que Moyfe dit de Javan & de fes quatre fils y- friais
qu’il eft difficile de déterminer quels Peuples ils ont forMés "v il re-
connoît le Péioponèfedans Elifa, la Macédoinedans-Rettimpl’fre
peut trouver nulle part Dodanim ; & quant- à -Tharfis, il fuppofe
qu’il peuplades ifles de la mer Egée.
Dans le cinquième article, il convient que les'haBhafts^de la
Thrace , de la Macédoine & de l’Epire, étoient Grecs dans l’Origine
, quoiqu’ils ayent été traitésdeBarbares par les Hellenes'ou
par ces Grecs qui avoient formé1 une cofrfédéradon“ particulière » ‘
tandis que le nom de Pélafges eft celui de totis leS'Grecs avant
cette confédération.
Le fixieme article étoit deftiné à montrer que. les anciens habi-
tans de la Lydie ,d ela Carie, de la Mÿfie; que les Phrygiens ,
les Pifidiens, les'Arméniens même ; én, un mot, préfquë tous les
Peuples de l’Afie Mineure , for m oient dans l’origine une même
Nation avec les Pélafges ou Grecs‘Européens : ce qu’il prouve
P R E L I M I N A I R E . cxlîi)
par lé rapport des Langues de tous ces Peuples, malgré les différences
qui éh; câraâérifent les dialeâes.
Nous avons déjàparlédù feptieme article, où il cherche quelle
eft la Langue géhérale dont-la Grecque & l’Efclavonne ne font
qué des diale&ès , & qui n’a pu étiré que celle des anciens Getes
fierté1 qù’il efMfripbffiBlé dé ne pas conclure que;
les anciens habitans de la Grèce étoient Thraces.
' N ’omettons1 pas que- dfrrfsmn autre'volume poftérieur à celui-;
ci f?) j on à "'inféré une Diffèrtadbn du même Savant fùr les Dé^
luges de Deucaïion & d’Ogygès, & qui fe lié avec la grande
qûeftion de l’ori^ïnëdés Grecs ; pdrcë qu’il y nie que ces Délïi-
ges'enflent. le moindrè 'rappôrt dé près ou de loin avec celui de
Noé , aflurant qu’ils ft’aVoîent été' que des inondations locales y
l’une én.ThcfTalie, l’aqtre çn jBéotie, fémblables à celle quoeça-»
fionna fouvent îç lad Cbpâïs/Ceci hîmÉoit fur M. l ’Abbé Gei-;
noz fôn cohfrerç, qui avoit regardé ces Déluges comme une
altération de celui dont^parie Moyfe,
M. I’A bbé B e l l e t .
Les dernieres recherches que je trouve fur l’origine des Grecs
dans les Mémoires de cette Sayante Académie, font dp M. l’Abbé
Belley ^ ) g fous le titre à’Oè/^atiansJur les plus anciennes Peu
plaies de la Grèce. L ’objet eft précifément le même que celui du
quatrième des Jept artjclesde M. Freret dont nous venons de donner
l’anal yfe ;. ôt dont il paroîtque M . l’Abbé Belley n’a eu aucune
connqjlfançedqn\oins ilnele-oitepas, foitlorfqu’il fe ren-
(ij Mém. de l’Acad. des Infer. & Belles-Lettres. T, XXIII, pag. t ÿ i
(a) Ib, J, XXXI. Hifl. pàg. x??.