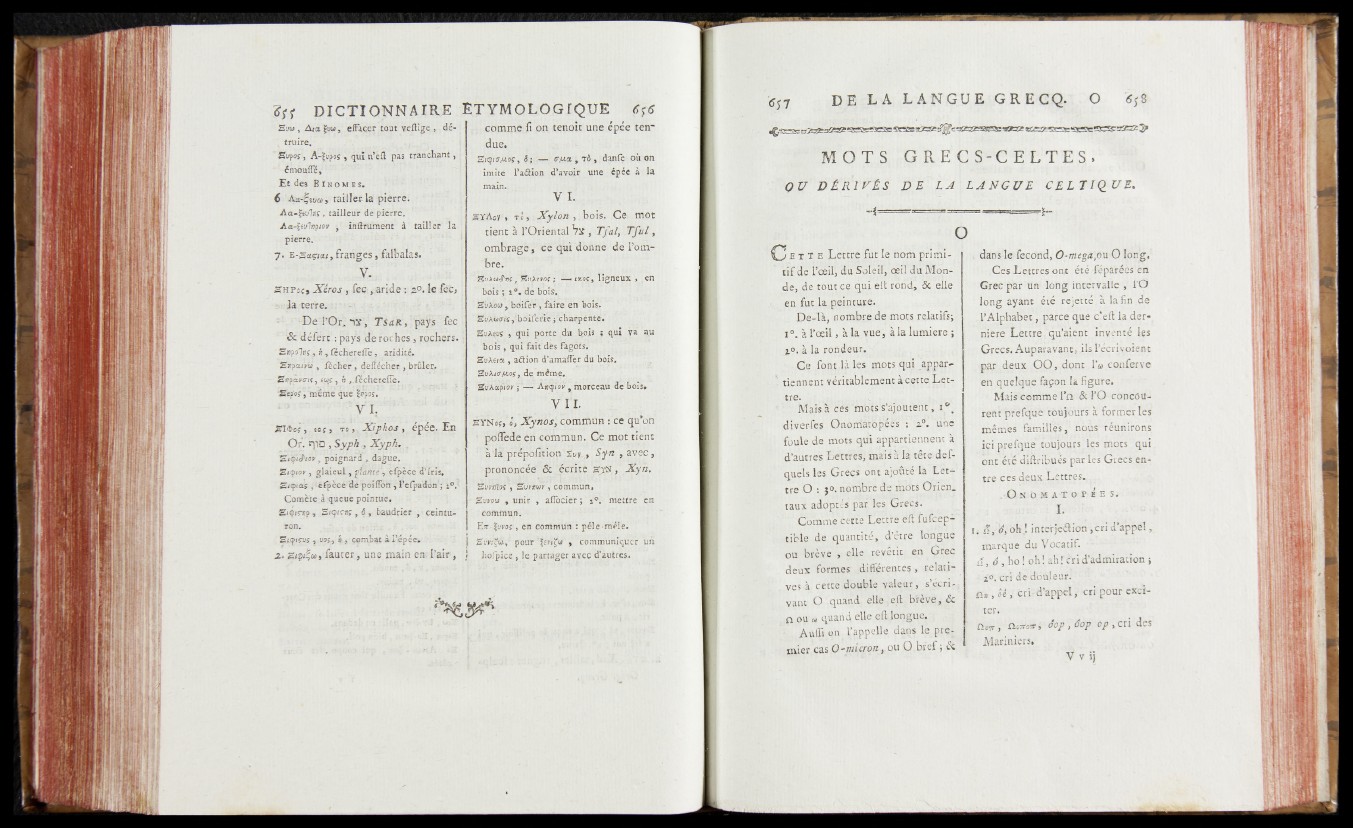
S u a , Ai<* |u u , efFaçer tout v.efiige , dé- t
't'trulréj* ■ ■
~Supor, pa$ trânChjuit, j
‘ émoufiey'
E t des B f s o m e s. '•
6 ra&létlà-pièrfe; < |
Aa-Jso7nî y tailleur dë?ptyree;‘ ™
A*-|su7»pjoi' «! inïlrumeflt à tailler' la
- pierre.' H
7. E-Saç’/a/, franges ,'falbalas. |
3HPofi X ê ro s :X feç-.y.aride t 2 ° . le fèc,
; Ja ter re.::."
Dé l’Or; *i2f, T saR , 'paÿi fec
’ ASc aéfêkt : p|j% de roches'* rochers.
E»po7»r,, S, lecherefle, aridité.
Snpcuru , ie ch er, defîéçher , brûler. .
£»pâr<ric, e« j, $ ..lechec/eflc,
“Sefoi , ‘même qiïe'fijpof. ’.
VI.
£i<î>oç , , e»ç’, To , t X ip h o s , épée. En
Or. rjiD , Syphp X yp h. |
'Sicpic?!o>') poignard , dague.
. Si(pioF , glaïeul, ^îantè\hCpècé d’ ïris.
S/qwdts péfpècédè poilToh', Feïpa’dolf; i 0S
Comète ;à queue pointue,
Ëitpirup , Snp/STif , 4, baudrier , ceinturon;
Énpsss ,.hoî, f.,-combat à-I’épçe'. •
z- a?^a>, fauter, une main en- l’air', i
il comme fi on tenait une épée ten~
due. |
Biÿurtuc, » t4 ,, danfç où on
• ■ inàitë l’aâipn d ’avQiïi une épée à -Jà
’ main-. • ,>
- v i , :
sr&oy-, rè> X y lo ji, ; bois-. Ce mot
tient à fQrièhtal .^f»/,
. ombragé ; c ë ’qui "donne ‘dé rom-
' bre.
V.èn
■ ««déïfb'&î' & ■
' Sw®tâ/bdira%fâlfe ~
~ £ uàùu&-j7bdifëCre ; *cti'arp ê Ht e,' g ~
va é^u
bois Vqui faïndfcsïagoîs?, ■
SuA«a , aâion d’àntafler du bois, f ; ;
SuXnrAtos, de. mêrne,
SdXapiar j Aïrcpïflv A bfcèau 3e1 bois»
S rNssj’oj X yn o s, comrfiun fee gü*cfu*
f pdffede èn commun. Ce mot tient
f^'à 'Iâ> prépbfftipn'iuï^,1 S y ri , avec,
. ^prononcée & écrite SyS., X yn .
SvviftoiSvvaar , commun, •
• Suroa unir-, aflbcîcl; ; ‘ Metriê en
f commun. -
Err-.luros , en commun : pêle-mêle.
Sùvi^tSi,* pour 'fyivï'^à , 'Commun!ojucr pn
liolpice , le partager avec d’autres.
m m
^sssssa^aEnsæHOEseasssseBssjeæn^eeiazesaeasiesoe teeaa-aessroescsrseazzeÿ
M OT S GRE C S-CELTES,,
QU D ÉRTFÈS DE EJ_\LA NGUE CE LT IQ. UE.
O
C y JE t T e jLèttre fut Iq nom primi-^
tfif dé^oeiÇ du Soleil, oeif du Mon-
. de,.de tout çe,qüi efi: rond, & elle
en fùt.la.^intiurç.
De-là, sombre de mots relatifs;
t? . à l’oeil > à la vue, à la lumière ;]
i°. à la rondeur,.,-' ^
. Ce fon,çflà les ipots qui appar-
j t^énuent véritablement àoette ^ t -
Mais.,! cés ',mo^!s’Mbutbrit, i ".
dîverfes Onbrriâtôpees' : ’i° . une
foule de mots qui appartiennent à
' d’autres Lettres, mais à là têtodef-
quels les Grecs ont ajoûté la Let-r
tire O : $o. nombre de mots Orien,
taux adoptés par les Grec s. '
' Comme cette Lettre èff fufeep-
tible de quantité, d;être Iqngùé
ou ■brève ÿr^te ,;e.rètï^ en ttr^eq
1 „ deux formes' différentes r;ela t i-
vesà. cette double valeur, s!^:ri-
! vanc O '.quand elle eft brève, &
n ou m quand elle e ftlo ngue ig' ,
• Auffi on l ’appelle dans le pre-
mist cas Q ^ v iifT o n ou O b re f, âc
< dans le fecOnd, O-megd,ou O long.'
r J ; Ce s D ettres ont été •fépârees,èn
Grec par tin long intervalle , l’O
: lo n g ayant été rejette', a la fin de
rA lp h abe t ; parce qnç c’eft la d e r -
liière Le ttre . qu’aient inventé les
i Grec s . Auparavant, ils l’écrivoient
par deux O O , dont § i ’® conferve
en quelque façon la f ig u re .. •
Mais comme l’n. & l’O-concOU-
rent préfquè 'toujours à former les
mêmes familles r nous réunirons
iç i prefque toujours les mots qui
ont été dîftribues par les Grecs en-
; : i riSMes dlt^KfesUv ■ i
,-..Q N.m M AT OP É E S* : ■>
I.
i , iÎ j O, oh.! interjèélion ,c rid ’appel,
marque du Vocatif.
d , o , ho ! oh ! ahî'éri d’admiration ;
2°. cri de dbûjeur; • ■ ;
fi» , ôé, cri'-d’a p p e lc r i pour exci-
gM6er^j*i
Osît , cievo* i ■ ôop | éop o p , cri des
Mariniers.
Y ï i j