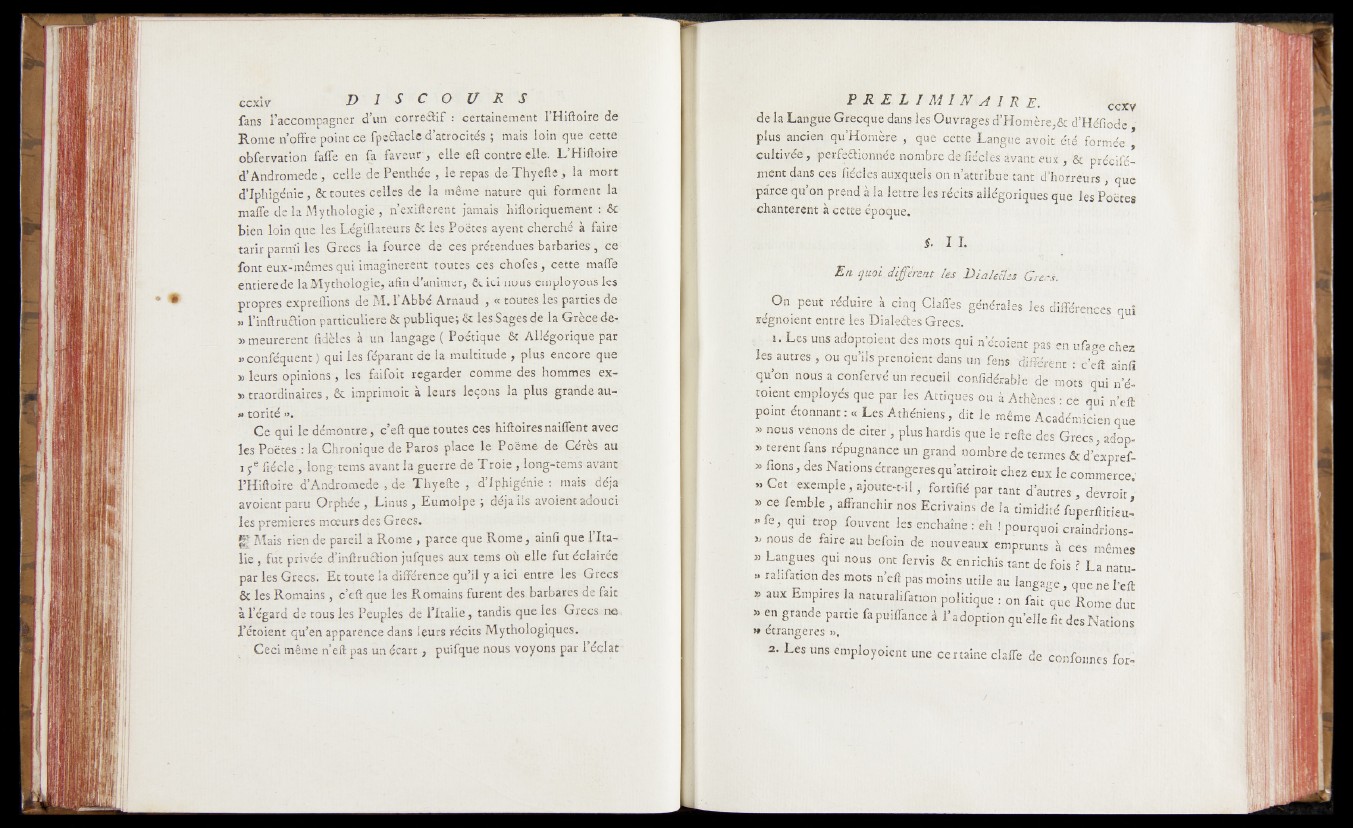
ccxiy D I S C O U R S
fans raccompagner; ,d’un correctif : certainement l’Hiftoire de
R om e -nofee'point ce fpe&acle d'atrocités,; mais loin-que cette;
obfervation falFe en % faveur, elle ;eft contre elle'. L ’Hiftoire
d’Andromèdei, celle.de Penthée g le repas de-Thyefte, la mort
d’Iphrgénie, & toutes:celles de la mêrae-iftatuTè qui ferment la
maffe de la Mythologie-, n’exifterent jamais hifloriquement : &
bien loin que. les 'Législateurs ôc les Poëtes ayënt cherché à faire-'
tarir parmi les Grées la four ce de ceS prétendues? barbaries-, fee:
font eux-mêmes qui imaginèrent toutes-ces cfrofes, cette maffe
ehtierede laMythologie, afin d’animer, & ici nous employons'les
* * propres exprëffions de M. l’Abbé Arnaud , « toutes les; parties "de
» l’inftruftion particulière & publique;'& lestages de la Gîrète.ede-:
» meurerent 'fidèles à un langage ( Poétique &- Allégoîiqife par
conféquent ) qui les féparant de la. multitude*, plus encore que'
» leurs opinions;:, les; faifoit regarder commo des hommes extraordinaires
, 6c imprimoit a leurs leçons la plus grande au-
»» torité
Ce qui le démontre, e’eft que toutes ces hiftoires naiffent avec
les Poëtes : la Chronique de Paros place le Poëmê-de Gérés-au
i y e fiéclq^rlong tems avant la guerre de Troie jdoftg-teml^avaiïc:
PHifioke-d’Androinede^cle Thyefte ; il’Ipbiggnte»* m a is^ j4
avoient paru Orphée, Linus, Eumolpe ; déjà ils avoïëht-adouci"
les premières moeurs des Grecs.
g Mais rien de pareil à Rome, parce que Rome, ainfi que l’Italie
, fut privée,d’inftru&ion jufques aux terns où elle fut éelairée
par les Grecs. Et toute la différence qu’il y a ici entré les Grecs
& les Romains , c’eft que les Romains furent des barbares de fait
à l’égard de tous les Peuples de l’Italie , tandis que les Grecs rue
rétoient qu’en apparence dans leurs récits Mythologiques.
Ceci même n’eft pas un écart, puifque nous voyons par 1 éclat
R R E L I M i m A l K E . CCxv
delà LangueGîrefcqqeldans les Ouvrages d’H om è re ,& d’HéfioHe
plus ancien qu’Horaère , que cette Langue ayoit été fo rm é eS
cultiyé'ef, I p e r t e s n a é e ip d fm e d é b i t s 4 v À eux , -& pxécifé-
ment dans èés'-fié^les1 auxquels-on*-|’atèibué'.tant d’horreurs , que
4u’0li Prend a la-lertrëdès-rédts 'allégoriques q u e les Poëtes
-chantèrent à cettfe é p o q tie |i|f
S I L
En quQkdt§èfent:les' Dialicfes Crées,"
On peut réduire a ’d n q Claffes géttl/ales ’^ d if f é r e n c e s qui
régnoient ençré les D ia ^ ^ |G re eS .‘- ' 1
5 M Les uns’.adoptçient d^jast&qyi n’éfoient pas en ufage chez
les autres, ou qu’ils prenoienc dans un fens ^iféxtht ic e ft ainfî
qü^)h nous a confervé un fecueil confidérabld de^mdts qui n’é-
tpient empîo^îque par les “. f c ^ ù e s o u ^ qu; n>eft
pomt étonnant t « Les Athénien^,! dit •le'même Académicien que
» nous vendis de citer , plus hardis-que le' rendes' Gréés-, adop-
» térent fans répugnance un-grand , nombre de termes & d’expref-
» fions, des Nations étrangèresqu’attiroit chez eux le commerce:
” Cet excmPle | aj0ute-t-il, fortifié par tant d’autres , devroit:
»ce femble, affranchir nos Ecrîvams'dë la timidité fuperftirieu-
” fè j qUj tr°? Auvent les enchaîne eh Jïpéuiquoi craindrions-
i» nous de faire au befpin de nouveaux emprunts ^- ces mêmes
» Langues qui nous ont fervis & enrichis.tantçjéfpjs ? La natu-
« ralifatio'n dès mots n’ell pas moins utile au langue', quene l’eft
* aÜX EmPiresla «aturalifation ,PolifiqUe ^ n fait die Rome dut
» en grande partie fa piiiffànce à l ’adoption qu’elle fit des Nations
» étrangères ».
a. Les uns employoient une c e rta in e claffe de confoimès fol