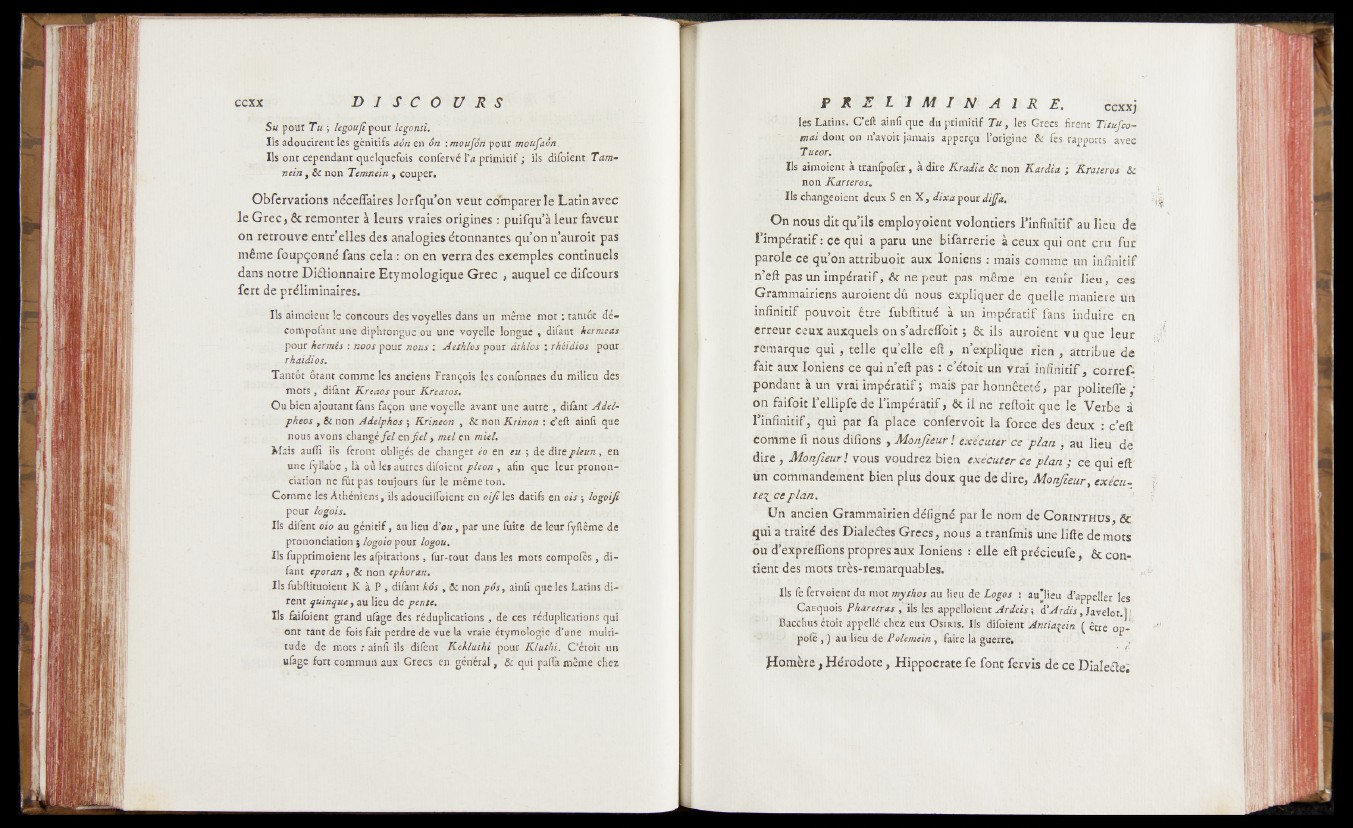
ccxx D I S C O U R S
Su pour Tu ; legoujî pour le gond.
Iis adoucirent lesgènitïfs don en èri : moufén pour moüfaô'n.
Ils ont cependant quelquefois çonfèryé Va primitif ; il? .difoient Tam-
nein , &'nôn Temneint couper.
Obfervations néceffaires lorfqu’on veut ccfffl parer le Latin avec
le G re c ,& remonter à leurs vraies origines : puifqu’à leur faveur
on retrouve entr’elles des analogies étonnantes quon n’auroit pas
même foupçoané fans cela : on en verra des exemples continuels
dans notre Dictionnaire Etymologique Grec , auquel ce difcours
fcrt de préliminaires.^—
Ils âimoient !e concours des voyelles dans ün mêmemo t .fàfrtot dé-
• ■ compofânr.urie diphtongue'ou une voyelle' longue j- cfiGinr kermeas
pour kermès : noos puùr nous Aethlos pour âtktoàçtfT
s — haidios.
Tantôt otant comme les anciens Franççis les confonnes du milieu des.
mots , difànt Kreaos ÿoxxt Kreatod. "
Ou bien ajoutant fans façon une voyelle avant une âutrè4, difand!î^&?-
pheos , & non Âdelphos ; Krineon , & non Krinon : c’eft ainfi que
nous avons changé en fiel, mil en miel.
Mais aufli ils feront obligés de changer éo éjn eu -, &éâÀïg_pUun ,,en
une fÿllabe, là où les autres difoient pteon , afin que leur pronon^
dation ne fut pas toujours fut le même ton. *
Comme lés Athéniens, ils adoucilfoient en oijî les datifs en ois ; logoijî
pour logois.
Ils difent oio au génitif, au lieu à'ou, par une fuite de leur lÿflême de
prononciation 5 logoio f ont logou.
Us fùpprimoient les afpirations, fur-tout dans les mots compofés, di-
fânt eporan , Si non epkorah.
Us fubftituoient K à P , difànt kos , Si non pôst ainfi que les Latins di-1
rent quinque, au lieu de pente.
Us fàifôient grand ufàge des réduplications, de ces réduplications qui
ont tant de fois fait perdre de vue là vraie étymologie d’une multitude
de mots ; ainfi ils difent Kekluihi pour Kliifhi. Çjétoir un
ufàge fort commun aux Grec's ën général, Si qui pàflà même cbes
P R E L 1 M I N A I R E . ccxxj
les Tarins. C,èft,ain‘fi!que du prirâStlf Tu, fl‘êâ Grecs firent Titufco-
mai. dont on nayoiîvjamais apperçiiil’origmé kriTès rapports avec
» TueQT.
Us âimoient■ à tranlpofèr, à,dire Kradia. Sc non Kârdia ; Krauros Si
noq Kàrteros.' 5'
■ Ils.çha'hgêoiënt deux S en X, dix a pour dijfa.
On nous dit qu’ils employoient volontiers l'infinitif; au lieu dé
Fimpératif : ce qui a paru une bifâ^rerie adieuxtjüi ont cru fùr
parole ce qu’on attribuoit aux Ioniens, : mais, comme uri infinitif
n’eft pas un impératif, & né peut pas même en tenir"'lieu, c t i
Grammairiens auroiênt dû nous 'expliquer de quelle minière üri
infinitif pouvoit ’ |tre ^übfiïtué ' a un-^pèratiffïans m'dtiire^ëïi
erreur ceux auxquels ons’adreffoît ; & ils auroiênt vu bue leur
remarque q ui, telle quelle e ft, n’explique rieh , attribue de
fait aux Ioniens cë qui n’eft pafc
pbndànt à Ün vrai impératif ; mais paf hoû’riêtèté / par politeïTe ,'
on fâifoit reilipfé dè l’impératif, & il ne xeffoit qüê1 le VerBe à
1 irinhîtff,qu i p arfà place cônfervoit lk force des deux i c’eff
Cômrfié'ifi rü^tK-^ilohS’, 'M ôhjùatïexéektâèe lptdn *l£u: de1
d ire, Monjhur! vous voudrez bien exécuter ce ? f a ÿ ^ 0qMeÛr
un commandement bien plus doux que de dire, Mbnjïeur\ exécute^
ce [plan.
Un ancien Grammairien déiigné par le nom de Corinthüs, &
qui a traité des Diale&és Grecs, rious a tranfmiS une lifte de mots
ou d’éxpfeflionfc prèpres aüx IoniênsVellè eft préçieufe, & contient
des'üïbts ‘très-remirqûables.
Ils fe feryoientdu mot wy/éo^aulieu de Logos : au^lieu d’appeller les
CàE^qois Phâret'ras , ils J|s' appâlo^ën^ Ardei* ; SJrdisy Javeiqt.1)
| Bacchus étôifàppëllé^chyz1 eux OsiRts. ;Ils dîfoieht Aniia^ein ( être 0p-°
' pofe p) àùdiVù dë^ Poiemein, faârëila guerre;*
Jlomère, Hérodote, Hippocrate fe font fervis de ce Dialeétei