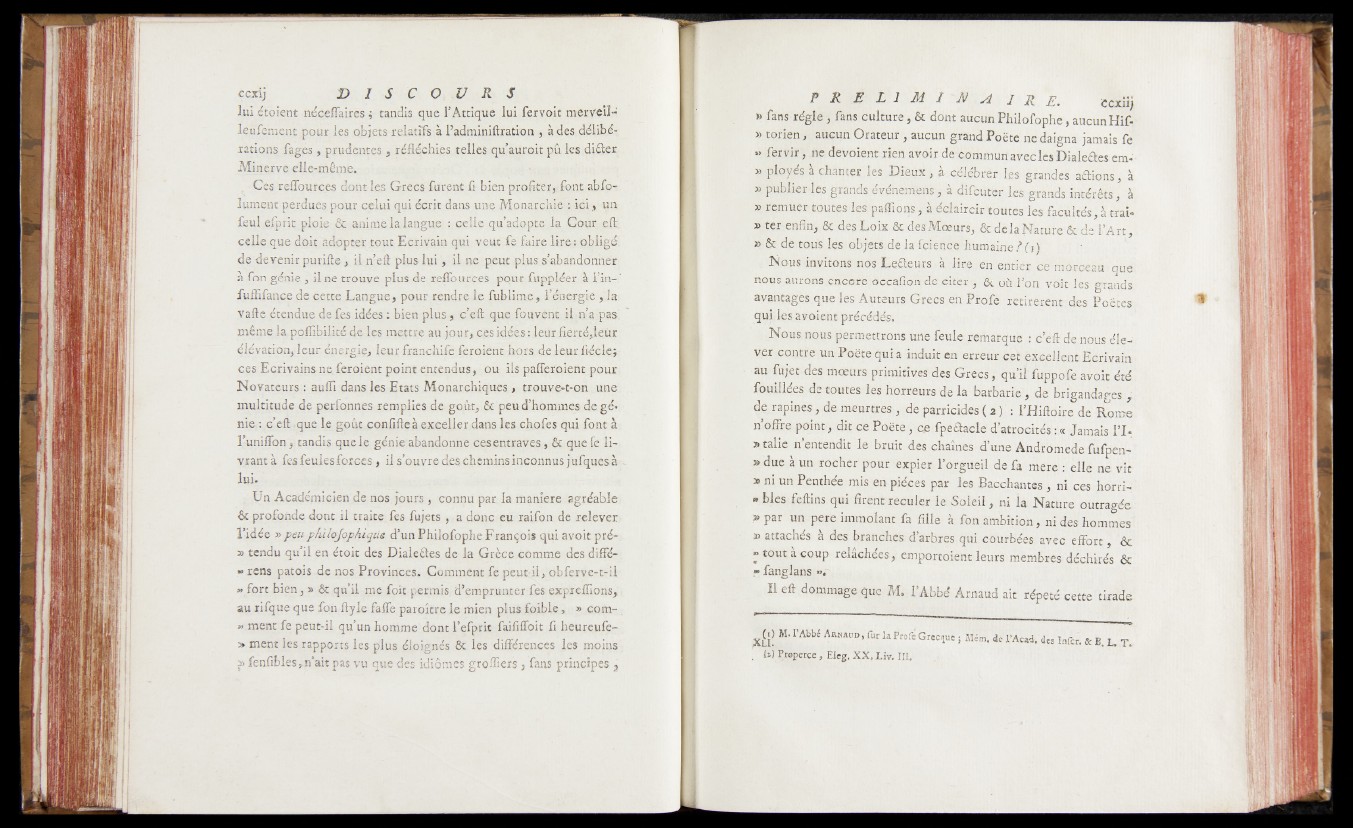
çcxij D I S C O U R S
lui éfoient néceffaires ; tandis que l’Attiqué lui fervoit merveil-
leufement pour les objets relatifs à l’adminiftration , à des,délibérations
fages , prudentes , réfléchies telles qu’auroit pu les diéter.
Minerve elle-même.
, Ces reffourc.es dont les Grecs furent fi bien profiter,.font abfp-
lument perdues pour celui qui écrit dans une Monarchie : ic i, un
feul efprit ploie & anime la langue celle qu’adppte la Cour eft
celle que doit adopter tout. Ecrivain qui veut fe faire lire: obligé,
de devenir purifie , il n’efi plus lui , il ne peut plus s’abandonner
à fon génie , il ne trouve plus de reffourçes pour fuppléer à l’in- '
fuffifance de cette Langue, pour rendre le fubliqte, l’énergie j la.
vafte étendue de fes idées : bien plus , c’eft que fouvent il n’a pas
même la poffibilité de les mettre au jour, ces idées : leur fiertéfieur
élévation, leur énergie, leur franchifê feroient hors de leur fiécley
ces Ecrivains ne. feroient point entendus, ou ils pafieroientpour,
Novateurs : aufli dans les Etats Monarchiques » trouve-t-on une;
multitude de perfonnes remplies de go.ût, & peu d’hommes de géy
nie,: c’eli.que le goût confifte à exceller dans les chofes qui fofitrlL
l ’uniffon tandis que le génie'abandonne ees entraves., & que fe livrant
à fes feules forces, il s’ouvre des chemins inconnus jufquesà
lui.
; Un Académicien de nos jours , connu par la maniéré agréable
& profonde dont il traite fes fujets ? a donc eu raifon de relever)
l ’idée »peitphilojophiqüe d’un Philofophe François qui avoit pré-
» tendu qu’il en étoit des Dialeâes de la Grèce comme des diffé-
» rens patois de nos Provinces. Comment fe peut-il, obferve-t-ii
» fort bien, » & qu’il me foit permis d’emprunter fes expreffions,.
au rifque que fon ftyle falfe paroître le mien plus foible, » com-,
».ment fe peut-il qu’un homme dont l’efprit faififlbit fi heureufe-
» ment les rapports les plus éloignés & les différences les moins,
» fenfibles ,n; ait pas vu que des idiomes grofiîers , fans principes -,
P R E L 1 M 1 'N A I R E . ccxiij
» fans-régie, fans culture, & dont aucun Philofophe, aucunHif-/
» torien, aucun Orateur, aucun grand Poëte ne daigna jamais fe
» ferVirVmç dévoient rien avoir dercommurî avec les Dialeâes em-
» ployés à chanter les Dieux, à célébrer les grandes aftions, à
» publier les grands événemens , à difeuter les grands intérêts, à
» remuer toutes les pafiion|| à éclaircir toutes les facultés, à trai-
» ter enfin, & des Loix ôc dès Moeurs, & de la Nature & défi’Art,
» & de tous les objets de la feience humaine ? (j), ' > *
• Nous invitons nos Leâeurs à lire en entier, ce morceau que
nous aurons encore occafion de citer , & ou l’on voit les grands
avantages,que les Auteurs Grecs én Profe ■ retirèrent des Poètes '
qu-UeSravoien^précédés. |
«j Nous nous permettrons une feule remarque : c ’eft denou^éle-i
Ver contre un Poëte qui a induit en erreur ceb excellent Ecrivain
-au fujet des moeurs primitives des .Grêles, qu’if fu^pfeavoit été.,
fomllées^ Routes les horreurs de la barbariç, de brigandages,,
Rapines., de meurtres , de parricides (2 ) ': l’Hiftoire de Rome,
n offre,point, dit cê Poëte, qe fpe&acléd’atrocités':« Jamais i’I-
>talic n’entendit le bruit des chaînes d’une Andromède fufpen-'
» due à un -rocher pour expier l’orgueil de fa mere : elle ne vie
a» ni un Penthée mis en pièces par les Bacchantes y ni ces horri-d ~
» blés feftins qui firent reculer le Soleil, ni k Nature outragée.:
a» par un pere immolant fa fille à. fon ambition , ni des hommes^
» attachés a des branches d’arbres qui courbées avec effort, ôc
" tout, a coup relâchées y emportoient leurs membres-déchirés ôc
* fanglans ».
Il eft dommage que M. l ’Abbé Arnaud ait répété cette tirade
jx g ; M- rAbbé AKNiüD>rur la g j | Grecque ; Mém. de FÀcad. des Infer. & B. L» T .
L h) Properce , Eleg. XX, i iy i . l jS