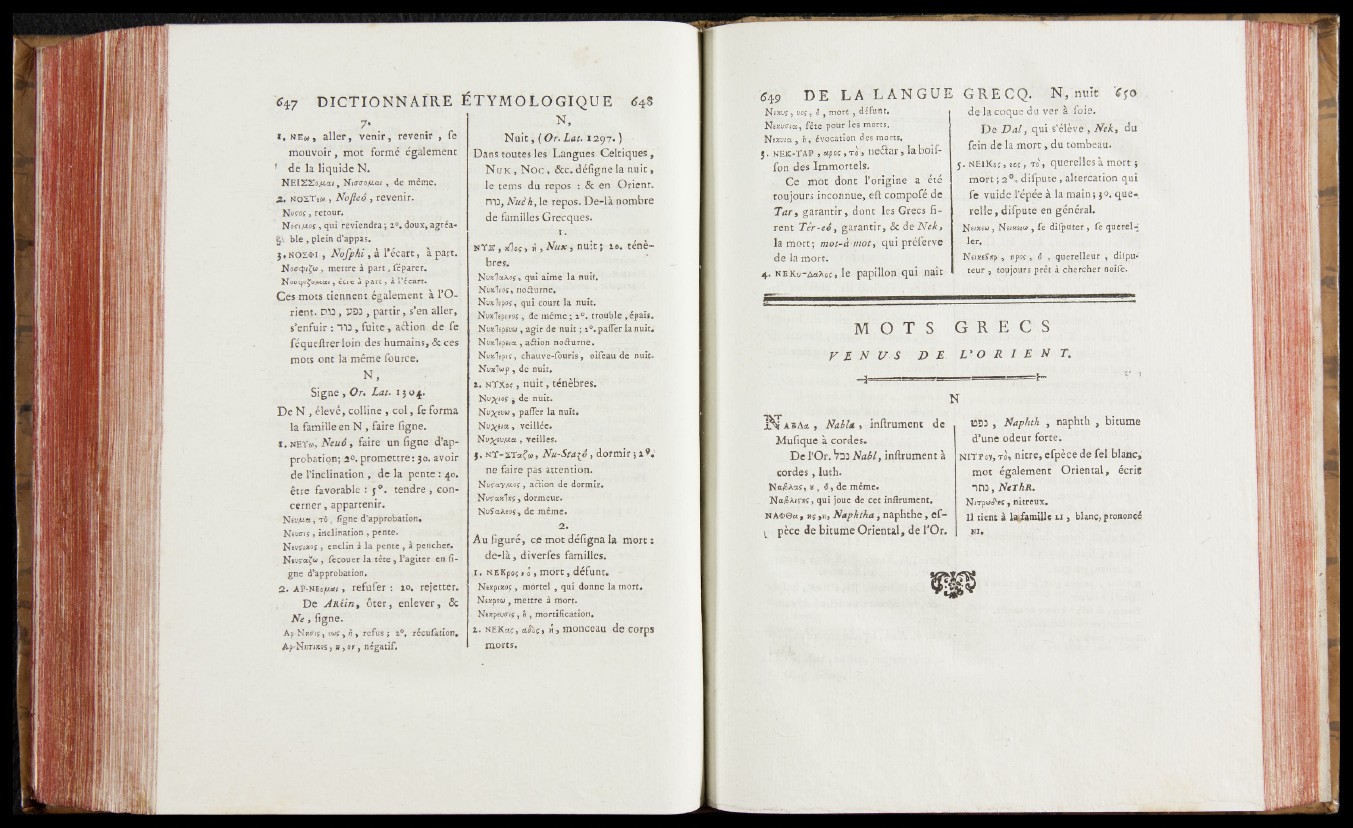
*47 D I C T I O N N A I R E É T Y M O L O G I Q U E Éfe
7 *. S . i ■ »
ne« , a il# ,''' venit ; 4 evenï#% $ ||
mouvoir, mot forme egSIemènt
f de la liquide N.
NEI2So>iai, Niffo'oju.ai, de.mênje.. .
2. n om » > .Nafieér? r ^ o i r , n
j| N«çof % remut'.. ,
N o5"</“ oî 5 qui reviendra ; a°. doux, agrêa-
g\ ble , plein d’appas.
3, Noi$ï , Nofphi, à l'écart, à pajrt.,
Noffcpifamettre à p a rt, féparer.
’ NodïpiÿoMa», être à p a rt, a l’écart.
Çes mots tiennent; cgaletqent à l’Q-!
rient. Djü, Î3S3-, partir, s’en aller,
; s’enfuir : *VD, fuite , aftion de le
féqueftrçr loin des humains, & ces
mots ont la même fource.
N , ?
Sig n e ,O r, Lat. 1304.
De N , élevé, colline , co l, fe forma
la famille en N , faire ligne.
•1 . n e t » , Neuo, faire un ligne d’ap-
i probatiqn;20.promettre: 30. avoir
de l’inclination, de la pente ; 40.
être favorable : j ° . tendre , concerner
, appartenir.
NeuMB, rJ ,'figne d’approbation.
Nsu<r<f, inclination , pente.
Nturixos, enclin à la p en te , i pencher,
N*vsw£w > fêcouer la tête , l’agiter en ligne
d’approbation,
2 . AEaJEti/^*/, refufer : 1°. rejetter.
t De  K iin , ô te r, enlever, &
Ne , ligne.
Ap-Nuff«, tuf , ô. > refus ; 1°, récufation.
Ap-Nr;Tiaof, s , o r, négatif.
Nuit i( O à L à t .T Z fi'. ) >
Dans toutes les Langues Celtiques,
ü l;Nufc>’,-N o c , <&c. défiigde la nùié-,
letems du repos. : & en-jOfiient.
ma, Nufky le.rèpqs, Dte-larnombre
de familles C^dcqu'ês.î-/'*
sy s , afifif, « , Nux-, nuit j~z®. ténèbres.
Nu*1cô.of, qni àinie' la.htn0! ’
Ntwcwoï ,'uo£turne, * ■ '
: Nojc'fêp'of^’qui coust l'a nüit.
| NWJspi.t'of, de même ; V°. trouble. ; épais.
.Nux1tp,siKu,.agirdenuit ; î 0,pâfrer.l^,jjuit,'
Nuxltptja, adion nodurne.
Nwltpif. chauve-fouris, oifeau de huit.
Nvxlwf , de nuit,
a. n t x »5 j 'n u itV 'té ri èÊr es. ^
Nu^iof j de ntit.- “’
Nup^tuu, paffer la nuit. '
Nw^sia, veillée. _ '
Nuyçtvfta,, veilles.
j . NT-STaf®, N u -S ta iô , dormir ; i? .
f« me fai reCfia»attention. ’’ ï
Ntffcty/*9ï y acîion de dormir.' ’■ * Jj
doiftdeiiri^ f'1
NvS-ahioSy de même, ■ ’.*
2. jÉ
Àu figuré, ce mot déligna la mort :
de-là, diverfes familles. 1
,1. SEKpof, 0 y m o rtd é fu n t. «
Ntxpixoç, mortel, qui donne la mort. '
Ntxpow j mettre à mort,
i Ntxptwri's, h y mortification.
i . NEKaf, aSbs > » , monceau de corps
morts.
*49 D E L A L A N G U SE G R E C $ C N , jg || | **(*
■ JvSt.Ä'/a , ' ■ " $
K&W*», ^ ,f§ts
J. NIplt-Ài3 , apoc , bij>jffofeldes
mot db(| t ' l’o/igîne.! etc ;
to.ujouràÿnconnii^^ftfl: compofé de
T ar y garantir, 4911e Grecs^-,i
rent Têr-eô, garantir, & de K e k ,
la mort; mqt^a-ttiot,■ fq^ptéfêrv-é
4. NEKû-AâXôf,.le papi'lîori.qui‘;na,ît’
de M c o q u e ^ rv é f ^ %îf*
De D a l,\qui s’élève*,"Niky dit
. fdii d'é’la jnort,•'/dit.tombeau^™
V querelles à mort ;
1 rrior-t ; 2 . \ cfi'fph'tfe jïaltbrcation qui
à fe vn id e jÿ jée à la maint-jOi-^que«
v ^ ^ vdifputje en général.
»‘fc difpdtéé , fe querel-;
‘ $$è£l&k' y- querelleur , “ düpuj
teùr^, jtpàj^uçs gr&jà Æepchçr'tieifè.
M O T S G R E CK$
V Z N 17 S D E . L ' O R J E N T .
xQ'asa« j^ N a k l* de
I Mulçtue^àip^rdes, ij
N
De l’Or. *733 N ab i y inflrument à
cordes, luth.
N«;/0âas y v , i y de même.
; NaM/rof, qui joue de cet infiniment.
KAO0«, ns ,n, Naphtha / naphthe, ef-
I pèce de bitume Oriental, de l’Or.
osa , Naphth , napht'h , bitume
d’une odeiir"fôrÈèp ’ “J
NiTPft»,To, nitre, elnècède fel blanc,"
; .mot. également! Oriental, écrit
*in3, NeThR.
Nirputf^f, nitreüx.
! Il tient à la famille li , blanc, prononcé
I , ifjmfcj ;.