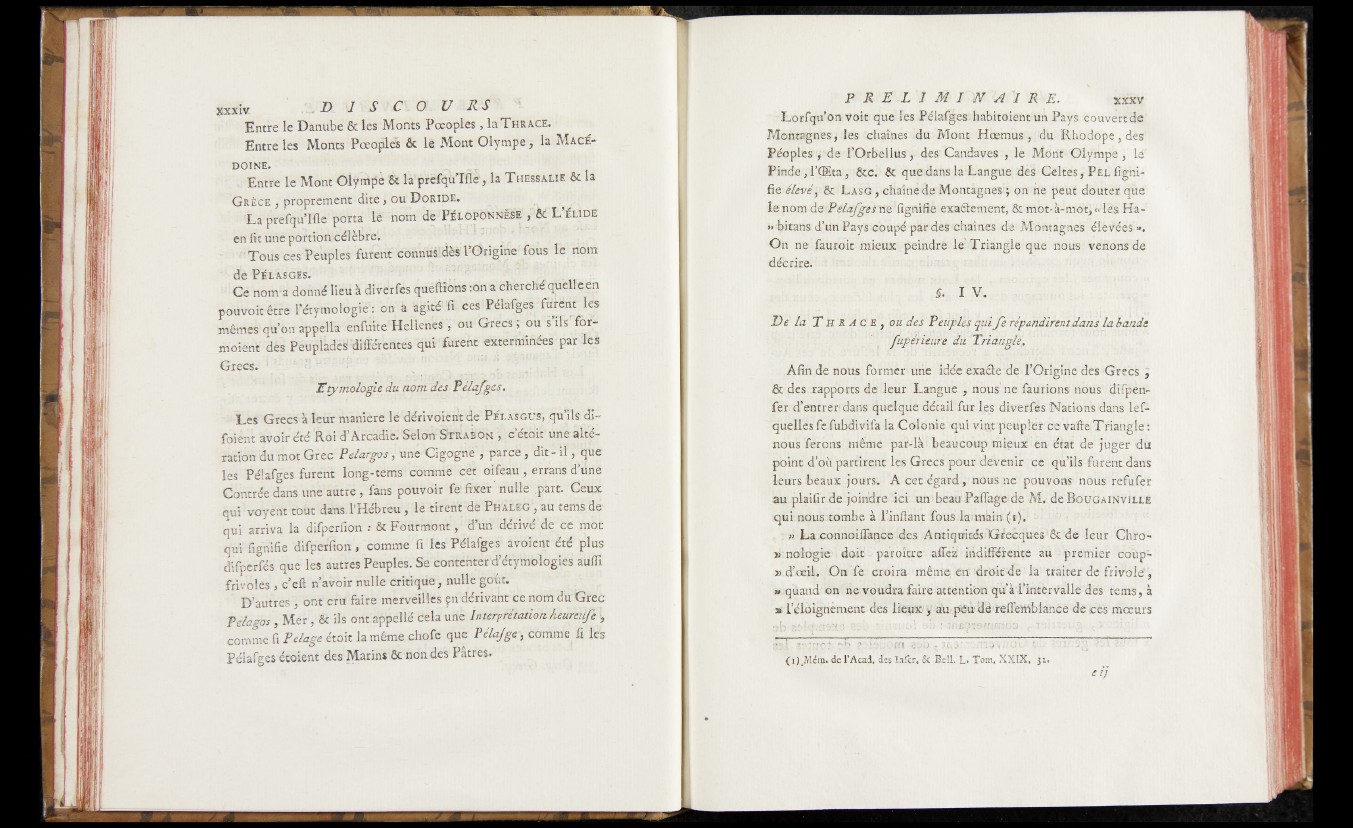
jexxiv 4 JO. R M ' 17
Entre le Danube & les Mont£ Poeoples , la T hr ace.
Entre les Monts Poeople£ & lè Moiït Olyrîipe’, la Macé-
'■ DÔINE. - | ... „1
v-Entre le Mont Giÿfripè & làïprë^û’Tflex, la T hessàlie & la
Grèce , proprement dite > ou DoRipEi ® ; 3
La p'réfqu’Ifle porta le nom de ’FÈLo'poNNËèE',■ ’& L ’êlide
• cn'lït'jiSé'^wtîbffec^lëfoïeC'c ' ’7 v' J’ ’*}/ '>' 'm ': o
/'Tbü»'ëès,Pey^l«^^fûtei^'^^n^4^ t î(^îgin«^Pous le rionr
' -d« PÈfcÀSGES. •••'’: ' ^ ' ■ '’s“ -- ^ .
Ce n om donné lieu à diverfés quéÀîons :ana cbèrcMq%ëlIe en
pouVaitrêtre Pétymofëgî^ron; à
mêmes2 qu’on appèttâr ënrike-'HeÛen^ÿ^&Ml^t'Oti ;s ifsfor-
A’oïênt dés Péupikdè^dHFérentés
Grecs. 1
Etymologie du nom des Pélafges- 1
; Lès Gréera Iernf maniéré lé‘dérivbîèfifede PÊEA%èüsj
fbidnt'kvbrr ëté^oi-'d’ÀrïafflKSydtfS^Ailôk ) détoït une afl|-
ràtton du mot GtecPelargos ,* une^CigogAfe , p'arçe, dit - 1¥ , qno
les Pélafges furent long-tems eommë cèt orfeau, etrâns d’une
Contrée dans une autre, fans pouvoir fe‘ fixer nulle .pkrt. Ceux
qui: voient tobt-daris.l’Hébreu, lë-mentyëPHAÉEGy1 aü tems dè
qui arriva la difperfioit : & Fourniom , ^ v<^ % cê iïïSt
qui figififie difperfton, comme’fi lès Pélafges âxrôïènt été plus
difperfés que les autres Peuples. Sé^ontehter'd^inblogies àufli
frivoles, c’eft bavoir nulle critique, nullelgdâr.
D’autres f o n t c i if faire mervétltës pmfevahrce nronï 'dbrlGrec
Pélagds, Mer^ôt ils ont appelië fela une' irtUtyMMi6id'Bufâfî\f
comme fi Pelage étoït la même chofe que PélaJgeycomvttQ fi lés
Pélafges étoient des Marins & non des Pâtres»
P R E L î 0 1 W p I R E. xxxv
Lorfqu’ottvoit que les Pélafges:habitoieftt*u:n Pays couvert de
Montagnesq les cubaines du « Mont Hbemus^du iRhodope, dès'
Péoples, de l’Orbellus, des Canbaves , le • IMtdiSfc- Olympe , lé'
Pinde, l ’GStay s&C.-; ôt quedans laLangüe déS Celtes, P el figni-
ÛQ^lévép & L àsg ,chaînèder Montàgnesq on1 de peut doutet que
lenom de^«^^?ïîîêlfignîlê ex&ètemetùy bs-mot-à-mbé; Ha-
» bitaiisi d’dn PâyS d® üpé pàt des sdastîn'es.dè! 'Mdntagnes - élèvéés ».
Oin ûe^|àùrdit>-mieux pèïMr^ié'Triangle« que nous véfionsde
décrire." 3
« §. I V.
V e /a T* U R A d E t ou des Peuples qui ferépandîlentdans labande
''fpp^^)eleoClPiiâiigîef
Afin de *|
& pies rapports deileur Langue: j itbùsline fautions nbüsudiïpfert-
fer: d’e»trepdanS t|uelqiièiâét:ail:fur l^S diWfLès MàtlÔnS dans lèf*
'quelles fefubdivifa la Colonie qui vtgtqte^lér'pevafôèfT nanglëi
nous fer ons « .irtê’m é pat-là *f beaucoup: m ieux ? & dkt de juger du
pb md d on partir pnt les preçs |Kmt»\îâréiifib ; eé qù’Bs"#irent dans
leurs beaux jours, A cetdga^q nbusiie^pouvons nous refufer
au plaifir de join'drekfici un heau PaïTageidè M. de Bougainville
qui nous)tombe àTinftant fous laittiàiîî^t),2
:. » La ,connoifiance des iAntiqnitds'GieiCques^&'de leur Ghro-
»i:noîi^i5e?t doit- parôîcre* affe^f fédifféiente au -premiet ’co'ùp^*
»id’oeisl. On fe ? croira même, en droiede ' la' traiter de frivole?y
* qikandf on no voudra fairé-atÉëntiOïï qu’àLïritèrVâllë'des' tems, à
» rélbignèment des liepx y âu peù'Hè'reflèmblancêde ces moeurs
ab-RS>Jkfïftë3L9-e©b ïbriuol éB : meoiemsnoa ^ reii?.ï-i/;s. «xesiau
de l’Acad, des Infcr, Sc Bell. L- Tom, XXIX, jî.
e ij