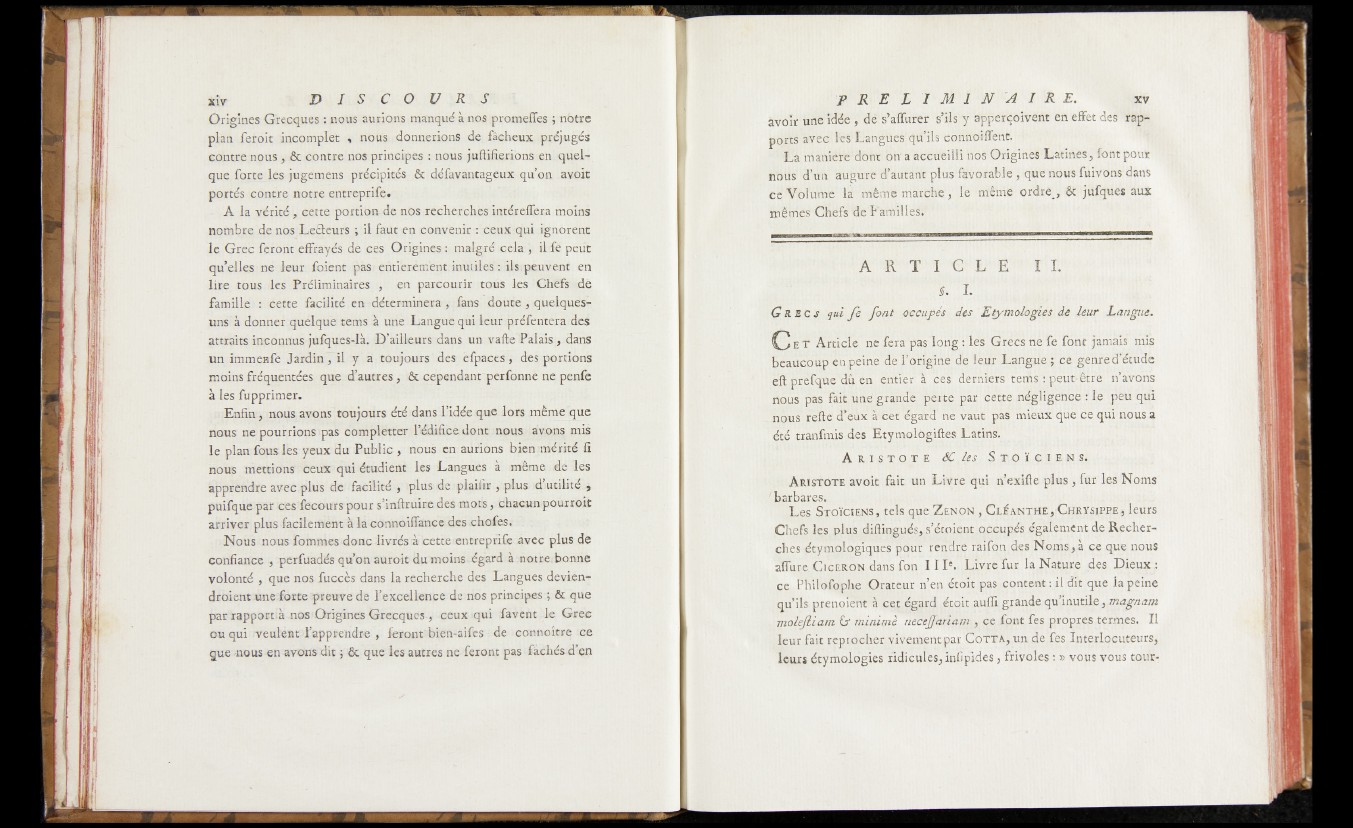
xxv D I S C O U R S
Origines Greeques : nous aurions manqué à nos ipromeffes ; nôtre
plan fetoit incomplet $ nous donnerions de.fâcheux préjugés
contre nous > oontre nos principes : nous jufS^&ns^eni quel”
que forte les jugemens précipités & défavantageux qu’on avoit
portés eonârq notre «ntreprife.
- A la vérité , cette; portiomde nos recherchés intéreffera moins
nombre, de nqsdheêteurs ; il faut; en convenir^ceuiîqui igTOïenc
le Grec .feront effrayés de ces Origines : malgré îoela , il fë peut
qu’elles ne leur faient pàsrentiërèmentrinünles ta ils.peuventien
lire tous les Préliminaires , en parcourir tous les ’Ghéfs dè
famille? : cette facilité en déterminera , ,• ûns ' doute, quelques*
uns à donner'quelque tems à une Langue qui leurqméfeufcera des
attraits inconims jufquesdà. D’ailleurs dans un vafteTPalais^ dars
un immeafe Jardin, il y a toujours des èrfpaces , des portions
mains fréquentées que d’autres, & cependant perfonnè ne penfè
aies fupprimer.
Enfin, nous avons toujours été dans l!idée que lors même que
nous- ne pourrions :pas oomplëtter l’ékMce dont mous aivop^ mis
le plan fous les yeux Hu Publie , nous en aurions Menunémé II
nous mettions ceint qui étudient les Langues à même Sjâs tes
apprendre avec,plus de facilité , plus de pjaiikv, .plus tfutilité,
puifquëipâï ees'fëcours pour s’inftruire des mark, Bhammpoûrroît
arriver plusfacîlCi^éntà làcànnoiffaneedescliafes.
NoUsnous fommes donc -livrés à cette enereprxfe avec plus dé
confiance , perfuadés qu’on auroit du moinsiégardiàïnmbeiltonne
volonté , que nos fuccès dans la recherche des Langues devien-
drüient vmeibrte preuve de f excellence de;nos principes ; & que
par rappartià nos'Origines Grecques, ceux qui faveot lie Grec
ou qui sveuléfitd’apprendre , foront'teen-aifes de vconnoitre :ce
que nous en -avons-dit y & que les autres ne feront pas uÊichés d’en
F R E L I M 1 N A I R E . xv
avoir une idée V dé^affurer s’ils y apperçoivent éiï effet des rapports
avec les Langues'qu’ils conhoiffent. ?
La maniéré dont on a accueilli nos Origines Latines, font pour
nous d’un augure d’autant plus favorable, que nous fuivdns dans
CéVôluhie ld même marche, le même ordre , & jiifques au*
mêmes Chefs de Familles. f
A R T I <D L E I I.
G recs fui Jé Jontoscupés des Etymologies dû leuf Langue.
0 e t Article ne fera pas long : lës Grées ne fe font jamais mis
beaucoup énpéinèüe l’origiAê de leur Langue ; ce genre d’étude
ëff prefqüe 'du‘én entier à'ces* derniers temsj peuf-etre n’avons
nous pas fait unë grande, perte par cette négligence : le pëti qui
mousrefte d^eux a^cét ég^rcT nè vaut pas ‘mieux que ce qui nous a
été tranfmis des Etymologiftes, Latins.^
A R I §. T .O T E SC les. S t O ï C tE; N S» ■
Aristote avoit fait un Livre qui n exifle plus, fur lés Noms
^arbaresjf;.::
Les Stoïciens, |eLs qpe Zenon, Cléa?nthe,C hrysipi?e$ leurs
Chefs les plus diftingués, s’écoient.qç,cupés également de Recherches
étymologiques pour rendre raifomdes Nojtns,a ce que nous
allure Cicéron dans fon I I I e. Livre fur la Nature .des Dieux.-,
qe Phil*ofophe Orateur n’en étoit pas ^content : il dit que la peine
qu’ils prenoîent à cet égard étoit aufli.grande qu’inutile, magnam
molefii am &*• m in im jinM ] ^ n a fm 4 ce fpnt fes propre? .termes. Il
leur fait reprocher vivement par Çotta, un de fes Interlocuteurs,
leur* étymologies ridicules, in lipides, frivoles : » vous vous tour