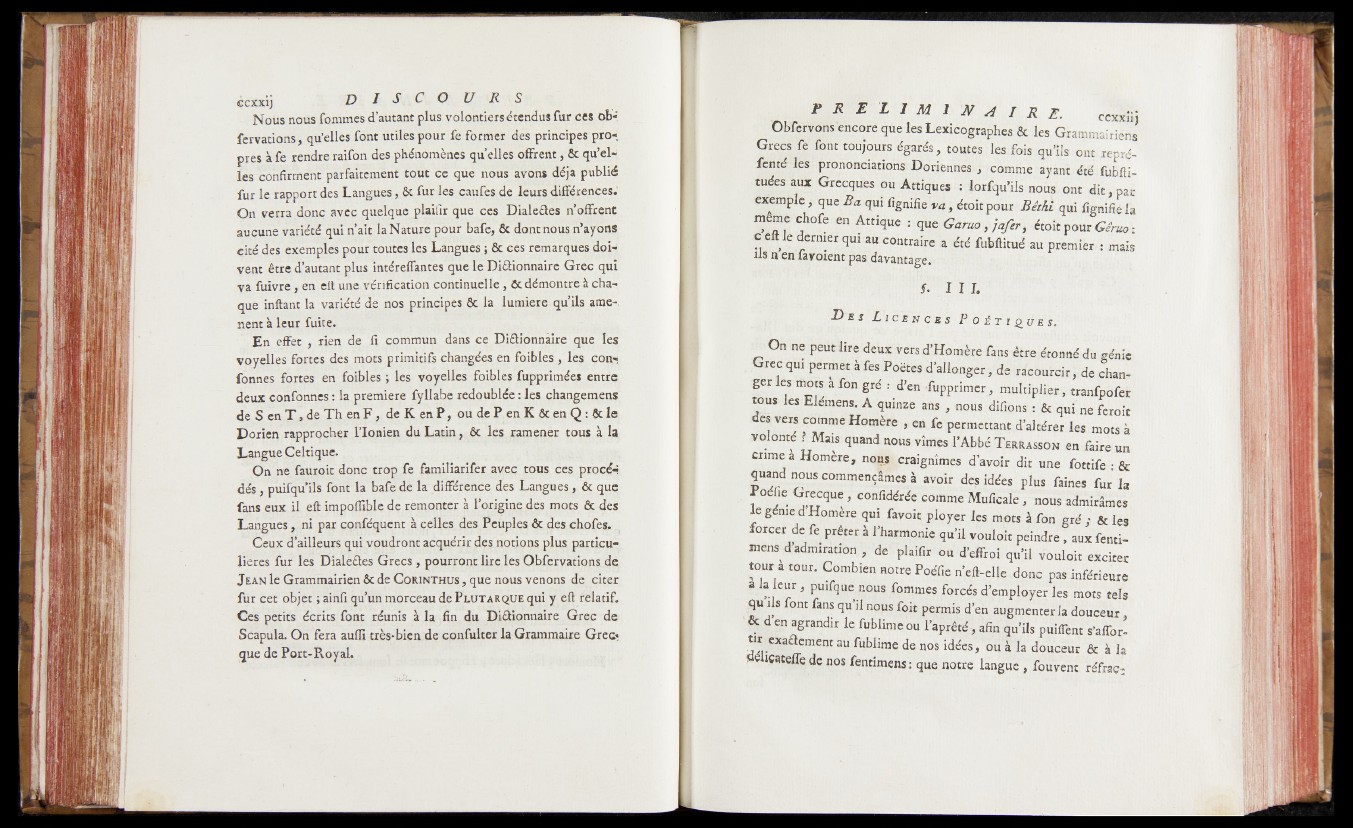
ccxxtj D I Mm O U R s
Nous nous fommes d’autant plus volontiers étendus fur ces ob-
fervations, qu’elles font utiles pour fe former des principes pro-
près à fe rendre raifon des phénomènes qu’elles offrent, & qu’elles
infirment parfaitement tout ce que nous avons déjà publié
fur le raoport des Langues, & fur les eau (es de leurs différences.’
On verra donc avec quelque plaiiîr que ces Diale&es n’offrent
aucune variété qm n’ait la Nature pour bafe, & dont nous n’ayons
cité des exemples pour toutes les Langues ; & ces remarques doi-
vent être d’autant plus intéreffantes que le Di&ionnaire Grec qui
va fuivre , en cft une^ vérification continuelle, & démontre à chaque
inftant la variété de nos principes Ôc la lumière qu’ils ame-,
nent à leur fuite.
En effet , rien de fi commun dans ce Diftionnâire que les
voyelles fortes des mots primitifs changées en foibles, les con-
fonnes fortes en foibles ; les voyelles foibles fupprimées entre
deux confonnes : la première fyllabe redoublée : les changemens
de S e n T ,d e T h e n F , d eK e n P , ou de P en K Ôcen Q : ôc le
Dorieq rapprocher l’ionien du Latin, ôc les ramener tous à la
Langue Celtique.
On ne fauroic donc trop fe familiarifer avec tous cç§ .procék
dés, puifqu’ils font la bafe de la différence des Langues, 6c quq
fans eux il eft impoffible de remonter à Perinne des mots.. ôc des
Langues, ni par conféquent à celles des Peuples ôc des chofes,
Ceux d’ailleurs qui voudront acquérir des notjlçns plus, particu-;
Jleres fur les Dialéâtes Grecs, pourront lire les Obfervations de
Jean le Grammairien ôc de Corinthus , que nous venons de citer
fur cet objet ; ainfx qu’un morceau de Plutarque qui y eft relatif.
Ces petits écrits font réunis à la fin, du Di&ionnaire Grec de
Scapula. On fera auffi très-bien de c.onfulter la Grammaire Grec«
que de Port-Royal.
? R E L 1 M 1 N J ! R
Obfervons encore qûeles Lexicographes Ôc les Grammairiens
B H H H toujours égarés, toutes les fois qu’ils ont repréfenté
les’ prononciations Doriennesh; .comme ayant été fubftituées
aux Grecques ou Antiques : lorfqu’ils nous.ont dit,par
exemple, que B a qui lignifie V a , étoitpour Bêthi qui fîgniffê la
même choie en Attique : ^xeGaruo^jafir^ étoit pour :
ç eft le dernier qui au contraire a M fubftitué au premier : mais
ils n en fa voient pas davantage.
§. I I I.
D e s L i c e n c e s P d ' i r r g ue s.
_ On ne peut lire deux vers d’Homère fans être .étonné du génie
Grec qui permet à fes Poëtes d’allonger, de raccourcir „ de chan-
ger es mots a fon gré 1 d’en fupprimer, multiplier 1 tranfpofer
tous les Elémens. A quinze ans , nous g g g g g : ôcqufne feroit
des vers comme Homère , en fe permettanfed’altérer les mots à
volonté LMais quand nous vîmes l’Abbé T errasson en faire un
cnmea Homère, nom craignîmes d’avoir dit une fottife • ôc
quand nous commençâmes à avoir des idées plus faines fur la
l ’oéfie Grecque, confidérée^ommeMuficaie, mous admirâmes
le génie d Homère qui favoit ployer les mots à fon gré / ôcles
forcer de fe prêter à l’harmonie qu’il voulolt peindre, aux fenti-
mens- d.admiration , de plaifit ou d’effroi qu’il vouloir exciter
tour a tour. Combien notre Poéfie n’ejf-elle donc pas inférieure
a la leur, puifque nous fommes forcés d’employer les mots tels
qu ils font fans qu’il nous foit permis d’en augmentera douceur
& d en agrandir le fublimeou l’aprêté, afin qu’ils puiffent s’affor-
tir• exaélement au fublime de nos idées, ou à la douceur ôc à la
déhçateffede nos fentimens: que notre langue, fouvent réfrac