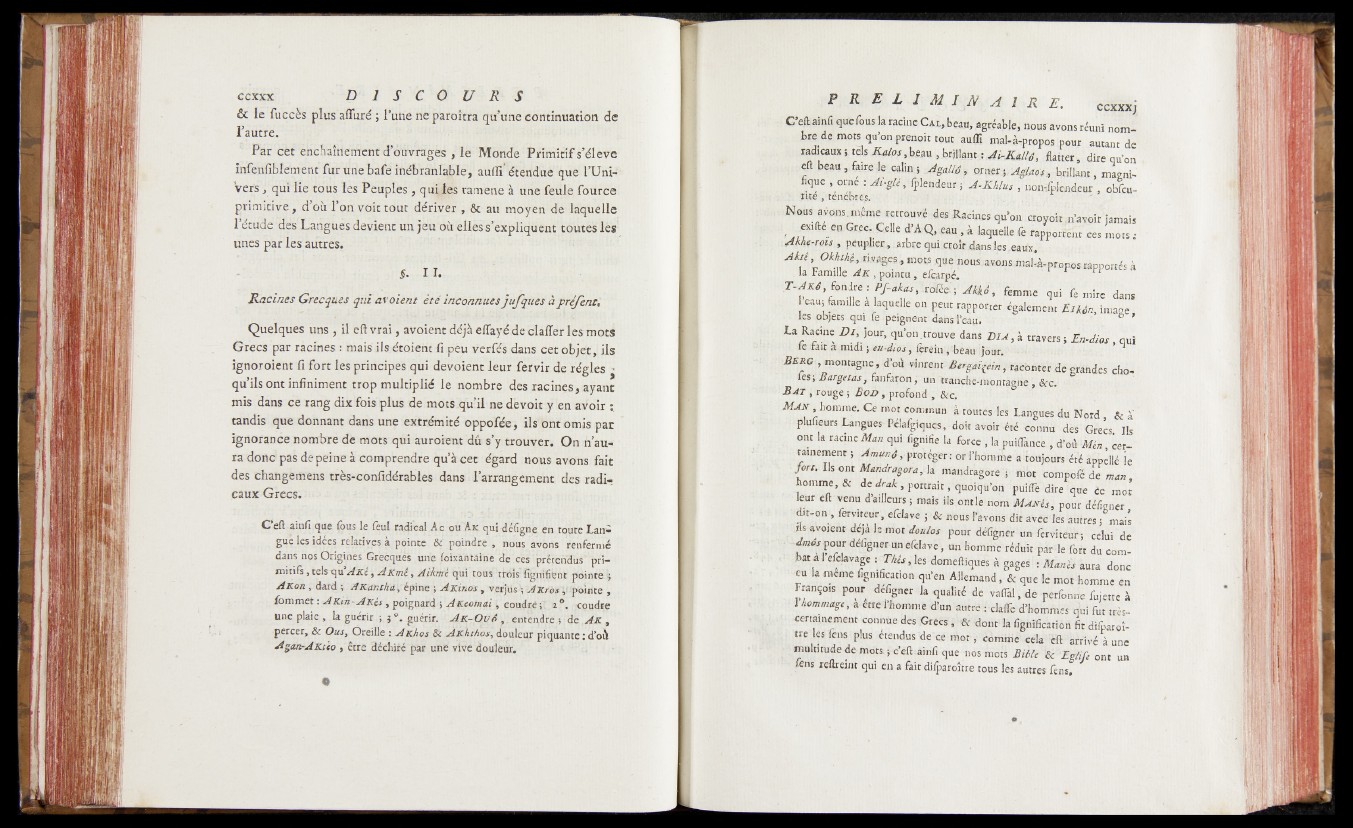
ccxxx D I S C O U R S
& le fuÇéës plus affilié j Tutie fié paroîïfa qü’une continuation de
l'autre.
Par cèt éHtfiaîîieWent , le Monde Primitif s’élève
mfenfibiement fur une bafé lûébraniajble, aulïréténduè que l’Urii-
vers j qui lie tous les Peuplés y qu|Jesramëne à une feule four ce \
primitive , d ou 1 on voit tout dériver , & au moyen’de laquelle
l’étude des Langues devient un jeu oit elles s’expliquent toutes lés
unes par les autres.
$. I I .
Racines Grecques quiav oient été inconnues jujques à prêjcnt*
Quelques uns, il èft vrai, avoient déjà eflayéde iclaffer lesmots
Grecs par racines : mais ilsétoient fi peu verfés dans cet objet, ils
ïgnoroient fi fort les principes qui dévoient leur fervir de régies -
qu’ils ont infiniment trop multiplié le nombre des racines, ayant
mis dans ce rang dix fois plus de mots qu’il ne de voit :ÿ enavoir;
tandis que donnant dans une extrémité oppofée, ils bnt omis par
ignorance nombre dé mots qui auraient dû s’y trouver. On h’au* ■
ra donc pâs depeine à comprendre qu’à cet égard nous avons fait
des chahgemens très-confidérables dans. l’arrangement des radicaux
Grecs.
C’eft-ainfi que fousle feul radical Ac ou Ak quidéfigne en toute Lan-
tel^vefrà.-pointe ptûndre:, nous aVons Renfermé
dans: npsTOrlgines’ Grecques une ïoîxantâirie 'de cës'préforiduSUpri-
naitifs, telsqu’^Xé ,A x m i, Avhtie qui tous ;tbSsîfi|iiififehit pointe |j
A k o n , dard $ AXJàiithà^ épine ; A x in o i , verjUs1; A x rè s ;r:pbirite j, ,
fommet : A x in -A X ê s , poignard-j A xcotnçi coudre; 20. egodre
une plaie , la g u e rir.jj guérir. A x -p jjé emçqdrd J d c ,A x ,
percer, & Ôus, Oreille - A kJios & A xh ihos, douleur piquante ) d’oà
Agan-A xûo , êfrè Hédiifc par uftg vive douleur.
P R E L I 1 R E. ccxxxj
Ceftainfi que fous la racine C ^ b e a j t , ,agréable, nous ayons réuninom-
bre de mots qulonprenoit .tout auflî *naRq>roPos pour autant de
radicaux £ tels R a l o s A i r R m , flatter-, dire qu’on
W Ê ^ W Ê Ê S È fr magnifique
orne.: JplendeurJ A -K h lu s", nonifpfendeur , ojlcu-
SS tité^'ténjâbîe^ 1 ,, ., , . , f ' t
* * * * * a w m Ü m I
tfjjflfggM peuplier, .arbre quütoit.dansfesteadx. |
A k ti { OkhthU rwflges^ mots à
la Falmille A x , pointu ; efcarpé. * ■
bliHiMaWilii H H H I d * »
I f i É U i f \ b 3u' ^ j j W 8 a i P j B r o j B W Ë g g f i im . e
- : les objets qui Je -peignent dansfoatti \v ' -‘t t; ^ ' ;
La Racine D i, Jour, qu’on trouve dans p iA ,k travers\ Çn-dios . qui
•/ # -,eu-dios, ^ 8k!i4ièà^ij^é::::*K:ïf. ' ^ '
t o c « ^ t a g n e , . d * ° û racbmfèégegfohdes çholes
•y'JSargetast fanfat;bn ; un tranc-hè-niomâgiie \ &rc.J î>nirn .
Bat , rouge 5 Bob, profond , :&q.
M a n homme. Ce mot commun à, routéedes Langues du Nord, & f
plufieurs Langues-Pélagiques, ddtt àvoir -été -conflû' -dës’-Gfocs. Ils
, ont la racine Man qui fignifie la force , la puifêkcè,., d’oà ’Mèn êer-
vainement ; i W j âppèllé le
Ils ont Mandragoraj\a. maodràgSre^- mbt compbi de mon,
homme, & dedrak , portrait, quoiqu’on puifle >di« te mot
leur eft venu d ailleurs 5 mais ils.'oîitle nom M a n I s , pour défigner '■
J i ‘&nteùH’Wèns dit avefc'(lë's Autres ; mais
; jis avoient déja-ls mot doulos pour déügner un-ferViteur ; celui'de
• ^ p o u r d é f i g n e r un eforavë, un bomke-réduit p ^leJode du cornbat
a l elêla-vage : T é é^le s domeftiques a gages5-: aura donc
eu la nufflt figmfeation.-qu’en Allemand, M M lem o t homme en
François pour déflgner J a qualité de valTal, de foerfonde fujette à
I hommage, a être l’homme dhin-autré :• clafedhommes W fot très-
« " ^ e n t e o o f l t e d e s ^ é ë S ^ ^ è o n é l à E|bfficktièrîfitifoaroî-
- f tre des-feiw-plus étendus d e ’-cè i^ot F^mWèXcêl^'hft dérivé à une
ffiukitude tfo-ptôte Bm * & >Ègtife ont un
• feris reftreirit qui; en a foit dilpatoître tous les autres fens.