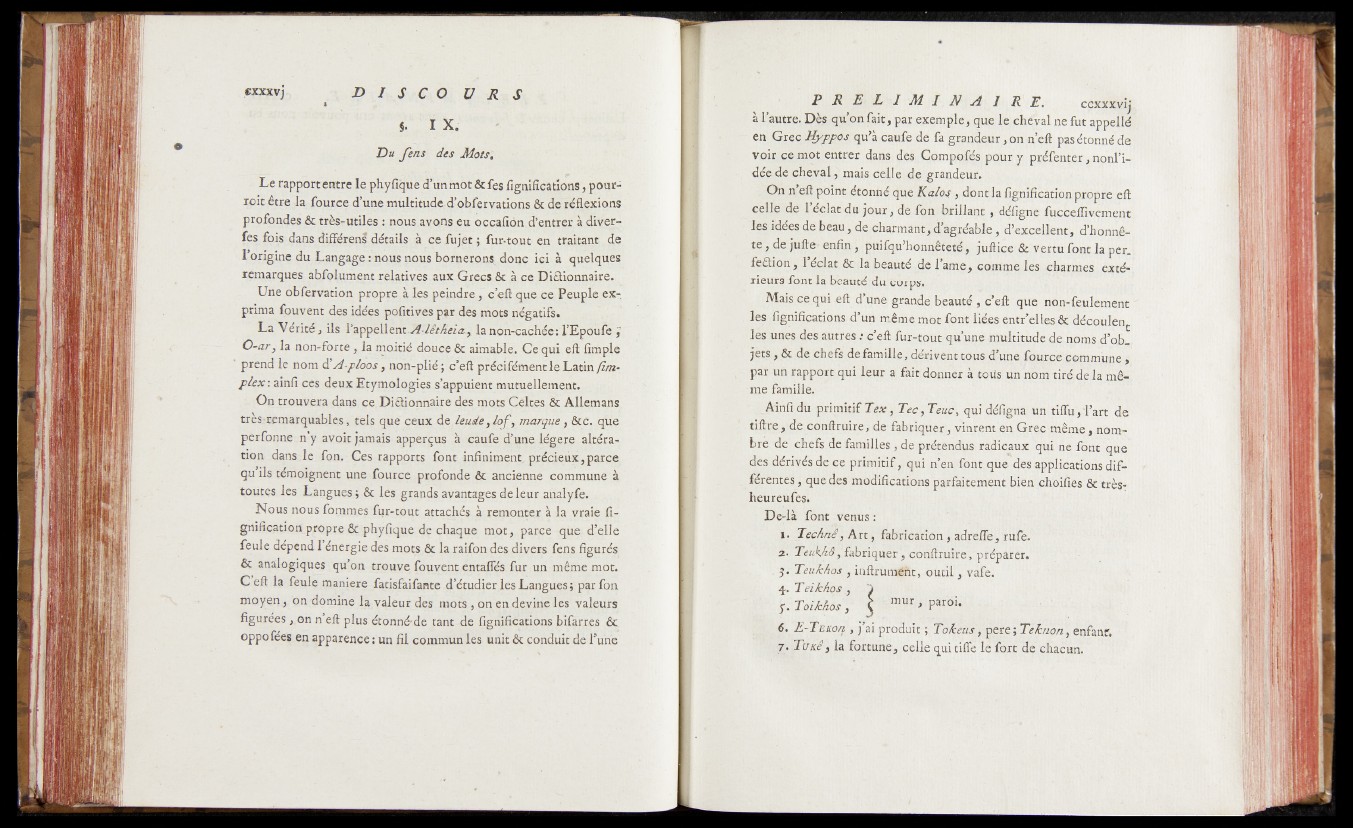
cxxxvj D I S C O U R S
i
§. I X .
Du fens des Mots,
Le rapport entre le phyfique d’un mot & fes lignifications, pourvoit
être la fourcç d’une multitude, d’obfervations & de'réflexions
profondes & trèstutiles : nous .avons eu occafiôn d’entrer à diverses
fois dans différent détails à ce fujét ; fur*tout en traitant de
l’origine du Langage : nous nous bornerons^ donc ici à quelques
remarques absolument relatives aux Grecs ôc à ce DiQâpnnaire.
Une obfervation propre à les peindre, ceft que ce Peuple exprima
fouvent des idées pofitives par des mots négatifs.
La Vérité, ils l’appellentA-Iêtâeia^ la non-cachée:TEpoüfe ,
O-ar, la non-forte , la moitié douce & aimable. Ce qui .eâ fîmple
prend le nom d'A-ploos, non-plié ; c’éft précifémentle Latin fini'
plex : ainfi ces deux Etymologies s’appuient mutuellement.
On trouvera dans ce Dictionnaire des mots Çéltes & Allemans
tres-cemarquables, tels que ceux de leude y lo f y marque, ôcc. que
perfonae.n y avoit jamais apperçus à caufe d’une légers altération
dans .le fon. Çes rapports font infiniment précieux,parce,
qu ils témoignent une fource profonde & ancienne commune à
toutes les Langues ; & lés grands avantages de leur abalyfe.
Nous nous fommes fur-tout attachés à remonter à la vraie lignification
propre & phyfique de chaque mot, parce que d’elle
feule dépend l’énergie des mots & la raifon des. divers fens figurés
& analogiques qu’on trouve fouvent entaffés fur un même mot.
C pfi la feule maniéré fatisfaifante d’étudier les Langues; par fon
moyen,/on domine lavaleurdes mots, on en devine les valeurs
figurées ,.en n eft plus éronnéde tant de lignifications bifarres &.
oppofées en apparence: un fil commun les unit & conduit dé l’une
P R 'E> JL I M I N A 1 R E . eexxxvij
à l’autre. Dès qu’on fait, par exem pie, que le chéval ne fut appellé
en Grec Hyppos qu’â caufe de fa grandeur, on n’efl pas étonné de
voir ce mot entrer dans des Qompoi^s pçmr y préfenter, nonl’i-
dée de chevalmais celle de grapd,ejiii.
On n’eft point étonné queKa/os ,r,donda fignificationpropre eft
celle de l’éclat du jour, dé fon brillant rWfignéfucceffivement
les idées-dé beau, de .charmant, d’agréable, d’excellent, d’honnête
, de jufte> enfin, puiljqu’hànnêteté, ju/tice ,& vertu font la per.
feâion j 1 éclat & la beauté de l’ame, comme les charmes exté-;
rieurs font la beauté du'côrps. -
Mais ce qui .eft d’une grande,beauté , c’eft que rion-feulement
les.'figpifications d’un même mët font liées entr’elles& découlen
les unes des autres .* c’eft fur-tout qu’une multitude de no ms d’ojb
jets, & de chefs de famille, dérivent tous d’une fource.qommune y,
par un rapport qui leur a fait donner à totis un nom tiré de la mêl-,
aie famille.v :
„Ainfi dii primitif J e x , Tecy Teuc\ qui;défigna un tiflu,i’art de
tiftee., de conftruire, de-fabriquer, vintent!en,Qréc-mêmè, nombre,
de chefs.de familles , de prétendes radicaux qui ne rapt que
des dérivés de ce primitif, qui n’en font que des applications dif-
férèntés, que des modifications parfàitemé^çbién'dhoifiés ôt très-
heureufesi;
De-là font venus :
i. Technê, A r t, fabrication , adrefie, rufe.'
а. Teukhô,'fabriquer , conftruire /'préparer.
./?• TeuMbs'y inftrumiiht, outil, vafe^
4. Teikhos j
' f ToikAàsf 5 mur, paroi..
б. E-Tekok , pai produit ; Tokeïû ,-pere ; Téknorty enfant.
7. Tusêy la fortune, celle quitiffe le fort de chacun.