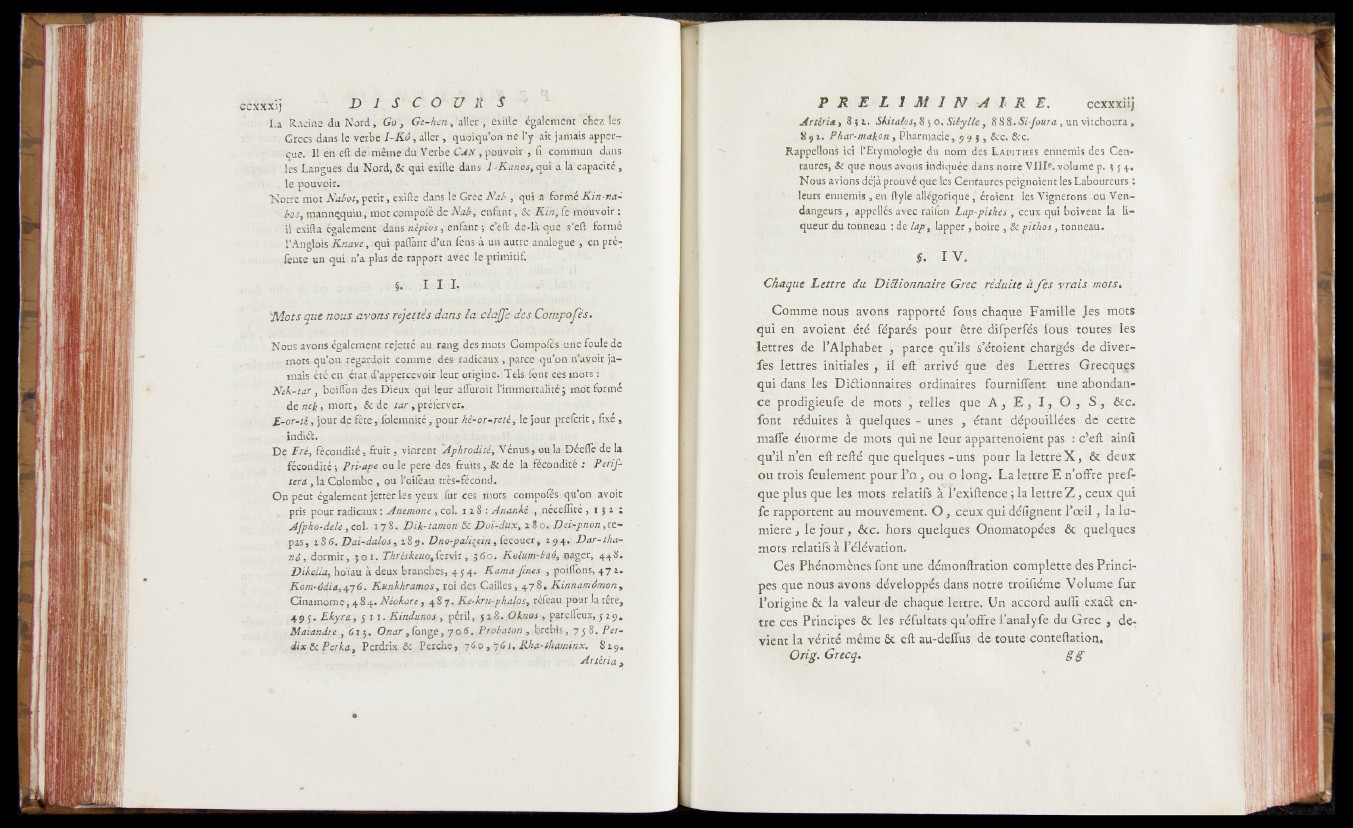
xxxij D 1 S C O U Ê S
La Racine -du Nord, G o , 'Ge-kén ,'àl!ê!f ékift'e égalënié ri t ;chez:îes
: Grecs dans le verbe i -X d , a a p p e r -
Lr:cue. Il eh. e&dê>mêHk?dù-V!Êrbe CL*vypo»©ïr>fi-commun dans,
■i -les Langues du Nord, & qui exifte dans 1-RànoSj qui a là^c|pacicé ,
lepouY.ojrv.'
'Notre motNaèot, petit, exifte dans le Grec A7<zéy‘è[ü‘i •a-fdèrhé R in -n a -
X io sy roânnqqum, mot comphfé-de riü&$ eftfknt$ & & fèfi$idhvo!r :
Il exifta également dâns nipïos, enfant ;--cvéft- de-là; que1 - s’eft formé
t i’Anglois Knave , qui paflànt d?un feiisà üri*autfe an a lo g u e e n préfente
un qui; n’a plus; de rapport avec le primitif. >11
§. / :I i I.
’'Mots que nous avons tejettêsdans la olaJfe des Cotnpofés.
Nous avons égalemenr.rej^tsé.&u. rang ^esmQtS'CompjbÊsiurie foule de
, mots qu’or^ $egçirdoit nomme.: d ^ ÿadieàux i parce sqa’pn n’avoit ja-
. maie été,en ^fatjd’^ppercjsypir l.euç origine.iTeisilpnh^ëSAots :
N e k -ta r, boiïTon des Dieux qjri leur affuroit l’immotrâlité j mot formé
den*£? mort, & de r a r , pr,éferver..
Ê-or-ti, jour dp fête,;lôlemiûtéa .pour > le [jouf jprdfcit,, i^é j
>,indiét. ,
De Fré, fécondité, fruit, vinrent.~Aphroditéi ,Vénus;,■ qu;la:Déefle de la
i fécondité y Pri-ape ou le pere des fruits de la fécQudhé ; P è rif-
tera, la Colombe, oü I’oilèau; très-féeâhd!« g$
On peut également jetterles yeux fur ces mots. eompells'i:qù’on avoir
pris pour radicaux : Anemone »col. i,% $ : Afiapkid, fii&eSSs&é , i j i :
. Afpho-dele tc ol. x 7 8.. JDik-t&pQjf&ç J)pï±âtfx% z%o. Dei-pnon,cz-
g pas, 1 fi 6. D a i-d a lp s, z:8 g . Dno-pali^pirk,ifécoueç j ZQ^yxDar
n é , dormir j - jo r . Thriskeuopfe. ryir,..î$bf iWger, 448.
D ik e lla , boïau à deux branches,-4 5 4. Kama-jinesn, poifions, 471.
Rom-odia, 47 6 . Kunkhramos, roi des Cailles,. 478 $ RinAamomon,
Cinam ome, 48 4. Ncokorc p 4 8 7. Ke-kru-^pjy^lpsy pour la tête,
4 9 j . Ekyra, 5 xi. KinfluTîOjfj ,"péril, j % $ & & & $ •p9r£0"euxJ J1 S> •
Mai an dre , é l } . Qnat 0 longe, '] P^.dd-ppbfitq-n., (breb!s,7 5 8..P er~
dix ScP crka, P e rd rix ^ Perche , 7de *761. fi.ha-f/iamipx. 819.
Artêria ,
P R E L I M I N A I R E . ccxxxiij
A rtiria t S j i . Skttalos, 8 5 0. S ib y lle , 888. Si-Jour a , un vitchoüra,
8 9 1. Phar-makon, Pharmacie ,,9 9 5 , &c, &c.
Rappelions ici l’Etymologie du nomades Lapithss ennemis des Centaures,
&c que nous avons-indiquée dansuiotfe VIIIe»volume p. \ 5 4«
Nous avions déjà proûvêqué lesiSenfaures pe'ignoient les Laboureurs :
“ leurs ennemis', en ftylé allégofique * étoient ’les Vignerons ou Ven-
dangeurs, appelles avec raifon Lüp-pithes , ceux qui boivent la liqueur
du tonneau : de lap‘i lapger, boirç , fk, pïthos , tonneau.
f. I V .
Chaque Lettre du Dictionnaire Grec, réduite àjès vrais mots.
- Comme, nous avons rapporté: fous chaque Famille J^es mots
q|ui en avoiént été 2 féparés pour être difpeffés fous toutes leis
lettres dé l’Alphabet } parce qu ils s’étoient 'chargés de diver-
fes lettres initiales , il eft arrivé que des Lettres Grecques
qui dans les Didiclnnaires ordinaires fourniffent hné àbondan-
ce prodigieufe de mots j telles que A , E y I , O , ;S[, &c.
font réduites à quelques - unes , étant dépouillées : de cette
maffe énorme de mots qui ne leur appartenaient pas : d*éft ainfî
qu’il nVn eft relié que quelques - uns pour la lettré X , & deux
ou trois feulement pour l’a , ou o long. La lettre E n’offre pref-
que plus que les mots relatifs à l’exiftence ; la lettre Z , ceux qui
fe rapportent au mouvement. (X, ceux qui défîgnent l’oe il, la lumière,
le jour, &c. hor^ quelques Onomatopées & quelques
mots relatifs à l’élévation.
Ces Phénomènes font une démonftration complette des Principes
que nous avons développés dans notre troiliéme Volume fur
l ’origine & la valeur de chaque lettre. Un accord aufli exâQ: entre
ces Principes & les réfultats qu-’offre l’analyfe du.Grec y devient
la vérité même ôc eft au-deffus de toute conteftation.
Orig.Grecq. g g