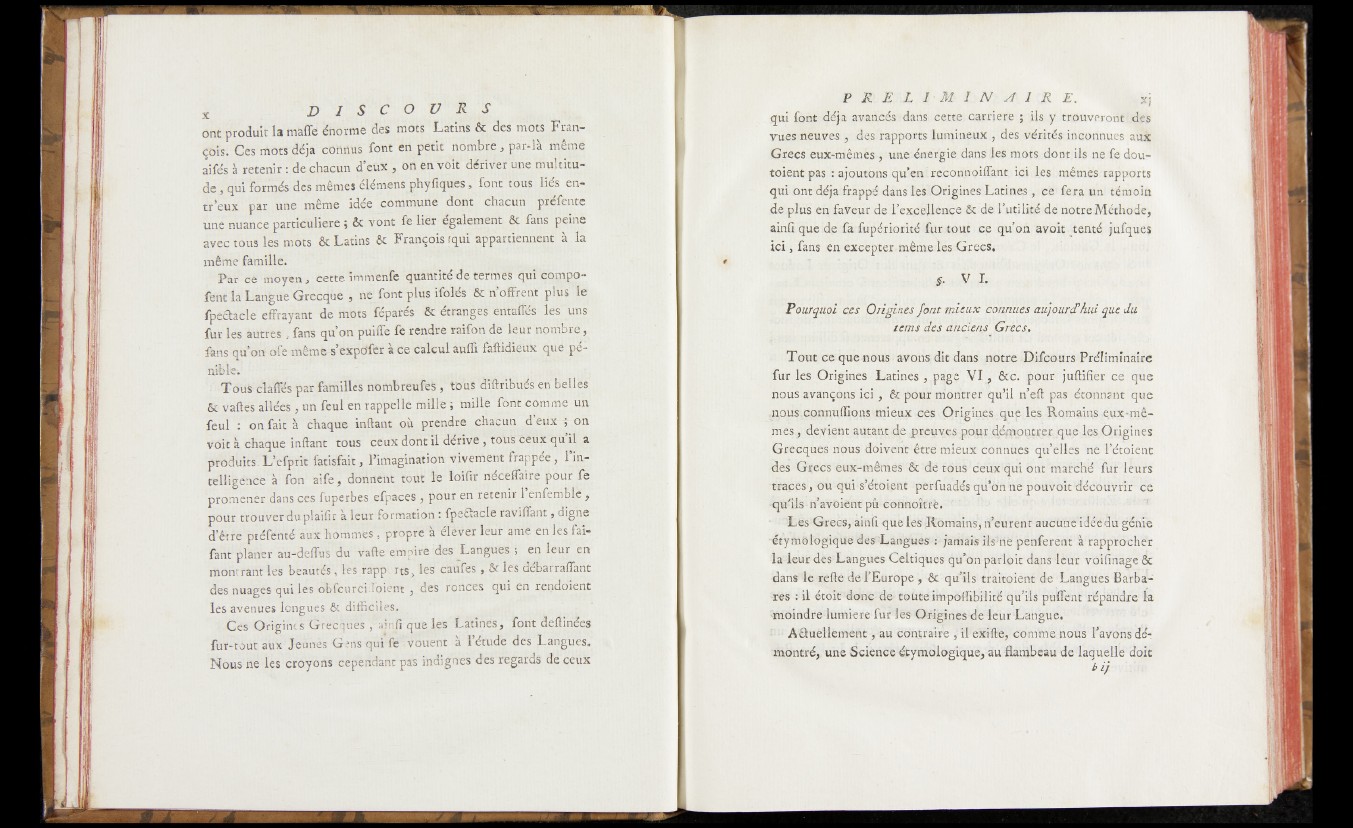
D I S O V R S
ont produit là maffë ëiiorme des riiôl? Latins & des mots Fraà-
0 is; Cès ffiôts déjà ctflWJiè font 'en pêtiCrtomBre, par-là même
aifés à retenir :%t chacun d’eux ,o n èn vblt’ dlrîverÿne multitude.,
quilormà des nrêmes'élémens^hyfîques, font tous l i § en^i
fr’eux par une même idéê ^commune dont ' chacun préfente
unie nuance particulière ; & vont felier également & fans peine
avec tous les mots & Latins ;& François fqui appartiennent* à la
même famille.
P àlrëê%ôyen r fcèttë:iïftrôenre quantité de téfffi'èg quicocngo-
fent la LartgUte Grecque | ne1 font plus ifblés & n’offrent" plus le
fpéâaele effrayant de mots féparés & étranges entaffés les lm|
fut les àtitres , fattlqu on puiffe fe rendre raifoh de' leür>ot|hxh|.
qu ori- ofe mèmè-s’expofer à ce calcul auffi fâftidiéüx c^uépé-
nible-.:
f Toüfc^làftésfar familles nombreux, tous âïÆnfeu^én belles
& vaftés allées^ un feul en rappelle mille ; mille un
feul : on fait ^f chaque înftant où prendre ctiatun deüx2^ nn
voit à chaque inftant tous ceux dont il dérivé, tÔVF&èüx qii il a
produits. L ’efprit fatisfait, l’imagination vivemeht ffappéë,
tëlîigâicë à: îbn' atfe, dbÀnent toütf le l'oifrf nëceffaire pour ïe
promener dans ces fuperbes efpaces , pour en retenir 1 enfembîe ,
pour trouver duplaifir à leur formation : fpe&acle raviffant, digpe
d’être préfenté aux hommes', propre à #èVër leur ame en ieH&i
fant planer au-deffiiplu vafte empire des Langues ; en leur en
montrant lés beautés , les rapports, les caufes , & les dèbarraffant
des nuages qui les obfcurci Joient , des ronces qui en rendoient
les avenues longues & difficiles.
Ces Origines Grebfuls , :amfi que les Latines, font deffiriées
fur-tout aux Jetinés Gens qui fe vouent à l’étude des Langues.
Nous ne les croyons cependant pas indignes des regards de ceux
P m E L i M I N . A J R E . ,xj
■ qui font déjà .avaàcésrdans - cette, aatrierë $ ils y trouveront'.des
vues neuves ^ désir apports lumineux , des vérités inconnues aui
Grecs eux-mêmës, une.éraergie dans lë$ mots dont.ils ne fe dou-
toient pas : ajoutons -qu’en t r.e:cbEtnçilfartt. ici lesj. mêmes rapports
quiontdéja frappé dans lësiOriginesdLatines, ce' fera an témoin
de plus en faveur de l'excellence & de Futilité de notreMéthode,
ainfî queidp Là'fupérrorité jfur tout cp qu’on avoit tenté jufqueç
i c i , fans on excepter, même/lès' Gf ecs;
^ V L
PoifrqÜ/pi çcs Origines font mieux pommés etujourj?hui que dit
tems des anciens Greçp.
Tou© ce*que-no® âvoiiS;dit dans potre -Difcours Préliminaire
fur les Origines Latines 3ïp’age V I , ôcc. pour juftifiërme que
hoUs'a,vaM^l^s ici , & pour montrer’qu’il n’efl pas étonnant que
^o^jqp^i^ffiqjqsttniéaqc .çes •
Grecques mous dôivënfcïêtrë mieux connues qu’elles ne l’étoieht
Mes 'G^è^^ux^mêMês' '■ & “dé tdhPdëux ;4ùi ont miarëhë fur lèurs
*t?rapés;, ôuqübs^étôipnt perfuadës qü’èfn ne pouvoir découvrir; ! ce
•qüflls i ffiavOidrt# pMioèinolt^. p? :
•étyÉiëfôgique is^Lài^sssPlàdiâis iîs#Hë p éflferênt i : rà^prdchdc
la leur dësTangues Gëltiques qü on-parlOit dains llèur vdifinâge êc
dans:le -neftèdé;FÈarèpe y s8c • qu’ils traitoient de LamgUëslîahba^
-aos : il étolc ddnË-d^ totité ilnpoffibflité qu’ils puffént*rëpahdfe la
moindrelumiere fut 1 fs Origlnèsdéfelir ‘Langue, j
ru; A-'&uéîlëmëftt ,;jau cdiisralre ylPêMffe, é^hifeèiaotis lavdnsdér
montré, une Science éjtymologique, au flambeau de laquelle doit
b i f :