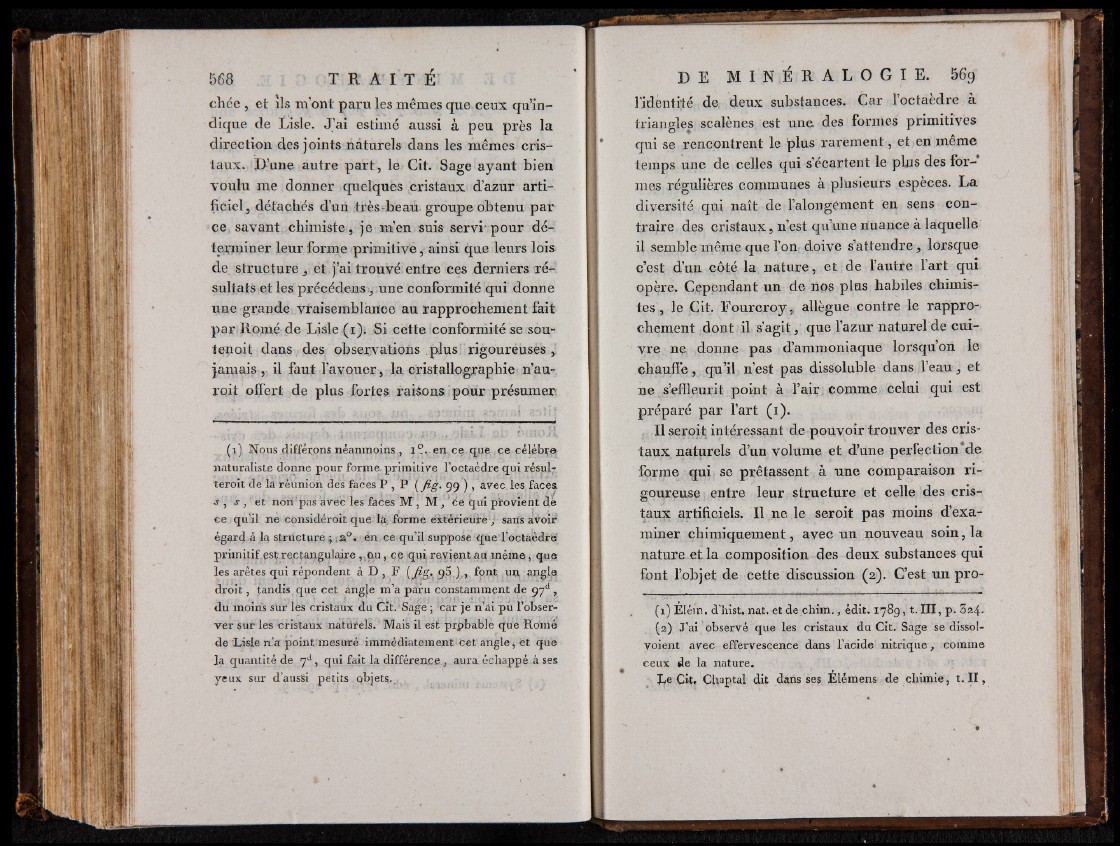
chée , et ils m’ont paru les mêmes que ceux qu’indique
de Lisle. J’ai estimé aussi à peu près la
direction des joints naturels dans les mêmes cristaux.
D’une autre part, le Cit. Sage ayant bien
voulu me donner quelques cristaux d’azur artificiel,
détachés d’un très-beau groupe obtenu par
çe savant chimiste, je m’en suis servi' pour déterminer
leur forme primitive, ainsi que leurs lois
de structure , et j’ai trouvé: entre ces derniers résultats
et les précédons^ une conformité qui donne
une grande vraisemblance au rapprochement fait
par Romé de Lisle (i). Si cette conformité se soutenait
dans des observations plus rigoureuses r
jamais, il faut l’avouer, la cristallographie n’au-
rqit offert de plus fortes raisons pour présumer
(1) Nous différons néanmoins , 1?, en ce que ce célèbre
naturaliste donne pour forme, primitive l’octaèdre qui résul’
teroit de la réunion dès faces P , P (fig. Ç9 ) , avec, les faces
s , s , et non pas avec les faces M , M , Te qui provient dè
ee qu’il ne considéroit que la forme extérieure-; saris avoir
égard à la structure ; en ce qu’il suppose queToctaèd.re
primitif est rectangulaire , ou, ce qui revient.au même, que
les arêtes qui répondent à D , F ( ( } § . ) , font, yn. angle
droit, tandis que cet angje m’a paru constamment de 97d,
du moins sur les cristaux du Cit. Sage-; car je n’ai pu l’observer
sur les cristaux naturels. Mais il est prpbable que Rome
de Lisle n’a point mesuré immédiatement cet angle , et que
la quantité de 7e1, qui fait la différence , aura échappé à ses
yeux sur d’ausSi petits qbjets.,.,>:
l’identité de deux substances. Car l’octaèdre à
triangles scalènes est une des formes primitives
* ,
qui se rencontrent le plus rarement, et en meme
temps une de celles qui s’écartent le plus des for-*
mes régulières communes à plusieurs espèces. La
diversité qui naît d e T a lo n gement en sens contraire
des cristaux, n’est qu’une nuance à laquelle
il semble même que l’on doive s’attendre, lorsque
c’est d’un côté la, nature, et de l’autre l’art qui
opère. Cependant un de nos plus habiles chimistes
, le Cit. Fourcroy, allègue contre le rapprochement
dont il s’agit , que l’azur naturel de cuivre
ne dorme pas d’ammoniaque lorsqu’on le
chauffe, qu’il n’est pas dissoluble dans l’eau, et
ne s’effleurit point à l’air comme celui qui est
préparé par l’art (i).
Il seroit intéressant de pouvoir trouver des cristaux
naturels d’un volume et d’une perfection “de
forme qui se prêtassent, à une comparaison rigoureuse
entre leur structure et celle des cristaux
artificiels. Il ne le seroit pas moins d’examiner
chimiquement, avec un nouveau soin, la
nature et la composition des deux substances qui
font l’objet de cette discussion (2). C’est un pro-
(x) Eïém. d’hist. nat. et de chim., édit. 178g, t. III, p. 824.
(2) J’ai observé que les cristaux du Cit. Sage se dissol-
yoient avec effervescence dans l’acide nitrique, comme
ceux de la nature.
Le Cit. Chaptai dit dans ses Eléraens de chimie, t. I I ,