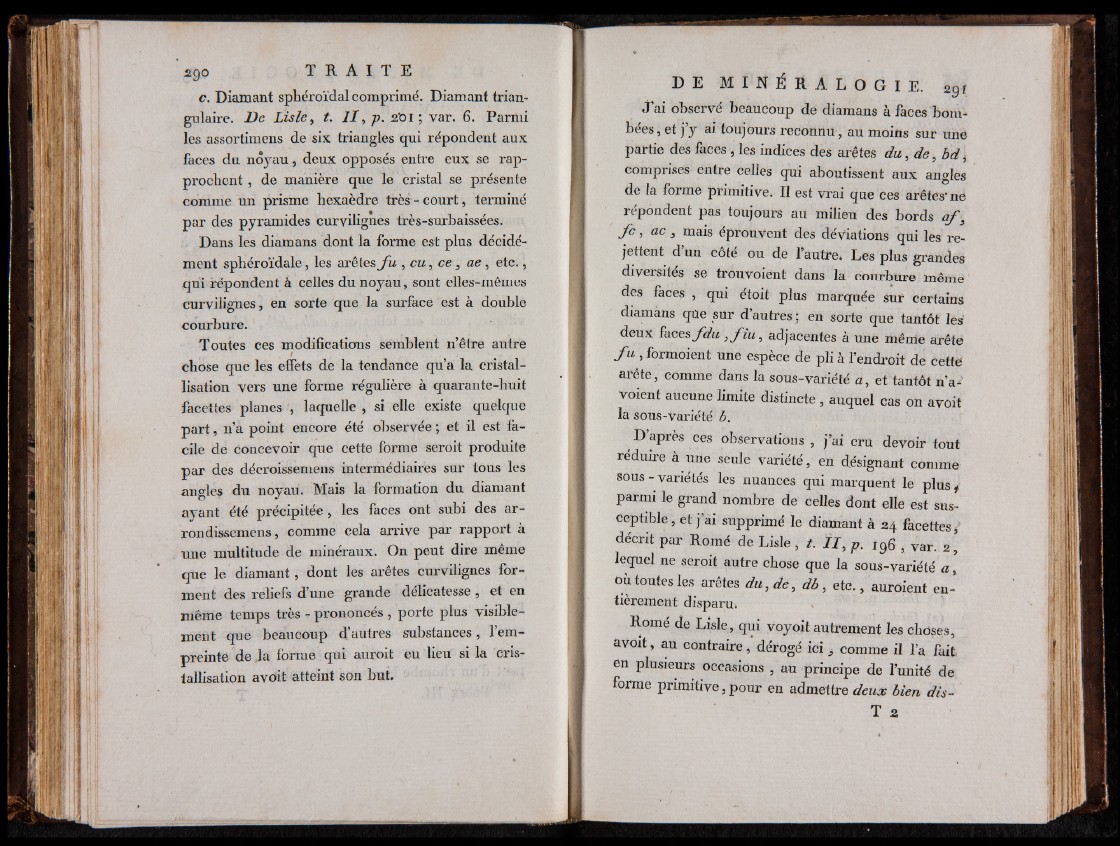
c. Diamant sphéroïdal comprimé. Diamant triangulaire.
De L is le , t. I l , p. 2*01 ; var. 6. Parmi
les assortimens de six triangles qui répondent aux
faces du noyau, deux opposés entre eux se rapprochent
, de manière que le cristal se présente
comme un prisme hexaèdre très-court, terminé
par des pyramides curvilignes très-surbaissées.
Dans les diamans dont la forme est plus décidément
sphéroïdale, les arêtes f u , eu , ce , a e , etc.,
qui répondent à celles du noyau, sont elles-mêmes
curvilignes, en sorte que la surface est à double
courbure.
Toutes ces modifications semblent n’être autre
chose que les effets de la tendance qu’a la cristallisation
vers une forme régulière à quarante-huit
facettes planes , laquelle , si elle existe quelque
p a rt, n’a point encore été observée ; et il est facile
de concevoir que cette forme seroit produite
par des déeroissemens intermédiaires sur tous les
angles du noyau. Mais la formation du diamant
ayant été précipitée, les faces ont subi des ar-
rondissemens, comme cela arrive par rapport à
une multitude de minéraux. On peut dire même
que le diamant, dont les arêtes curvilignes forment
des reliefs d’une grande délicatesse, et en
même temps très - prononcés , porte plus visiblement
que beaucoup d’autres substances, l’empreinte
de la forme qui auroit eu lieu si la cristallisation
avbit atteint son but.
D E M I N É R A L O G I E . 291
J’ai observé beaucoup de diamans à faces boni-
bces, et j y ai toujours reconnu, au moins sur une
partie des faces , les indices des arêtes du, de, bd,
comprises entre celles qui aboutissent aux angles
de la forme primitive. Il est vrai que ces arêtes* ne
répondent pas toujours aü milieu des bords af",
f c , a c y mais éprouvent des déviations qui les rejettent
d un cote ou de l’autre* Les plus grandes
diversités se trouvoient dans la courbtire même
des faces , qui étoit plus marquée sur certains
diamans qüe sur d’autres ; en sorte que tantôt les
deux faces fd u 3f i u , adjacentes à une même arête
f u , formoient une espèce de pli à l’endroit de cette
arête, comme dans la sous-variété a , et tantôt n’a-
voient aucune limite distincte , auquel cas on avoit
la sous-variété b.
D’après ces observations , j’ai cru devoir tout
réduire à une seule variété, en désignant comme
sous- variétés les nuances qui marquent le plus*
parmi le grand nombre de celles dont elle est susceptible
, et j ai supprimé le diamant à 24 facettes,
décrit par Romé de Lisle , t. I I , p. 196 , var. z ’
lequel 11e seroit autre chose que la sous-variété a ,
où toutes les arêtes du, de, d b , etc., auraient entièrement
disparu*
Romé de Lisle, qui voyoit autrement les choses,
avoit, au contraire, dérogé i c i , comme il l’a fait
en plusieurs occasions , au principe de l’unité de
forme primitive, pour en admettre deux bien dis-
T 2