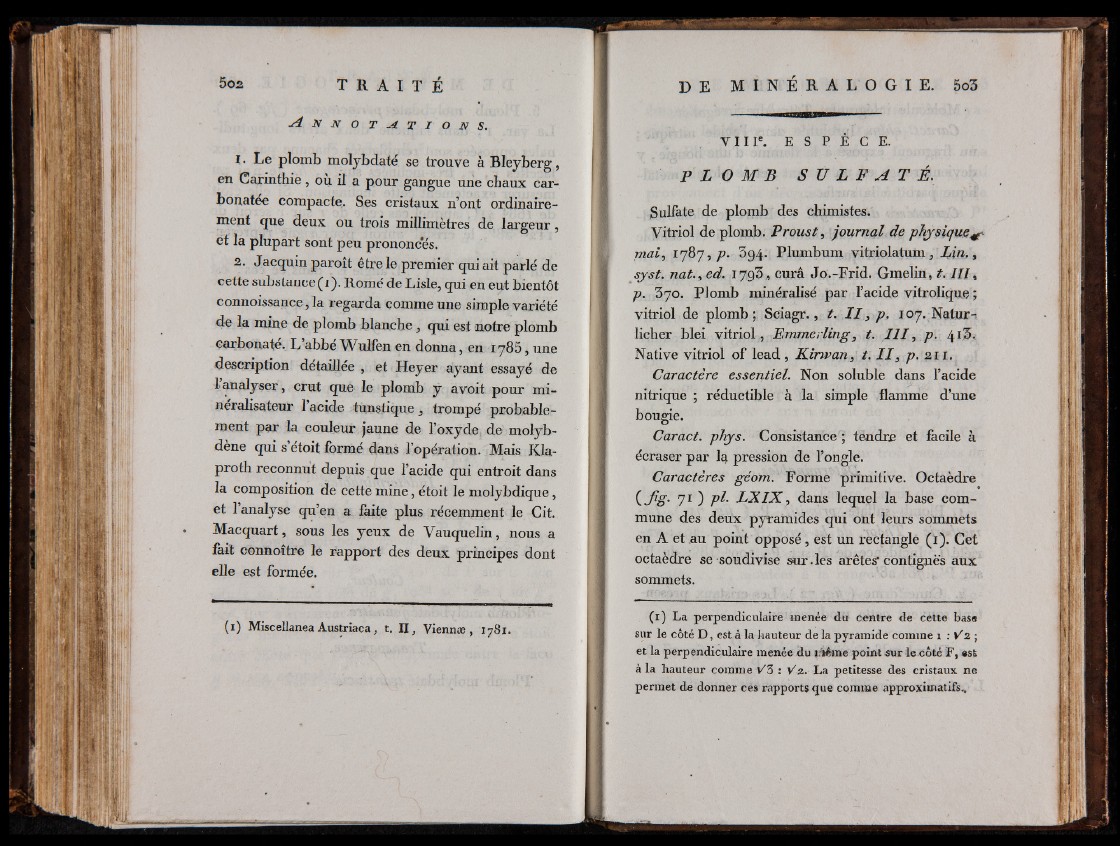
A n n o t a t i o n s .
1 . Le plomb molybdaté se trouve à Bleyberg,
en Carinthie, où il a pour gangue une chaux car-
bonatée compacte. Ses cristaux n’ont ordinairement
que deux ou trois millimètres de largeur,
et la plupart sont peu prononces.
2. Jacquin paroît être le premier qui ait parlé de
cette substance (i). Rome de Lisle, qui en eut bientôt
eonnoissance,la regarda comme une simple variété
de la mine de plomb blanche , qui est notre plomb
carbonate. L ’abbé Wulfen en donna, en 1785, une
description détaillée , et Heyer ayant essayé de
1 analyser, crut que le plomb y avoit pour mi-
néralisateur l’acide tunstique, trompé probablement
par la couleur jaune de l’oxyde de molybdène
qui s etoit formé dans l’opération. Mais Kla-
proth reconnut depuis que l’acide qui entroit dans
la composition de cette mine, étoit le molybdique,
et l’analyse qu’en a faite plus récemment le Cit.
Macquart, sous les yeux de Vauquelin, nous a
fait connoître le rapport des deux principes dont
elle est formée.
(1) Miscellanea Austriaca, t. I I , Viennæ, 1781.
V I I I e. E S P È C E .
P L O M B S U L F A T É .
gulfate de plomb des chimistes.
Vitriol de plomb. Proust, journal de physique^,
mai, 1787, p. 394. Plumbum vitriolatum, Lin. ,
syst. nat., ed. 1793 , curâ Jo.-Frid. Gmelin, t. I I I3
p. 370. Plomb minéralisé par l’acide vitrolique ;
vitriol de plomb; Sciagr., t. I I 3 p. 107. Natur-s
licher blei vitriol, Emmerling, t. I I I , p. 41^.
Native vitriol of lead , Kirwan3 t. I I 3 p. 211.
Caractère essentiel. Non soluble dans l’acide
nitrique ; réductible à la simple flamme d’une
bougie.
Caract. phys. Consistance ; tendre et facile à
écraser par la pression de l’ongle.
Caractères géom. Forme primitive. Octaèdre
wfa* 7 1 ) P l’ L X IX , dans lequel la base commune
des deux pyramides qui ont leurs sommets
en A et au point opposé , est un rectangle (i). Cet
octaèdre se soudivise sur.les arêtes'contiguès aux
sommets.
(1) La perpendiculaire menée du centre de cette base
sur le côté D , est à la hauteur de la pyramide comme 1 : V2. ;
et la perpendiculaire menée du même point sur le côté F, est
à la hauteur comme V3 : Va. La petitesse des cristaux ne
permet de donner ces rapports que comme approximatifs..