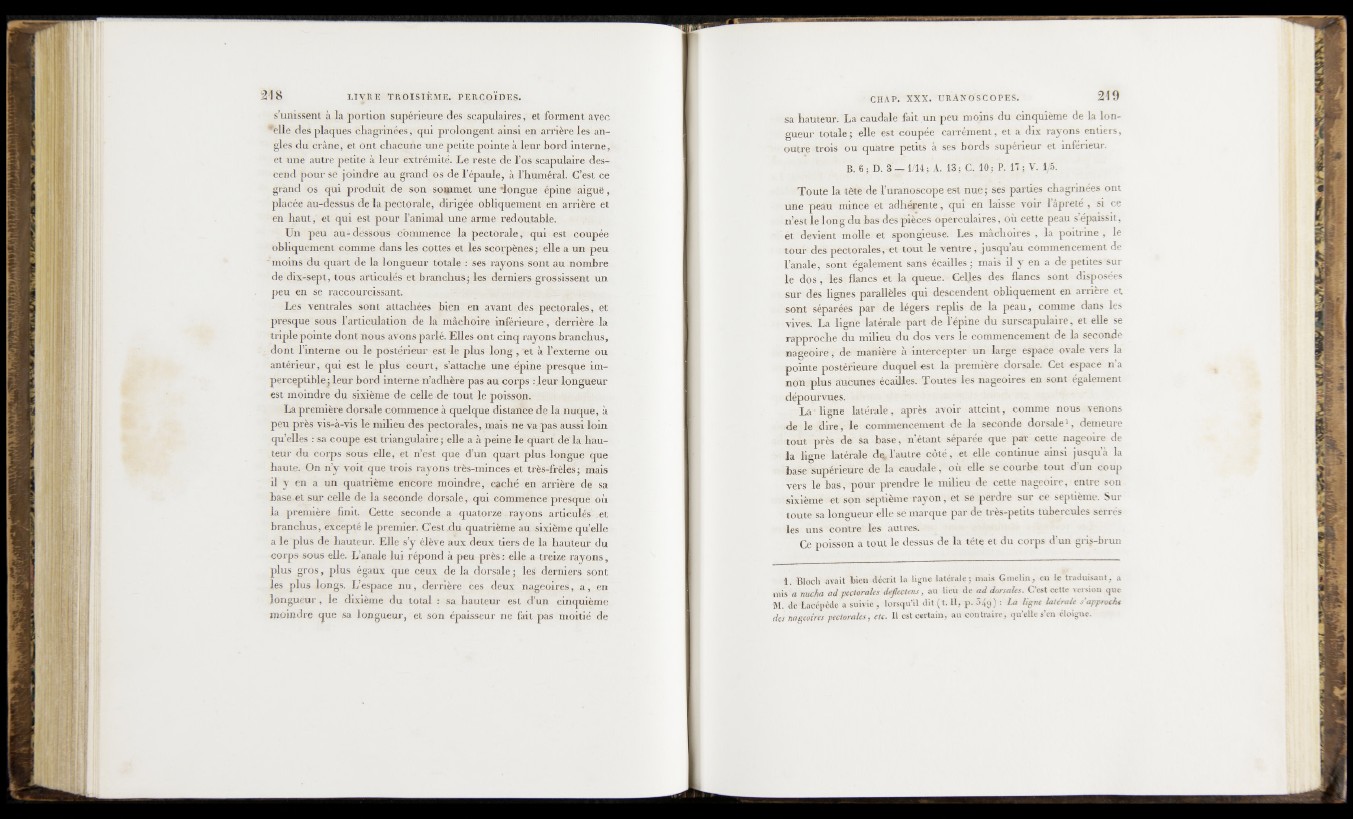
s’unissent à la p o rtio n s.upérieui!e des scapulaires,'et forment: avec
•elle des plaques chagrinées, 'qui prolongent ainsi en arrière les angles
d u crâne, et ö nt chaeuôe unfe petite pointe- a leur bord interne,
et une autre petite à leur extrémité. Le reste de.Iittstscapulaire des^
cend p o u rs ë joindre au grand ©s! die l ’épaufo, à rhuméral. C’est ce
grand os q ui p ro d u it de son - sp pm e t un e «longue épine qôguë,
placée au-dessus de la pectorale, d irig é - obhqüemeüt: en arrière et
en h a u t, et q ui est p o u r l’animal u n ë arme redoutahle. -
Un peu au-dessous- cfommenee la p e c to r a le -q u i i,eS%> coupée
obliquement comme dans les cottes et les scOrpènes- elle a un peu
'm o in s d u quart de la longueur totale : ses rayons-sent au .nombre
de dix-sept, tous âfdculés'èt braaiohüs; les derniers grossissent u n
p e u en,^q r^ceou^cissanL :
Les ventrales sont attachées-bien en avant des > pectorales ^ e t
presque sous l ’artictdation de la-irtâehbire infé rieure , dertièrç.la
triple pointe d o n t nous avons parlé. Elles ont- cinq-rayons branchus,
. d o n t l ’interne o n le pOstérieur est 'le plus loiig , ''et lld fe të rn ê i l i î
antérieur, q ui est le p lus c o u rt, s’attache une •épine<presqù&:im,-
perceplible^ leur bord interne »’adhère pas au GÙrps ijeurriongueur
est moindre d u sixième de celle d e to u t le poisson.
La première dorsale commence à quelque distance de la nuque, à
p eu près vis*à-vis lé milieu des pectorales, mais né va pas. aussi-foin
qu’ellfes § sa coupe ést'triangulaîre ; *eüé--a â peine le q u a rt de la. hauteu
r d u corps sous elle, et n ’est que d’u n quart plus lo j^ u è que
haute. On n ’y voit que .trois rayons tris-m in e e s 'e tjtrès-frêlës;î mais
il y en a Un quatrième etfÊorô moindre, c tch é en arrière de sa
base-et sur celle de la seconde dorsale, qui comnièfrce'preSxqnëôfe
la première „finit. Cette seconde.:-a quatorze-r-rayons articuiéslîjset
b ran ch u s, excepté le premier. Cest jetai quatrième an-sixième qu’elle
a le plus de hauteur. Elle s ’y élève aux deux tiers de la hauteur du
co rp s sous elle. L’anale lui répond à peu près : elle a treize ray o n s,
plus g ró s , plus égaux que ceux de la 4 or pfe;j le# .dèrpiérs, sont
les p lu s longs. L’espace n u , derrière èes deux .nageoires , a , .en
lo n g u e u r, le dixièmé du total : sa hauteur est • d’un cinquième
moindre que sa longueur, et son épaisseur ne fait pas moitié de
sa hauteur. La caudale fait u n peu moins d u cinquième de la longueur
totale ; d ie estieOtipée' carrément, et a dix rayons entiers,
• outre -trois o u quàtre petits à ses bords supérieur et inférieur.
" b!.6 ; D. 3’-= 1/14; A. 13; cl 1 0 ; P. 17; V. 1/5.
Toute la tété de l ’oranoscope est n u e ; ses parties chagrinées ont
une peâu mince et adhérente, q u i en laisse v oir la p r e t e , si ce
-n’est le long du bas despièces operculaires, o ù cette peau s’épaissit,
ét devient molle et spongieuse. Les mâchoires , la poitrine , le
: Sou6 ,d ^ p lew f c te ;- é t ;tdUt le v e n tre , ju sq u ’au commencement de
l’anale, sont également sans écailles ; mais il y en a de petites sur
lé les flancs et la queue. Celles des flancs sont disposées
su r dés lignes parallèles q ui descendent obliquement en arrière et
so in séparées par d e légers replis d e la p e au , eomme dans les
vives;' La ligne latérale p a rt de l’épine du surscapulaire, et elle se
rapproche du milieu du dos vers îè commencement de la seconde
nageéiïé ? de manière à intercepter un large espace ovale vers la
pointe postérieure duquel est la première .dorsale. Cet espace n a
nonyplus aucunes écaiMes. Toutes les nageoires a i sont également
dépourvues, |§j:
La* ligne latérale, après avoir a tte in t, comme nous venons
■de le d ir e ,' le commencement de la seconde dorsale1, demeure
■tout près de sa base, n ’étant séparée q u e par cette nageoire de
la ligne latérale d% l’autre c ô té , et elle continue ainsi jusqu a la
base supérieure de la caudale, o ù elle se courbe to u t d ’un coup
vers le bas, p o u r prendre le milieu de cette nageoire, entre son
sixième -et son septième ray o n , et se perdre sur ce septième. S u r
to u te sa longueur elle sé m arque p a r de très-petits tubercules serrés
les uns contre les autres.
Ce poisson a to u t le dessus de la tête et d u corps d ’u n grig-brun
4. Bloch avait Lien décrit la ligne latérale; mais Gmelin, en le traduisant, a
rhis « nucha a d pectorales deflectens, an lien de a d dorsales. C’est cette version que
M. de Lac'épcde a suivie , lorsqu’il dit (t. lî, p. 34gj) : La ligne latérale s’approche
des nageoires pectorales, etc. Il est certain, an contraire, qu’elle s’en éloigne.
si
m