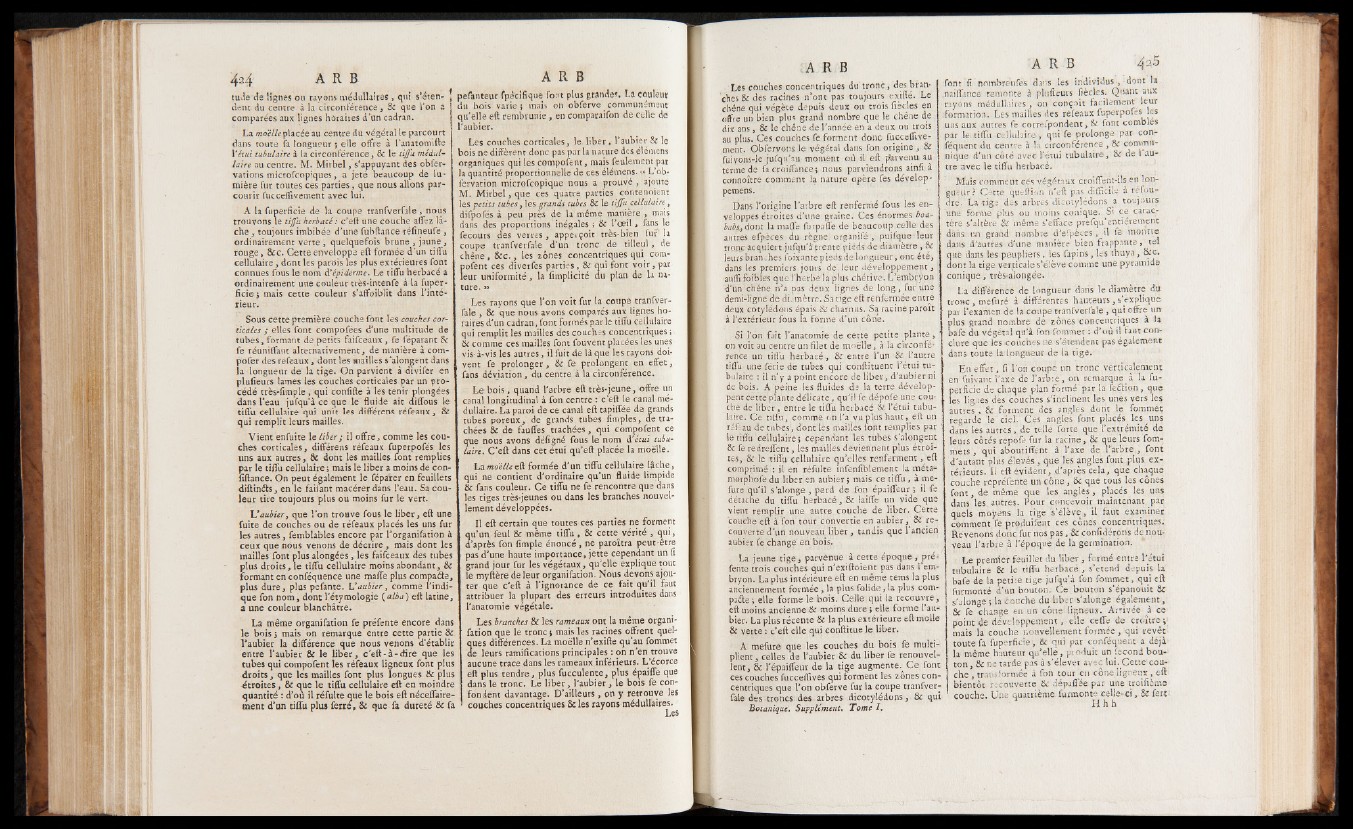
| t | A R B
tulle de lignes ou rayons médullaires , qui s'étendent
du centre à la circonférence , 8c que Ton a
comparées aux lignes horaires d'un cadran.
La moelle placée au centre du végétal le parcourt
dans toute fa longueur ; elle offre à l’anatomifte
Y étui tubulaire à la circonférence , & le tijfu médullaire
au centre. M. Mirbel, s'appuyant des obier-
vations microfcopiques, a jete beaucoup de lumière
fur toutes ces parties, que nous allons parcourir
fucceflivement avec lui.
A la fuperficie de la coupe tranfverfale, nous
trouvons le tijfu herbacé : c’eft une couche aflfez lâche
, toujours imbibée d'une fubflance réfineufe ,
ordinairement v e r te , quelquefois brune , jaune,
rouge, & c . Cette enveloppe eft formée d ’un tiflu
cellulaire, dont les parois les plus extérieures font
connues fous le nom <Yépiderme. Le tiflu herbacé a
ordinairement une couleur très-intenfe à la fuper- .
fic ie ; mais cette couleur s’affoiblit dans l'intérieur.
Sous cette première couche font les couches corticales
s elles font compofées d’une multitude de
tubes, formant de petits faifceaux, fe féparant &
fe réunifiant alternativement, de manière à com-
pofer desréfeaux, dont les mailles s'alongent dans
la longueur de la tige. On parvient à divifer en
plufieurs lames les couches corticales par un procédé
très-fimple, qui confifte à les tenir plongées
dans l’eau jufqu’à ce que le fluide ait diffous le
tiflu cellulaire qui unit les différens réfeaux, &
qui remplit leurs mailles.
Vient enfuite le liber ; il offre, comme les couches
corticales, différens réfeaux fuperpofés les
uns aux autres, & dont les mailles font remplies
par le tiflu cellulaire 5 mais le liber a moins de con-
fiftance. On peut également le fépairer en feuillets
diftin&s, en le faifant macérer dans l’eau. Sa couleur
tire toujours plus ou moins fur le vert.
Uaubier, que l ’on trouve fous le liber, eft une
fuite de couches ou de réfeaux placés les uns fur :
les autres, fembîables encore par l’ organifation à
ceux que nous venons de décrire, mais dont les
mailles font plus alongées, les faifceaux des tubes
plus droits, le tiflu cellulaire moins abondant, &
formant en conféquence une maffe plus compacte,
plus dure, plus pefante. Vaubier, comme l’indique
fon nom, dont l’étymologie (a/Æa) eft latine,
a une couleur blanchâtre.
La même organifation fe préfente encore dans
le bois j mais on remarque entre cette partie &
l*aubier la différence que nous venons d’établir
entre l’aubier & le lib e r , c ’eft-à-d ire que les
tubes qui compofent les réfeaux ligneux font plus
d ro its, que les mailles font plus longues & plus
étroites, & que le tiflu cellulaire eft en moindre
quantité : d'ou il réfulte que le bois eft néceflaire-
ment d’un tiflu plus ferre, & que fa dureté & fa
A R B
; pefanteur fpécifique font plus grandes. La couleur
I du bois varie ; mais oh obferve ^ communément
j quelle eft rembrunie, en comparaifon de celle de
l l ’aubier.
Les couches corticales, le. liber, l’aubier 8c le
bois ne diffèrent donc pas par la nature des élémens
organiques qui les compofent, mais feulement par
la quantité proportionnelle de ces élémens. « L’ob-
fervation microfcopique nous a prouvé , ajoute
M. Mirbel, que ces quatre parties contenoient
les petits tubes, les grands tubes & le tijfu cellulaire,
difpofés à peu près de la même manière, mais
dans des proportions inégales ; & l’oe j l , fans le
fecours des verres , appei çoit très-bien fur' la
coupe tranfverfale d’ un tronc de tilleul, de
chêne, & c . , lès zônes concentriques qui compofent
ces diverfes parties, & oui font v o ir , par
leur uniformité, la fimplicité du plan de 1a nature.
»»
Les rayons que l’on voit fur la coupe tranfverfale
, & que nous avons comparés aux lignes horaires
d’un cadran, font formés par le tiflu cellulaire
qui remplit les mailles des couches concentriques ;
& comme ces mailles font fouvent placées les unes
vis-à-vis les autres, il fuit de laque les rayons doivent
fe prolonger, & fe prolongent en effet,
fans déviation, du centre à la circonférence.
Le bois, quand l’arbre eft très-jeune, offre un
canal longitudinal à fon centre : c ’eft le canal-médullaire.
La paroi de ce canal eft tapiffée de grands
tubes poreux, de grands tubes Amples, de trachées
& de fauffes trachées, qui compofent ce
que nous avons défigné fous le nom d'étui tubulaire.
C ’eft dans cet étui qu’eft placée la moelle.
j La moelle eft formée d’ un tiflu cellulaire lâche,
qui ne contient d’ordinaire qu’ un fluide limpide
& fans couleur. C e tiflu ne fe rencontre que dans
les tiges très-jeunes ou dans les branches nouvellement
développées.
Il eft certain que toutes ces parties ne forment
qu’ un feul & même tiflu , & cette^vérité, qui,
d’après fon Ample énoncé, ne paroîtra peut-être
pas d’une haute importance, jette cependant un A
grand jour fur les végétaux, qu’elle explique tout
le myftère de leur organifation. Nous devons ajouter
que c’eft à l’ ignorance de ce fait qu’il faut
attribuer la plupart des erreurs introduites dans
l’anatomie végétale.
Les branches & les rameaux ont la meme organifation
que le tronc ; mais les racines offrent quel-
ues différences. La moelle n’exifte qu’au fommet
e leurs ramiAcations principales : on n'en trouve
aucune trace dans les rameaux inférieurs. L’écorce
Ieft plus tendre, plus fucculente, plus épaiffe que
dans le tronc. Le libe r , l'aubier, le bois fe confondent
davantage. D’ailleurs, on y retrouve les
couches concentriques & les rayons médullaires.
font A nombretifes dans les individus-, dont la
.naiflance remonte à plufieurs Aècles. Quant aux
rayons médullaires, on conçoit facilement leur
formation. Les mailles des réfeaux fuperpôfes les
uns aux autres fe correfpondent, & font combles
par le. tiflu cellulaire , qui fe prolonge par con-
féquent du centre à la circonférence, 8c communique
Les couches concentriques du' tronc, des branches
8c des racines n’ont pas toujours exifté. Le ,
chêne qui végète depuis deux ou trois fiècles en
offre un bien plus grand nombre que le chêne de
dix ans, & le chêne de l'année en a deux ou trois
au plus. Ces couches fe forment donc fucceflivement.
Obfervons le végétal dans fon origine, &
fuivons-le jufquîau moment où il eft parvenu au
terme de facroiflance; nous parviendrons ainfi à
connoître comment la nature opère fes dévelop-
pemens.
Dans l’origine l'arbre eft renfermé fous les enveloppes
étroites d’une graine. Ces énormes boa-
babfo dom la maffe furpafle de beaucoup celle des
autres efpèces du règne, organifé , puifque leur
tronc acquiert jufqu’i ^rente piéds de diamètre, 8c 11
leurs branches foixante pieds de longueur, ont été* ■
dans les premiers jours de . leur développement, •
aufli foibles que l’herbe la plus chétive. L’embryon
d’ün chêne n’a pas deux lignes de long, fur unè
demi-ligne de diamètre. Sa tige eft renfermée entre
deux cotylédons épais & charnus. Sa racine paroit
à l’extérieur fous la forme d'un cône.
Si l'on fait l'anatomie de cette petite plante,
on voit au centre un filet de moelle, à la circonférence
un tiflu herbacé, & entre l'un & l’autre
tiflu une férié de tubes qui conftituent l’étui tubulaire
: il n’y a point encore de liber, d’aubier ni
de bois. A peine des fluides dt la terre développent
cette plante délicate, qu'il fe dépofe une couche
de liber, entre le tiflu herbacé & l’étui tubulaire.
Ce tiflu, comme on l’a vu plus haut, eft un
réfeau de tubes, dont les mailles font remplies par ’
le tiflu cellulaire, cependant les. tubes s'alongent
& fe redreflent, les mailles deviennent plus étroites,
8c le tiflu cellulaire qu’elles renferment, eft
comprimé : il en réfulte infenfiblement la méta-
morphofedu liber en aubier; mais ce tiflu, à me-
fure qu’ il s'alonge, perd de fon épaiffeur ; il fe
détache du tiflu herbacé, 8c laiffe un vide que
vient remplir une autre, couche de liber. Cette
couche eft à fon tour convertie en aubier, & recouverte
d'un nouveau liber , tandis que l'ancien
aubier fe change en bois.
La jeune tig e , parvenue à cette époque, p ré fente
trois couches qui n’exiftoient pas dans 1 embryon.
La plus intérieure eft en même tems la plus
anciennement formée, la plus folide, la plus compacte;
elle forme le bois. Celle;qui la recouvre,
eft moins ancienne & moins dure ; elle, forme l’au-
bier. La plus récente & la plus extérieure eft molle
& verte c’ eft elle qui conftitue Je liber.
A mefure que les couches du bois fe multiplient,
celles de l’aubier 8c du liber fe renouvellent,
& l’épaifleur de la tige augmente.^Ce font
ces couches fucceflives qui forment les zones concentriques
que l’on obferve fur la coupe tranfverfale
des troncs; des arbres dicotylédons, & qui
Botanique, Supplément, Tome l.
d’un côté avec l'étui tubulaire, & de 1 autre
avec le tiflu herbacé.
Mais comment ces végétaux croiffent-ils en longueur?
Cette queftion n’eft pas difficile à réfoudre.
La-tige des arbres dicotylédons a toujours
une forme plus ou moins conique. Si ce caractère
s’altère & même s’efface prefqu’ entiéremenc
dans u*n grand nombre d’efpèces, il te montre
dans d’autres d'une manière bien frappante, tel
quë dans les peupliers, les fapsn’s , les thuya, & c .
dont la tige verticale s'élève comme une pyramide
conique, très-alongée.
La différence de longueur dans le diamètre du
tronc, mefuré à différentes hauteurs, s’explique
par l’examen de la coupe tranfverfale, qui offre un
plus grand nombre de zones concentriques à là
| bafe du végétal qu’à fon fommet : d’ où il faut conclure
que les coiiches ne s’étendent pas également
dans toute la longueur de la tige.
En effe t, fi l'on coupe un tronc verticalement
en fuivant l'axe de l ’arbre, on remarquera la fuperficie
de chaque plan formé par la îçétion , que
les lignes des couches s’ inclinent les unes vers les
autres , & forment des angles dont le fommet
regarde le cieli Ces angles font placés les uns
dans les autres, de telle forte que l'extrémité de
leurs côtés repofe fur la racine, & que leurs fom-
mets, qui aboutiffent à l’ axe de l’arbre,, font
d’autant plus élevé s, que les angles font plus extérieurs.
Il eft évident, d'après cela, que chaque
couche repréfente un côn e , 8c que tous les cônes
fon t, de même que les angles, placés les uns
dans les autres. Pour concevoir maintenant par
quels moyens la tig e 's ’élève , il faut examiner
comment fe pro.duifent ces cônes concentriques.
Revenons donc fur nos pas, & confidérons de nouveau
l'arbre a l’époque de la germination.
Le premier feuillet du liber , formé entre l ’étui
tubulaire & le tiflu herbacé,, s’étend depuis la
bafe de la petite tige jufqu’à fon fommet, qui eft
ftirmonté d’ un bouton. C e bouton s’épanouit &
s’alonge ; la couche du liber s’ alonge également-,
& fe change en un cône ligneux. Arrivée à ce
point de développement »«elle ceffe de croître;;
mais la couche nouvellement formée, qui revêt
toute fa fuperficie, & qui par conféquent a déjà
la même hauteur qu’e lle , produit un fécond bouton
, & ne tarde pas à s’élever avec lui. Cette couche
, transformée à fon tour en cône ligneux, eft
bientôt recouverte & dépafiee par une troifieme
couche. Une quatrième furmonte celle-ci, 8c ferc-
H h h