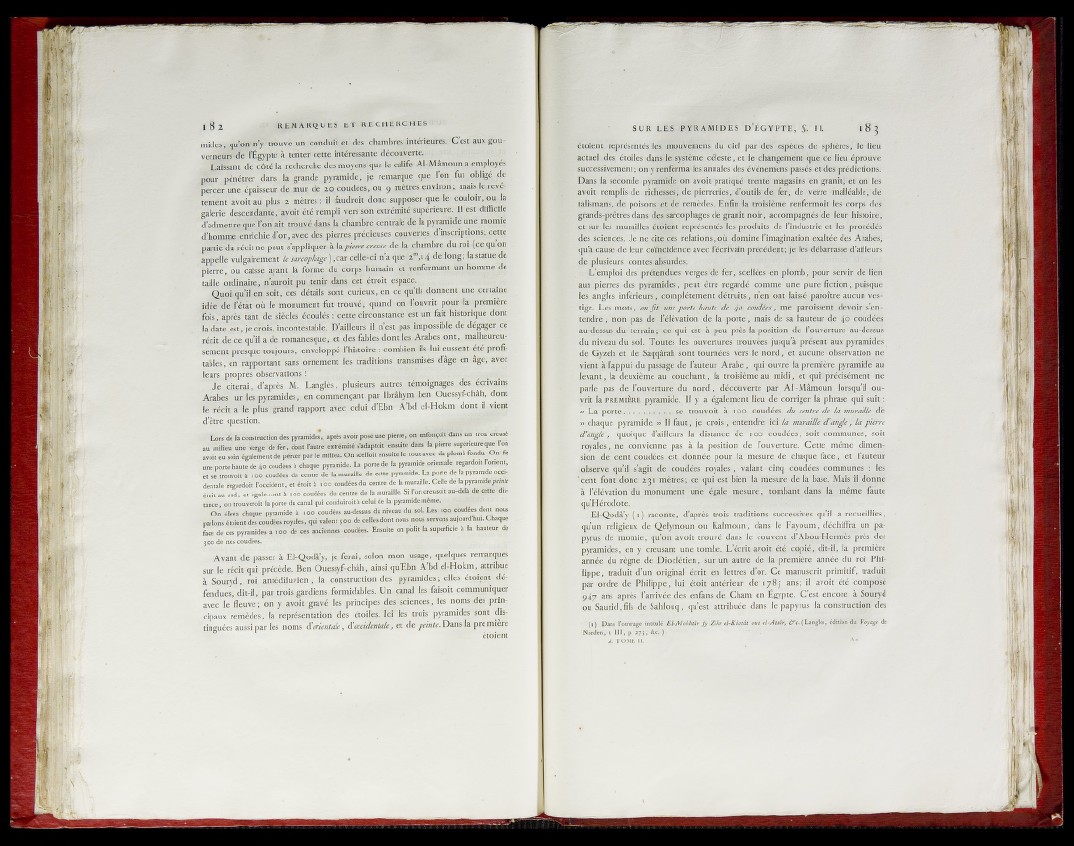
mides, qu’on n’y trouve un conduit et des chambres intérieures. C’est aux gouverneurs
de i’Égypte à tenter cette intéressante découverte.
Laissant de côté la recherche des moyens que le calife AI-Mâmoun a employés
pour pénétrer dans la grande pyramide, je remarque que l’on fut obligé de
percer une épaisseur de mur de 20 coudées, ou 9 mètres enviion, mais le reve-
tement avoit au plus 2 mètres : il faudroit donc supposer que le couloir, ou la
galerie descendante, avoit été rempli vers son extrémité supérieure. Il est difficile
d’admettre que l’on ait trouvé dans la chambre centrale de la pyramide une momie
d’homme enrichie d’or, avec des pierres précieuses couvertes d inscriptions; cette
partie du récit ne peut s’appliquer à la pierre creuse de la chambre du roi (ce qu on
appelle vulgairement le sarcophage ), car celle-ci n’a que 2m,i4 de long; la statue de
pierre, ou caisse ayant la forme du corps humain et renfermant un homme de
taille ordinaire, n’auroit pu tenir dans cet étroit espace.
Quoi qu’il en soit, ces détails sont curieux, en ce qu’ils donnent une certaine
idée de l'étàt où le monument fut trouvé, quand on l’ouvrit pour la première
fois, après tant de siècles écoulés : cette circonstance est un fait historique dont
la date est, je crois, incontestable. D’ailleurs il nest pas impossible de dégager ce
récit de ce qu’il a de romanesque, et des fables dont les Arabes ont, malheureusement
presque toujours, enveloppé l’histoire : combien ils lui eussent été profitables,
en rapportant sans ornement les traditions transmises dâge en âge, avec
leurs propres observations !
Je citerai, d’après M. Langlès, plusieurs autres témoignages des écrivains
Arabes ur les pyramides, en commençant par Ibrâhym ben Ouessyf-chah, dont
le récit a le plus grand rapport avec celui d Ebn A bd el-Hokm dont il vient
d’être question.
Lors de la construction des pyramides, après avoir posé une pierre, on enfonçoit dans un trou creusé
au milieu une verge de fe r , dont l’autre extrémité s’adaptoit ensuite dans la pierre supérieure que Ion
avoit eu soin également de percer par le milieu. O n scelloit ensuite le tout avec du plomb fondu. O n fit
une porte haute de 4o coudées à chaque pyramide. La porte de la pyramide orientale regardott l’orient ,
et se trouvoit h 100 coudées du centre de la muraille de cette pyramide. La porte de la pyramide oc c identale
regardoit l'oc c id ent, et étoit à .0 0 coudées du centre de la muraille. C e lle de la pyramide prit,«
étoit au sud, et également à 100 coudées du centre de la muraille. Si l’on creusott au-delà de cette distance
, on trouverait la porte du canal qui conduirait à celui de la pyramide même.
O n éleva chaque pyramide à 100 coudées au-dessus du niveau du sol. Le s 100 coudées dont nous
parlons étoient des coudées royales, qui valent 5 00 de celles dont nous nous servons aujourd’hui. Chaque
face de ces pyramides a 100 de ces anciennes coudées. Ensuite on polit la superficie à la hauteur de
200 de nos coudées.
Avant de passer à El-Qodâ’y, je ferai, selon mon usage, quelques remarques
sur le récit qui précède. Ben Ouessyf-châh, ainsi qu’Ebn A ’bd el-Hokm, attribue
à Souryd, roi antédiluvien, la construction des pyramides; elles étoient défendues,
dit-il, par trois gardiens formidables. Un canal les faisoit communiquer
avec le fleuve ; on y avoit gravé les principes des sciences, les noms des principaux
remèdes, la représentation des étoiles. Ici les trois pyramides sont distinguées
aussi par les noms S orientale, d’occidentale, et de peinte. Dans la première
étoient
S U R L E S P Y R A M I D E S D ’É G Y P T E , § . I I . I 8 2
étoient représentés les mouvemens du ciel par des espèces de sphères, le lieu
actuel des étoiles dans le système céleste, et le changement que ce lieu éprouve
successivement; on y renferma les annales des événemens passés et des prédictions.
Dans la seconde pyramide on avoit pratiqué trente magasins en granit; et on les
avoit remplis de richesses, de pierreries, d’outils de fer, de verre malléable, de
talismans, de poisons et de remèdes. Enfin la troisième renfermoit les corps des
grands-prêtres dans des sarcophages de granit noir, accompagnés de leur histoire,
et sur les murailles étoient représentés les produits de l’industrie et les procédés
des sciences. Je ne cite ces relations, où domine l’imagination exaltée dés Arabes,
qu’à cause de leur coïncidence avec l’écrivain précédent; je les débarrasse d’ailleurs
de plusieurs contes absurdes.
L’emploi des prétendues verges de fer, scellées en plomb, pour servir de lien
aux pierres des pyramides, peut être regardé comme une pure fiction, puisque
les angles inférieurs, complètement détruits, n’en ont laissé paroître aucun vestige.
Les mots, on fit une porte haute de 4o coudées, me paroissent devoir s’entendre
, non pas de l’élévation de la porte, mais de sa hauteur de 4° coudées
au-dessus du terrain ; ce qui est à peu près la position de l’ouverture au-dessus
du niveau du sol. Toutes les ouvertures trouvées jusqu’à présent aux pyramides
de Gyzeh et de Saqqârah sont tournées vers le nord, et aucune observation ne
vient à l’appui du passage de l’auteur Arabe, qui ouvre la première pyramide au
levant, la deuxième au couchant, la troisième au midi, et qui précisément ne
parle pas de l’ouverture du nord, découverte par Al-Mâmoun lorsqu’il ouvrit
la p r e m i è r e pyramide. Il y a également lieu de corriger la phrase qui suit :
« La porte. . . ...............se trouvoit à 100 coudées du centre de la muraille dfe
» chaque pyramide. » Il faut, je crois „ entendre ici ta muraille d'angle, la pierre
d’angle, quoique d’ailleurs la distance de 100 coudées, soit communes, soit
royales, ne convienne pas à la position de l’ouverture. Cette même dimension
de cent coudées est donnée pour la mesure de chaque face, et l’auteur
observe qu’il s’agit de coudées royales, valant cinq coudées communes : les
'cent font donc 231 mètres; ce qui est bien la mesure de la base. Mais il donne
à l’élévation du monument une égale mesure, tombant dans la même faute
qu’Hérodote.
El-Qoday (i) raconte, d’après trois traditions successives qu’il a recueillies,
qu’un religieux de Qelymoun ou Kalmoun, dans le Fayoum, déchiffra un papyrus
de momie, qu’on avoit trouvé dans le couvent d’Abou-Hermès près des
pyramides, en y creusant une tombe. L ’écrit avoit été copié, dit-il, la première
année du règne de Dioclétien, sur un autre de la première année du roi Philippe,
traduit d’un original écrit en lettres d’or. Ce manuscrit primitif, traduit
par ordre de Philippe, lui étoit antérieur de 178 j ans; il avoit été composé
947 ans après l’arrivée des enfans de Cham en Égypte. C est encore à Souryd
ou Saurid, fils de Sahlouq, qu’est attribuée dans le papyrus la construction des
(1) Dans l’ouvrage intitulé El-Mohhtir fy Zikr tl-Khotâi 011a tl-Atsâr, ¿Te. (Langlès, édition du Voyage de
Norden, t. 111, p. 273, &c. )
A. TOME II. H