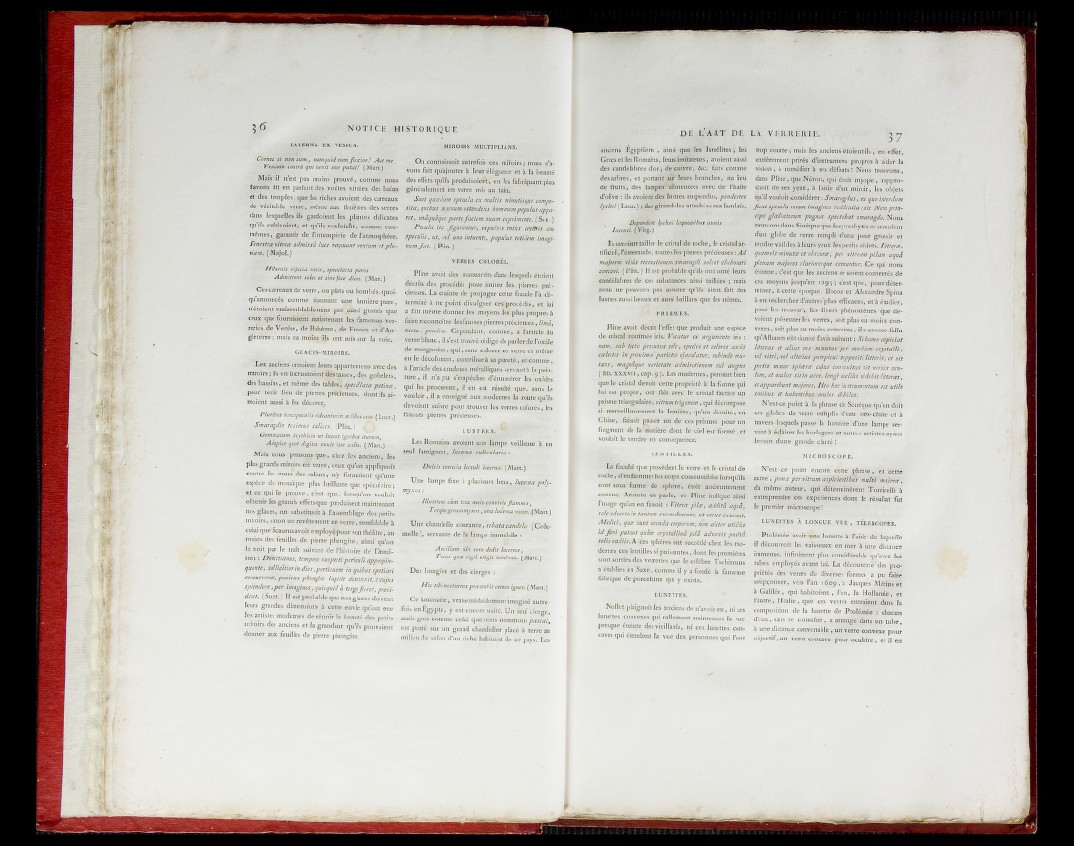
LATERNA EX VESICA.
Cornea si non sum, numquid sum fuscior! Autme
Vesicam contrà qui venit esse putat! (Marr.)
Mais il n ’est pas moins prouvé, comme nous
l ’avons dit en parlant des voûtes vitrées des bains
e t des temples, que les riches avoient des carreaux
de véritable v erre, même aux fenêtres des serres
dans lesquelles ils gardoient les plantes délicates
qu’ils cultivoient, et qu’ils vouloient, comme eux-
mêmes, garantir de l ’intempérie de l ’atmosphère.
Fenestroe vitreoe admissâ luce respuunt ventum et plu-
viam. (M a jol.)
Hibernis objecta notis, specularia puros
Admittunt soles et sine fece diem. (Mart.)
C e s carreaux de v erre, ou plats ou bombés, quoi-
quannoncés comme donnant une lumière p ure,
n’étoient vraisemblablement pas aussi grands que
ceux que fournissent maintenant les fameuses verreries
de V en ise , de Bohème, de France e t 'd ’A n gleterre
; mais au moins ils ont mis sur la voie.
GLACES-MIROIRS.
L e s anciens ornoient leurs appartemens avec des
miroirs ; ils en incrustoient des tasses, des gobelets,
des bassins, et même des tables, specillata patina,
pour tenir lieu de pierres, précieuses, dont ils ai-
moient aussi à les décorer.
Pluribus hæcspecuüs videanturin oe.libus esse. ( Lucr.)
Smaragdis teximus calices. (P lin .) 5
Gemmatum Scythicis ut luceat ignibus aurum,
Adspice quot digitos exuit iste calix. (Mart.)
Mais nous pensons q u e , chez les anciens, les
plus grands miroirs en verre, ceux qu’on appliquoit
contre les murs des salons, n’y fbnnoient qu’une
espèce de mosaïque plus brillante que spéculaire ;
et ce qui le p ro u v e , c ’est q ue, lorsqu’on vouloit
obtenir les grands effets que produisent maintenant
nos g la ces , on substituoit à l ’assemblage des petits
miroirs, sinon un revêtement en verre, semblable à
celui que Scaurus avoit employé pour son théâtre, au
moins des feuilles de pierre p h engite, ainsi qu’on
le voit par le trait suivant de l ’histoire de Donii-
tien : Domitianus, tempore suspecti periculi appropin-
quante, sol/icitior indies, porticuum in quibus spatiari
consueverat, parietes phengite lapide distinxit, c cujus
splendore, per imagines, quicquid à tergo fu r e t, provi-
deret. (Suet. ; II est probable que nos glaces doivent
leurs grandes dimensions à cette envie qu’ont eue
les artistes modernes de réunir la beauté des petits
miroirs des anciens et la grandeur qu’ils pouvoient
donner aux feuilles de pierre phengite.
MIROIRS MULTIPL1 ANS.
O n connoissoit autrefois ces miroirs ; nous n’avons
fait qu’ajouter à leur élégance et à la beauté
des effets qu’ils produisoient, en les fabriquant plus
généralement en verre mis au tain.
Sujit quoedam spécula ex multis minutisque compo-
sita , quibus sbumim ostenderis hominem populus apport
t , unâquâque parte faciern sua/n exprimente. (Sen. )
Pocula ¡ta f i garantit*, expulsis intiis crcbris ceu
speculis, ut, vel uno intuente, populus totidem i/nagi-
num f a t , ( Plin. )
VERRES COLORÉS.
Pline avoit des manuscrits dans lesquels étoient
décrits des procédés pour imiter les. pierres p ré cieuses.
La crainte de propager cette fraude f a déterminé
à ne point divulguer ces procédés, et lui
a fiiit même donner les moyens les plus propres à
faire reconnoître les fausses pierres précieuses, lima,
tac tu , pondéré. C ependant, comme, à l ’article du
verre b lanc , il s’est trouvé obligé de parler de l’oxide
de manganèse, q u i , sans colorer ce verre et même
en le décolorant, contribue à sa p u re té , et com m e ,
à l ’article des couleurs métalliques servant à la peinture
, il n’a pu s’empêcher d’énumérer les oxides
qui les procurent, il en est résulté q u e , sans le
v o u lo ir , il a enseigné aux modernes la route qu’ils
devoient suivre pour trouver les verres coloré s , les
fausses pierres précieuses.
L U S T R E S .
Les Romains avoient une lampe veilleuse h un
seul lumignon, lucerna cubicularia :
Du Ici s conscia lectuli lucernà. (Mart.)
U n e lampe fixe à plusieurs b e c s , lucerna poly-
myxos :
Illustrent cùm tota rneis çonvivia flammis
Totquegeram tnyxos, una lucerna vocor. (Ma r t . )
U n e chandelle courante, sebata candela (C o lu -
melle ) , servante de la lampe immobile :
Ancillatn tibi sors dédit lucerna,
Tutus qutx vigil exigit tendras. (Mart.)
De s bougies et des cierges :
H ic tibi nocturnos prcestabit cereus ignés. (Mart.)
C e luminaire, vraisemblablement imaginé autre fois
en E g y p te , y est encore usité. Un seul cierge ,
mais gros comme celui que nous nommons pascal,
est porté sur un grand chandelier placé à terre au
milieu du salon d’un riche habitant de ce pays. Les
anciens Égyptiens , ainsi que les Israélites, les
Grecs et les Romains, leurs imitateurs, avoient aussi
des candélabres d’o r , de cuivre, &c. faits comme
des arbres, et portan t sûr leurs branches, au lieu
de fruits, des lampes5*alimentées avec de l ’huile
d’olive : ils avoient des lustres suspendus, pen dente s
lychni (Lucr.) ; des girandoles attachées aux lambris.
Dependent lychni laquearibus aurcis
Jncensi. ( Virg. )
Ilssavoient tailler le cristal de roche, le cristal artificiel
, l’émeraude, toutes les pierres précieuses : A d
majorem visûs recreationent smaragdi soient elaborari
concavi. ( Plin. ) II est probable qu’ils ont orné leurs
candélabres de ces substances ainsi taillées ; mais
nous ne pouvons pas assurer qu’ils aient fait des
lustres aussi beaux et aussi brillans que les nôtres.
Pline avoit décrit l’effet que produit une espèce
de cristal nommée iris. Vocatur ex argumento iris :
nam, sub tecto percussa sole, species et colores arcus
coelestis in proximos' parietes ejaculatur, subinde mu-
tans , magnâque varietate admirationem sut auoens
( lib. XXX VI I , cap. 9 ). Les modernes, pensant bien
que le cristal devoit cette propriété à la forme qui
lui est propre, ont fait avec le cristal factice un
prisme triangulaire, vitrum trigonum, qui décompose
si merveilleusement la lumière, qu’un Jésuite, en
Chine, faisoit passer un de ces prismes pour un
fragment de la*matière dont le ciel est form é , et
vouloit le vendre en conséquence.
L E N T I L L E S .
La faculté que possèdent le verre et le cristal de
roche, d’enflammer les corps combustibles lorsqu’ils
sont sous forme de sphère, étoit anciennement
connue. Aristote en parle, et Pline indique ainsi
l ’usage qu’on en faisoit : Vitreoe piloe, additâ aquâ,
sole adverso in tantum excandescunt, ut vestes exurant.
Aied ici, qiice sunt urenda corporum, non aliter utilius
id f e r i putant quam crystallinâ pila adversis positâ
solis radiis. A ces sphères ont succédé chez les modernes
ces lentilles si puissantes, dont les premières
sont sorties des verreries que le célèbre Tschirnaus
a établies en S a x e , comme il y a fondé la fameuse
fabrique de porcelaine qui y existe.
NoIIet plaignoit les anciens de n’avoir e u , ni ces
lunettes convexes qui rallument maintenant la vue
presque éteinte des vieillards, ni ces lunettes concaves
qui étendent la vue des personnes qui l’ont
trop cou rte; mais les anciens étoient-ils, en effet,
entièrement privés d’instrumens propres h aider la
vision , à remédier à ses défauts î Nous trouvons,
dans P lin e , que Né ron, qui étoit m y o p e , rappro-
choit de ses y e u x , à l’aide d’un miroir, les objets
qu il vouloit considérer : Smaragdus, ex quo interdum
fiunt specula rerum imagines reddentia : sic Nero prin-
ceps gladiatorum pugnas spectabat smaragdo. Nous
trouvons dans Sénèque que les presbytes se servoient
d’un g lo be de verre rempli d’eau pour grossir et
rendre visibles à leurs yeux lès petits objets. Litteroe,
quam vis minuta et obscur a , per vitream piiam àquà
plenam majores clarioresque cernuntur. C e qui nous
étonne, c’est que les anciens se soient contentés de
ces moyens jusqu’en 12 9 5 ; c’est que , pour déterminer,
à cette époque, Bacon et Alexandre Spina
à en rechercher d’autres plus efficaces, e tà étudier,
pour les trouver, les divers phénomènes que devoient
présenter les verres, soit plus ou moins con- ’
v ex e s , soit plus ou moins concaves, il a encore fallu
qu’AIhasen eût donné l’avis suivant : S i homo aspiciat
litteras et alias res minutas per medium crystalli,
vel vi tri, vel alterius perspicui suppositi litteris, et sic
portio minor sphara cujus convexitas sit versus ocu-
lum, et ocu lus s it in a'ére, longe me Hits vi de bit litteras,
et apparebunt majores. Ideo hoc instrumentum est utile
senibus et habentibus pculos débiles.
N ’est-ce point à la phrase de Sénèque qu’on doit
ces globes de verre remplis d’eau très-claire et à
travers lesquels passe la lumière d’une lampe servant
à éclairer les horlogers et autres artistes ayant
be soin d’une grande clarté î
M I C R O S C O P E .
N ’e s t - c e point encore cette phrase, et cette
autre , poma per vitrum aspicientibus multò majora ,
du même auteur, qui déterminèrent Torricelli à
entreprendre ces expériences dont le résultat fut
le premier microscope î
LUNETTES À LONGUE VUE , TÉLESCOPES.
Ptolémée avoit une lunette à l’aide de laquelle
il découvrait les vaisseaux en mer à une distance
immense, infiniment plus considérable qu’avec les
tubes employés avant lui. La découverte des propriétés
des verres de diverses formes a pu faire
soupçonner, vers l’an 16 0 9 , à Jacques Métius et
à G a lilé e , qui habitoient , l ’un, la H o llan d e , et
l’autre, l’I ta lie , que ces verres entraient dans la
composition de la lunette de Ptolémée : chacun
d’e u x , sans se consulter, a arrangé dans un tu b e ,
à une distance convenable , un verre convexe pour
objec tif, un verre concave pour oculaire, et il en