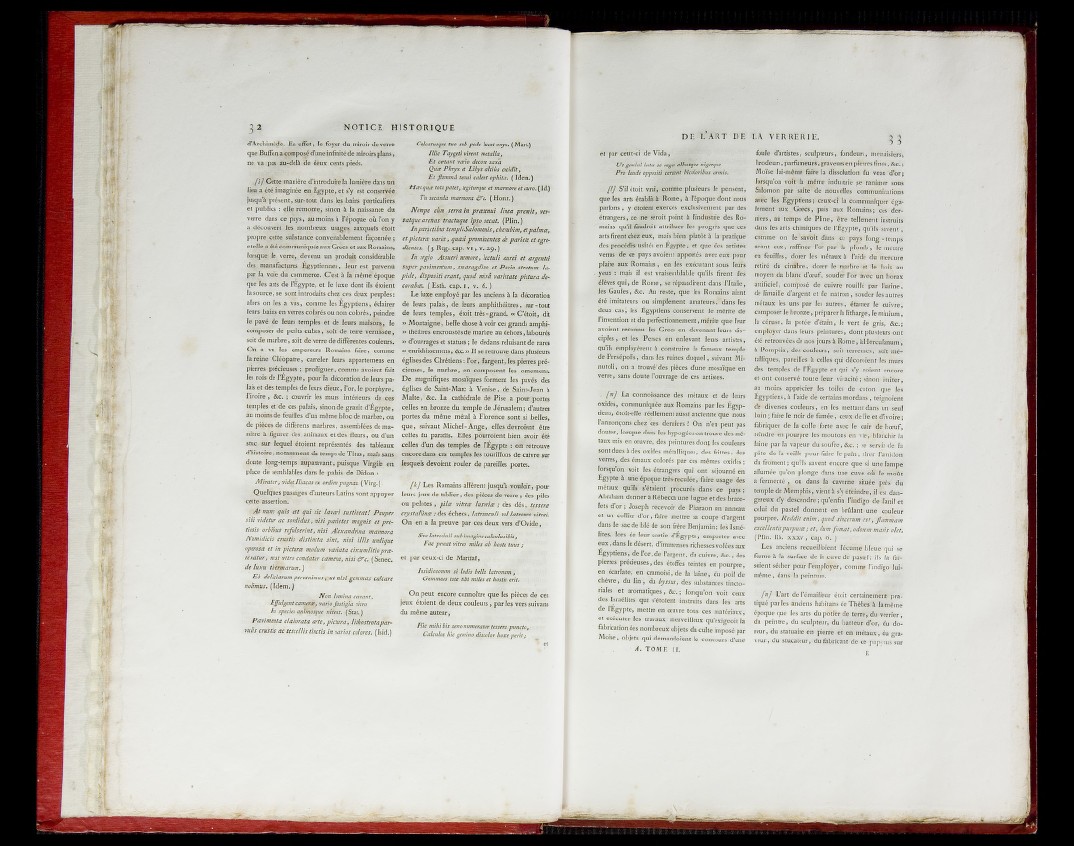
d’Archimède. En e ffe t, le foyer du miroir de verre
que Buffon a composé d’une infinité de miroirs plans,
n e va pas au-delà de deux cents pieds.
[ i ] C e tte manière d’introduire la ïumière dans tnl
lieu a été imaginée en E g yp te , et s’y est conservée
jusqu’à présent, sur- tout dans les bains particuliers
et publics : elle remonte, sinon à la naissance du
verre dans ce pays, au moins à l’époque où l’on y
a découvert les nombreux usages auxquels étoit
propre cette substance convenablement façonnée ;
et elle a été communiquée aux Grecs et aux Romains>
lorsque le verre, devenu un produit considérable
des manufactures Eg yptiennes , leur est parvenu
par la voiè du commerce. C ’est à la même époque
que les arts de l ’ Egypte, et le luxe dont ils étoient
la source, se sont introduits chez ces deux peuples:
alors on les a vus, comme les E gyp tiens , éclairer
leurs bains en verres colorés ou non colorés, peindre
le pavé de leurs temples et de leurs maisons, le
composer de petits cub e s , soit de terre vernissée,
soit de marbre, soit de verre de différentes couleurs.
O n a vu les empereurs Romains faire, comme
la reine C léô p a tre , carreler leurs appartemens en
pierres précieuses ; prodiguer, comme avoient fait
les rois de l’E g y p te , pour la décoration de leurs palais
et des temples de leurs d ieux, l ’or, le porphyre,
l’ivoire , &c. ; couvrir les murs intérieurs de ces
temples et de ces palais, sinon de granit d’É g yp te ,
au moins de feuilles d’un même bloc de marbre, ou
de pièces de differens marbres, assemblées de manière
à figurer des animaux et des fleurs, ou d’un
stuc sur lequel étoient représentés des tableaux
d’histoire, notamment du temps de T itu s , mais sans
doute long-temps auparavant, puisque V irg ile en
place de semblables dans le palais de Didon :
JVliratur, videt Iliacas ex ordine pugnas. (Virg. )
Quelques passages d’auteurs Latins vont appuyer
cette assertion.
A t nurtc quis est qui sic lavari sustineatl Pauper
sibi videtur ac sordidus, nisi parietes magnis et pre-
tiosis orbibus refulserint, nisi Alexandrina marmora
Numidicis crustis distincta sint, nisi i l lis undique
operosa et in picluroe rnodum variata circumlitio pra-
texatur, nisi vitro condatur caméra, nisi & c . (Senec.
de luxu thermarum.)
E o deliciarum pervenimus, ut nisi gemmas calcare
nolimus. ( Id em .)
Non lu mina cessant,
Ejfulgent camerce, vario fastigia vitro
In species animosque nitent. (Stat.)
Pavimenta elaborata arte, pictura, lithostrotapar-
vidis crustis ac tcssellis tinctis in varios colores. (Isid.)
Calcatusque tuo sub pede lucet onyx. ( Marti)
Illic Taygeti virent metalla,
E t certant vario decore saxa
Quoe P/rryx.et LibyS altiîis ceci dit,
E t fiammâ renui calent ophitæ. ( Idem. )
Hcecqufe totapatet, tegiturque et marmoreet auro.{ld.)
Tü seconda marmora ( Horat. )
Nempe cum serra in pratenui line a premit, versa
tque arenas tractuque ipso secat. (P lin .)
Inparietibus templi Salomonis, cherubim, et palmce,
et pictura varia, quasi promincntes de pariete et egre-
dientes. (3 R eg . cap. v i , v. 29 . )
In regio Assueri nemore, lectuli aurei et argentei
Super pavimentum, smaragdino et Pario stratum lapide,
dispositi erant, quod mira varietate pictura de-
corabat. ( Esth. cap. 1 , v. 6 . )
L e luxe employé par les anciens à la décoration
de leurs palais, de leurs amphithéâtres, su r -tou t
de leurs temples, étoit très -g rand . « C ’é toit, dit
» Montaigne, belle chose à voir ces grands amphi-
» théâtres encroustés de marbre au dehors, labourés
» d’ouvrages et statues ; le dedans reluisant de rares
» enrichissemens, & c .» II se retrouve dans plusieurs
églises des Chrétiens : l’o r , l ’a rgent, les pierres précieuses,
le marbre, en composent les omemens.
D e magnifiques mosaïques forment les pavés des
églises de Saint-Marc à V en is e , de Saint-Jean à
M a lte , &c. L a cathédrale de Pise a pour portes
celles en bronze du temple de Jérusalem; d’autres
portes du même métal à Florence sont si b e lle s ,
q u e , suivant M ic h e l -A n g e , elles devroient être
celles du paradis. Elles pourroient bien avoir été
celles d’un des temples de l’E gyp te : on retrouve
encore dans ces temples les tourillons de cuivre sur
lesquels devoient fo u le r de pareilles portes.
[ k ] Le s Romains allèrent jusqu’à vouloir, pour
leurs jeux de tablier, des pièces de verre ; des piles
ou pelotes , p ila vitrea lusoria ; des dés, tessera
crystallina; des échecs, latrunculi vellatrones vitrei.
O n en a la preuve par ces deux vers d’O v id e ,
Sive latrocinii sub imagine calculus ibit f
Fac pereat vitreo miles ab hoste tuus ;
et par ceux-ci de Martial,
Insidiosorum si ludis belta latronum,
Gernmeus iste tibi miles et hostis erit.
O n peut encore connoître que les pièces de ces
jeux étoient de deux cou leurs, par les vers suivans
du même auteur,
Hic mihi bis seno numeratur tessera puncto,
Calculus hic gernino discolor hoste périt;
et par ceux-ci de V id a ,
U t gemini inter se reges albutque nigerque
Pro lande oppositi certant bicolotibus armis.
[ IJ S’il étoit vrai, comme plusieurs le pensent,
que les arts établis à Rom e , à l’époque dont nous
parlons , y étoient exercés exclusivement par des
étrangers, ce ne seroit point à l’industrie des Romains
qu’il faudrait attribuer les progrès que ces
arts firent chez eu x , mais bien plutôt à la pratique
des procédés usités en Egypte * et que des artistes
venus de ce pays avoient apportés avec eux pour
plaire aux Romains , en les exécutant sous leurs
yeux : mais il est vraisemblable qu’ils firent des
élèves qui, de Rom e , se répandirent dans l ’Italie,
les G aules , &c. Au reste, que les Romains aient
été imitateurs ou simplement amateurs , dans les
deux cas , les Egyptiens conservent le mérite de
l’invention et du perfectionnement, mérite que leur
avoient reconnu les Grecs en devenant leurs disciples
, et les Perses en enlevant leurs artistes,
qu’ils employèrent à construire le fameux temple
de Persépolis, dans les ruines d uquel, suivant Mi-
nutoli, on a trouvé'des pièces d’une mosaïque en
v erre, sans doute l’ouvrage de ces artistes.
, [m ] La connoissance des métaux et de leurs
oxides, communiquée aux Romains par les É g y p tiens,
étoit-elle réellement aussi ancienne que nous
l’annonçons chez ces derniers î O n n’en peut pas
douter, lorsque dans' les hypogées on trouve des métaux
mis en oeuvre, des peintures dont les couleurs
sont dues à des oxides métalliques, des frittes, des
verres, des émaux colorés par ces mêmes oxides ;
lorsqu’on voit les étrangers qui ont séjourné en
Egypte à une époque très-reculée, faire usage des
métaux qu’ils s’étoient procurés dans ce pays ;
Abraham donner à Rébecca une bague et des bracelets
d o r ; Joseph recevoir de Pharaon un anneau
et un collier d’o r , faire mettre sa coupe d’argent
dans le sac de blé de son frère Benjamin ; les Israélites,
lors de leur sortie d’E g y p te , emporter avec
e u x , dans le désert, d’immenses richesses volées aux
Egyptiens, de l’o r , de l’argent, du cuivre, & c ., des
pierres précieuses, des étoffes teintes en pourpre,
en écarlate, en cramoisi, de la laine, du poil de
chèvre, du l in , du byssus, des substances tinctoriales
e t aromatiques, &c. ; lorsqu'on voit ceux
des Israélites qui s’étoient instruits dans les arts
de l’E g yp te , mettre en oeuvre tous ces matériaux,
et exécuter les travaux merveilleux qu’exigeoit la
fabrication des nombreux objets du culte imposé par
M oïse , objets qui demandoient le concours d’une
A . T O M E H.
foule d’artistes, sculpteurs, fondeurs, menuisiers)
brodeurs, parfumeurs, graveurs en pierres fines, & c. ;
Moïse lui-même faire la dissolution du veau d’or;
lorsqu’on voit la même industrie se ranimer sous
Salomon par suite de nouvelles communications
avec les Égyptiens ; ceux-ci la communiquer également
aux G r e c s , puis aux Romains; ces derniers,
au temps de P lin e , être tellement instruits
dans les arts chimiques de l’É g yp te , qu’ils savent I
comme on le savoit dans ce pays long - temps
avant eu x , raffiner l ’or par le p lom b , le mettre
en feuilles, dorer les métaux à l’aide du mercure
retiré du cinabre, dorer le marbre et le bois au
moyen du blanc d’oe u f, souder l ’or avec un borax
artificiel, composé de cuivre rouillé par l’urine,
de limaille d’argent et de natro n , souder les autres
métaux les uns par les autres, étamer le cuivre,
composer le b ronze, préparer la litharge, le minium,
la céruse, la potée d e tain, le vert de g r is , &c.;
employer dans leurs peintures, dont plusieurs ont
été retrouvées de nos jours à R om e , à Herculanum,
à Pompéia, des couleurs, soit terreuses, soit métalliques,
pareilles à celles qui décoroient les murs
des temples de I’É gyp te e t qui s’y voient encore
et ont conservé toute leur vivacité; sinon imiter,
au moins apprécier les toiles de coton que les
E g yp tien s , à l’aide de certains mordans , teignoient
de diverses couleurs, en les mettant dans un seul
bain ; faire le noir de fum é e , ceux de lie et d’ivoire ;
fabriquer de la colle forte avec le cuir de boeuf,
teindre en pourpre les moutons en vie, blanchir la
laine par la vapeur du soufre, &c. ; se servir de la
pâte de la veille pour faire le p a in , tirer l’amidon
du froment ; qu’ils savent encore que si une lampe
allumée qu’on plonge dans une cuve où le moût
a fermenté , ou dans la caverne située près du
temple de Memphis, vient à s’y éteindre, il est dangereux
d’y descendre ; qu’enfin l’indigo de l’anil et
celui du pastel donnent en brûlant une couleur
pourpre. Redd it enim, quod sincerum e st, jlammam
excellentis purpura ; et, dum fumât, odorem maris oie t.
(P lin . lib. x x x v , cap. 6. )
Les anciens recueilloient l’écume bleue qui se
forme à la surface de la cu v e de pastel ; ils la fài-
soient sécher pour l’employer, comme l’indigo lui-
même , dans la peinture.
[ n ] L ’art de l’émailleur étoit certainement pratiqué
par les anciens habitans de Thèbes à la même
époque que les arts du potier de terre, du v e r r ie r ,
du peintre, du sculpteur, du batteur d’or, du doreur
, du statuaire en pierre et en métau x, du grav
eur, du stucateur, du fabricant de ce papyrus sur
E
A