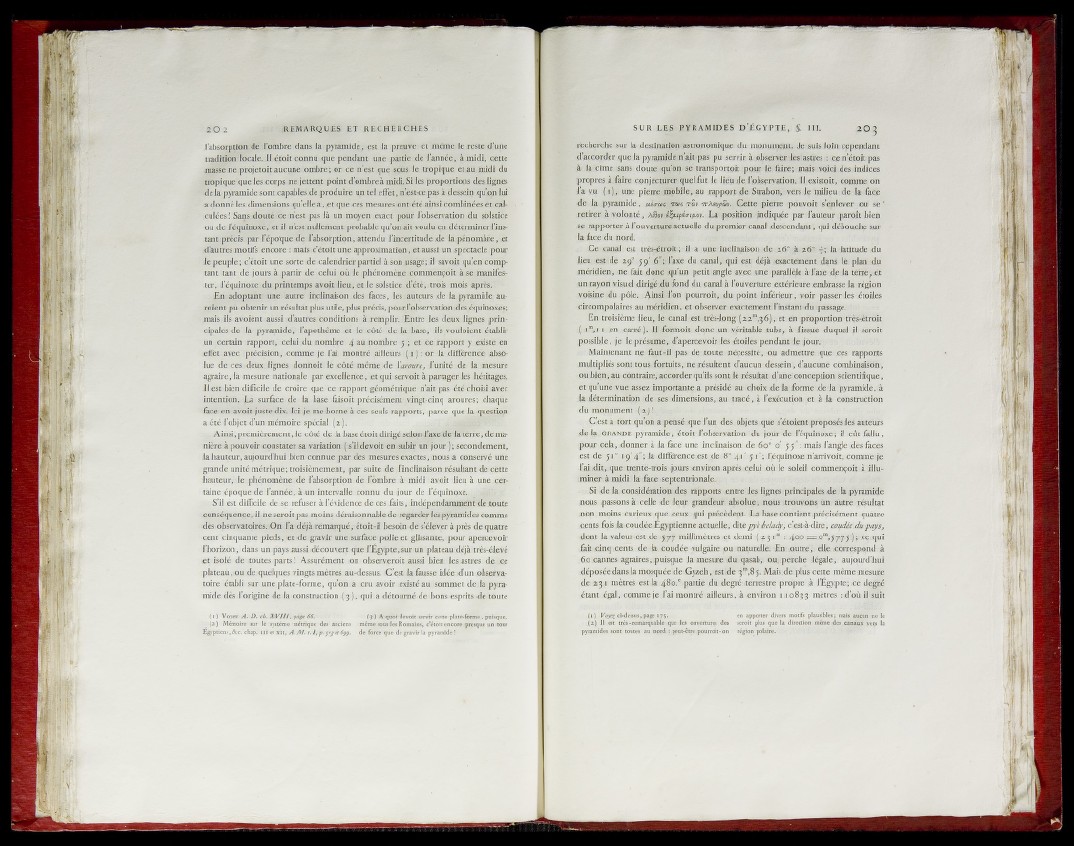
l’absorption de l’ombre dans la pyramide, est la preuve et même le reste d’une
tradition locale. II étoit connu que pendant une partie de l’année, à midi, cette
masse ne projetoit aucune ombre; or ce n’est que sous le tropique et au midi du
tropique que les corps ne jettent point d’ombre à midi. Si les proportions des lignes
de la pyramide sont capables de produire un tel effet, n’est-ce pas à dessein qu’on lui
a donné les dimensions qu’elle a , et que ces mesures ont été ainsi combinées et calculées!
Sans doute ce n’est pas là un moyen exact pour l’observation du solstice
ou de J’équînoxe, et il n’est nullement probable qu’on ait voulu en déterminer l’instant
précis par l’époque de l’absorption, attendu l’incertitude «le la pénombre, et
d’autres motifs encore : mais c’étoit une approximation, et aussi un spectacle pour
le peuple; c’étoit une sorte de calendrier partiel à son usage; il savoit qu’en comptant
tant de jours à partir de celui où le phénomène commençoit à se manifesr
ter, l’équinoxe du printemps avoit lieu, et le solstice d’été, trois mois après.
En adoptant une autre inclinaison des faces, les auteurs de la pyramide au-
roient pu obtenir un résultat plus utile, plus précis, pour l’observation des équinoxes;
mais ils avoient aussi d’autres conditions à remplir. Entre les deux lignes prin -
cipales de la pyramide, l’apothême et le côté de la base, ils vouloient établir
un certain rapport, celui du nombre 4 au nombre y ; et ce rapport y existe en
effet avec précision, comme je l’ai montré ailleurs ( 1 ) : or la différence absolue
de ces deux lignes donnoit le côté même de l‘aroure, l’unité de la mesure
agraire, la mesure nationale par excellence, et qui servoit à partager les héritages.
Il est bien difficile de croire que ce rapport géométrique n’ait pas été choisi avec
intention. La surface de la base faisoit précisément vingt-cinq aroures; chaque
face en avoit juste dix. Ici je me borne à ces seuls rapports, parce que la question
a été l’objet d’un mémoire spécial ( 2 ).
Ainsi, premièrement, le côté de la base étoit dirigé selon l’axe de la terre, de manière
à pouvoir constater sa variation ( s’il devoit en subir un jour ); secondement,
la hauteur, aujourd’hui bien connue par des mesures exactes, nous a conservé une
grande unité métrique; troisièmement, par suite de l’inclinaison résultant de cette
hauteur, le phénomène de l’absorption de l’ômbre à midi avoit lieu à une certaine
époque de l’année, à un intervalle connu du jour de l’équinoxe. |
S’il est difficile de se refuser à l’évidence de ces faits, indépendamment de toute
conséquence, il ne seroit pas moins déraisonnable de regarder les pyramides comme
des observatoires. ¡On l’a déjà remarqué, étoit-il besoin de s’élever à près de quatre
cent cinquante pieds, et de gravir une surface polie et glissante, pour apercevoir
l’horizon, dans un pays aussi découvert que l’Egypte, sur un plateau déjà très-éJevé
et isolé de toutes parts! Assurément on observerait aussi bien les astres de ce
plateau, ou de quelques vingts mètres au-dessus. C ’est la fausse idée ¡d’un observatoire
établi sur une plate-forme, qu’on a cru avoir existé au sommet de la pyramide
dès l’origine de la construction ( 3 ), qui a détourné de bons esprits de toute
( 1) Voyez A- D . ch. X 'V I IJ , page 66. (3 ) iA quoi de voit servir cette plate-forme, puisque,
(2 ) Mémoire sur le système métrique des anciens même sous-Ies Romains, c^étoit encore presque un tour
Egyptiens, & c. chap. m et x i i , A . M . t . 1, p .y i j et 6pp. de force que de gravir la pyramide !
recherche sur la destination astronomique du monument. Je suis loin cependant
d’accorder que la pyramide n’ait pas pu servir à .observer les astres : ce n’étoit pas
à la cime sans doute qu’on se transportait pour lé faire; mais voici des indices
propres à faire conjecturer quel fut le lieu de l’observation. II existoit, comme on
l’a vu ( 1 ), une pierre mobile, au rapport de Strabon, vers Je milieu de la face
de la pyramide > /Au-,«s 7ra« rSv 7rÀ6u/#i'. Cette pierre pouvoit s’enleyer ou se I
retirer à volonté, Afôov fâufÜ & bi La position indiquée par l’auteur paraît bien
se rapporter à l’ouverture actuelle du premier canal descendant, qui débouche sur
la face du nord.
Ce canal est très-étroit; il a une inclinaison de 26° à 26° -j; la latitude du
lieu est de 290 ycf 6“; l’axe du canal, qui est déjà exactement dans le plan du
méridien, ne fait donc qu’un petit angle avec une parallèle à l’axe dp la terre, et
un rayon visuel dirigé du fond du canal à l’ouverture extérieure embrasse la région
voisine du pôle. Ainsi l’on pourrait, du point inférieur, yoir passer les étoiles
circompolaires au méridien, et observer exactement l’instant du passage.
En troisième lieu, le canal est très-long (22“ ,36), et en proportion trèsrétroit
j(; im,i 1 en carré). Il formoit donc un véritable tube, à l’issue duquel il seroit
possible, je le présume, d’apercevoir les étoiles pendant le jour.
Maintenant ne faut-il pas de toute nécessité, ou admettre que .ces rapports
multipliés sont tous fortuits, ne résultent d’aucun dessein, d’aucune combinaison,
ou bien, au contraire, accorder qu’ils sont le résultat d’une conception scientifique,
et qu’une vue assez importante a présidé au choix de la forme de la pyramide, à
la détermination de ses dimensions, au tracé, à l’exécution et à la construction
du monument (2)!
C’est à tort qu’on a pensé que l’un des objets que seraient proposés les auteurs
de la g r a n d e pyramide, étoit l’observation du jour de l’équinoxe; il eût fallu,
pour cela, donner à la face une inclinaison de 60° o’ y y” : mais l’angle des faces
est de y 1° 19’ 4"; la différence est de 8° 4 1’ y fcf® ¡’équinoxe n’arrivoit, comme je
l’ai ¡dit, que trente-trois jours environ après c.elui .où le soleil commençoit à illuminer
à midi la face septentrionale.
Si de la considération des rapports entre les lignes principales de la pyramide
nous passons à celle de leur grandeur absolue, nous trouvons un autre résultat
non moins Curieux que ¡ceux qui précèdent. La base contient précisément quatre
cents fois la coudée Egyptienne actuelle, dite pykielady, c'est-à-dire, coudée du pays,
dont la valeur est de y77 millimètres et demi ( 23 im : 4003s=-Qm,y 7 7 y ); .ce qui
fait cinq cents de la coudée vulgaire ou naturelle. En outre, elle ¡correspond à
60 cannes agraires, puisque la mesure du qasab, ou. perche légale, aujourd’hui
déposée dans la mosquée de Gyzeh, est .de 3m,8y. Mais de plus cette même mesure
de 231 mètres est la 480.' partie du degré terrestre propre à l’Egypte; ce degré
étant égal, comme je l’ai montré ailleurs, à environ 110833 mètres : .d’où il suit
(1 ) Voye^ ci-dessus, page 175. en apporter divers motifs plausibles; mais aucun ne le
(2 ) Il est très- remarquable que ¡les ouvertures des seroit plus que la direction même des ,canaux vers la
pyramides sont toutes au nord : peut-être pourrdit-on région polaire.