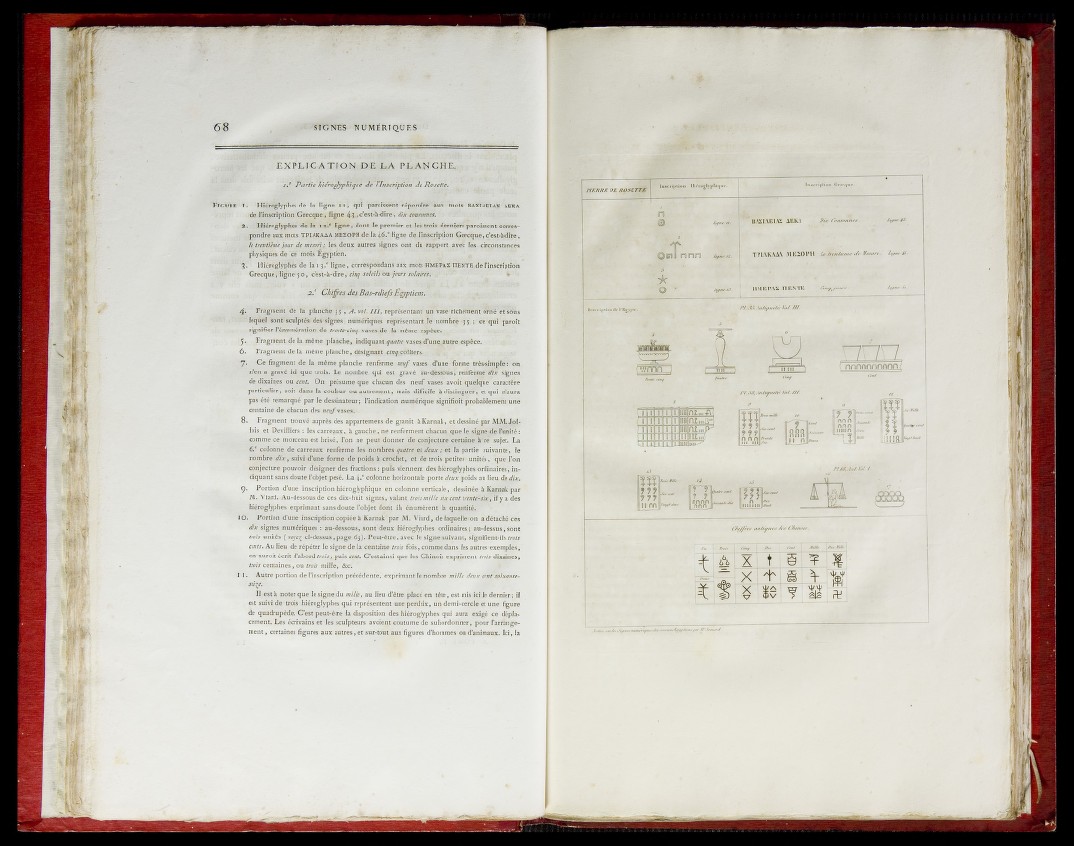
■ 'W
! | !
i l Kl
Æi
l
’ i l '
1
1
I J 3L
S || • »
i l
ï l i
Ifmtf
«
M l ! '
Îte& üS
-
é f e
I p ÿ ' .
m i
6 8 S I G N E S N U M É R I Q U E S
E X P L I C A T I O N D E L A P L A N C H E .
i.° Partie hiéroglyphique de Îinscription de Rosette.
F ig u r e I . Hiéroglyphes de la ligne i i , qui paroissent répondre aux mots b a s ia e ia s a e k a
de l’inscription G r e c q u e , lig n e 4-3 » c’es t-à-d ire, dix couronnes.
2. Hiéroglyphes de la i 2.c lig n e , dont le premier et les trois derniers paroissent correspondre
aux mots TPIAKAAA m e s o p h de la 46*e Hgne de l’inscription G re cq u e , c’est-à-dire,
le trentième jour de mesori ; les d eu x autres s ignes ont du rapport avec les circonstances
physiques de ce mois Egyptien.
3. Hiéroglyphes de la 13/ lig n e , correspondans aux mots hm ep aS ITENTE de Finscription
G r e cq u e , ligne 50 , c ’est-à-d ire , cinq soleils ou jours solaires.
2..0 Chiffres des Bas-reliefs Egyptiens.
4 - Fragment de la planche 35 , A. vol. III, représentant un vasé richëînent orné et sous
leque l sont sculptés des signes numériques représentant le nombre 35 ; ce qui paroît
signifier rémunération de trente-cinq vases de la même espèce.
5. Fra gm en t de la même p lan ch e , indiquant quatre vases d’une autre espèce.
6 . Fragment de la même p lan ch e , désignant cinq colliers.
y. C e fragment de la même planche renferme neuf vases d’u n e - fo rm e très-simple: on
n ’en a g ra vé ici q u e trois. L e nombre q ui est g ra v é au-dêssous, renferme dix s ignes
de dixaines ou cent. O n présume que chacun des n e u f vases avoit q uelq ue caractère
p ar ticu lie r , soit dans la couleur ou autrement, mais difficile à d is tin gu e r , et qui n’aura
pas été remarqué par le dessinateur ; l’indication numérique signifioit probablement une
centaine de chacun des neuf vases.
8 . Fragment trouvé auprès des appartemens de g ranit à K a rn a k , et dessiné par M M . Jollois
et De villiers : les carreaux , à g a u c h e , ne renferment chacun q u e le s ign e de l’unité ;
comme ce morceau est b r is é , l’on ne p eu t d onne r de conje cture certaine à ce sujet. La
6.c colonne de carreaux renferme les nombres quatre et deux ; e t la partie su iv an te , le
nombre dix, suivi d’une forme de poids à c rochet, et de trois petites u n ité s , que l ’on
conje ctu re p ou voir d és igner des frac tion s: puis v iennent des hiéroglyphes ord inaire s, indiquant
sans doute l ’objet pesé. L a 4*e colonne horizontale porte deux poids au lieu de dix.
9 - P or tion d’une inscription hiéroglyphique en colonne ve rticale , dessinée à Karnak par
M . Y ia rd . Au-dessous de ces dix-huit s ign e s , valant trois mille six cent trente-six, il y a des
hiéroglyphes exprimant sans doute l’ob je t dont ils énumèrent la quantité.
10 . Portion d’une inscription copiée à Karnak par M . V ia rd , de laquelle on a détaché ces
dix signes numériques : au -d es sou s, sont deux hiéroglyphes ord inaires; au -dessus, sont
trois unités ( voye^ c i-d e ssu s , p a g e 63). P eu t-ê tre , avec le s ign e suiv an t, signifient-ils trois
cents. A u lieu de répéter le s ign e de la centaine trois fo is , comme dans les autres exemples,
on auroit écrit d’abord trois, p uis cent. C ’est ainsi q u e les Chinois expriment trois dixaines,
trois cen ta in e s , ou trois m ille , &c.
I 1 . A utre portion de l’inscription p ré c éd e n te , exprimant le nombre mille deux cent soixantesei^
e.
I l est à noter que le s ign e du mille, au lieu d’être placé en tê te , est mis ici le dernier; il
est suivi de trois h iéroglyphes q u i représentent une p erd rix, un demi-cercle et une figure
de quadrupède. C ’est peut-être la disposition des hiéroglyphes q ui aura ex ig é ce déplacement.
Les écrivains e t les sculpteurs avoient coutume de subo rd on n e r , p ou r l’arrangement
, certaines figure s au x au tre s, et sur-tout aux figures d’hommes ou d’animaux. I c i, la
1
luli
M !
i f
i l f i
n i il m
M
»
I
i
¡ f i l H18
S l
iül
il:1
1| | i l
AI
I
II
lÉ Î