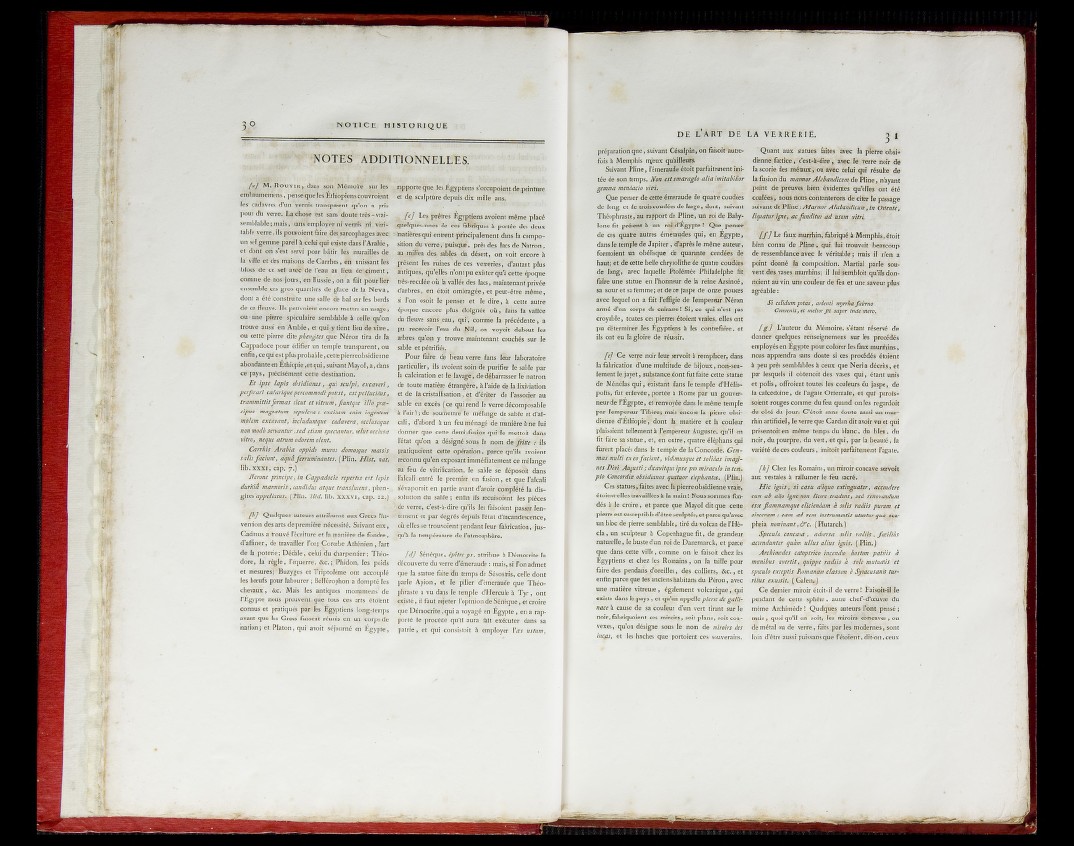
NOTES ADDITIONNELLES.
[ a ] M . R o u y E R j dans son Mémoire sur les
emha'umemens, pense que les Éthiopiens couvroient
les cadavres d’un vernis transparent qu’on a pris
pour dti verre. L a chose est sans doute très -v raisemblable;
mais, sans employer ni vernis ni véritable
verre, ils pouvoient faire des sarcophages avec •
un sel gemme pareil à celui qui existe dans l’A ra b ie ,
et doht on s’est servi pour bâtir les murailles de
la ville et des maisons de Carrhes, en unissant les
blocs de ce sel avec de l’eau au lieu de?ciment,
comme de nos jours, en Russie; on a fait pour lier
ensemble ces gros quartiers de glace de la N e w a ,
dont a étéiconstruite une salle de bal sur les bords
de ce fleuve. Ils pouvoient encore mettre en usage,
ou • une pierre spéculaire semblable à celle qu’on
trouve aussi en A rab ie , et qui y tient lieu de v itre,
ou cette pierre dite phengites que Néron tira de la
Cappadoce pour édifier un temple transparent, ou
enfin, ce qui est plus probable, cette pierre obsidienne
abondante en Ethiopie ,et q u i, suivant May o l , a , dans
ce p ays , précisément cette destination.
E t ipse lapis obsidianus, qui sculpi, excavari,
perforari coelarique percommode potest, est pellucidus,
transmittit formas sicut et vitrum, fiunique illo prte-
cipua magnatum sepulcra excisam enim ingentem
molam excavant, includuntque cadavera, occlusaque
non modo servantur, sed etiam spectantur, velüt occlus a
vitro, neque atrum odorem oient.
Carrhis Ârabioe oppido muros domosque massis
sa lis faciunt, àquâ ferruminantes. (P iin. H is t . nat.
Iib. XXXI, cap. 7 .)
Nerone principe -, in Cappadocia repertus est lapis
duritiâ marmoris, candidus atque translucens, phen-
gites appcllatus. ( Plin. ibid. Iib. x x x v i , cap. 22.)
[ b ] Quelques auteurs attribuent aux Grecs l’invention
des arts de première nécessité. Suivant eux ,
Cadmus a trouvé l’écriture et la manière de fon d re ,
d’a ffiner, de travailler l’o r ; Coroebe Athénien , l’art
de la poterie; D éd ale, celui du charpentier; Th éod
ore , la r è g le , leque rre, & c . ; Phidon, les poids
et mesures; Buzyges et Triptolème ont accouplé
les boeufs pour labourer ; Bellérophon a dompté les
chevaux , &c. Mais les antiques inonumens de
l’Eg ypte nous prouvent que tous ces arts étoient
connus et pratiqués par les Egyptiens long-temps
avant que les Grecs fussent réunis en un corps de
nation ; et P la ton , qui avoit séjourné en E g y p te ,
rapporte que les Égyptiens s’otcupoient de peinture
e t de sculptùre depuis dix mille ans.
.. I e] Les prêtres Egyptiens avoient même placé
quelques-unes de ces fabriques à portée des deux
'matières qui entrent principalement dans la composition
du verre, puisque, près des lacs de Natron,
au milieu des sables du désert, on voit encore h
présent les ruines de ces verreries, d’autant plus
antiques, qu’elles n’ont pu exister qu’à cette époque
très-reculée ou la vallée des lacs, maintenant privée
d’arbres, en étoit ombragée, e t peut-être même,
si l ’on osoit le penser et le d ire , à cette autre
époque encore plus éloignée o ù , dans la vallée
du fleuve sans eau, q u i, comme la précédente, a
p u recevoir l’eau du N i l, on voyoit debout les
arbres qu’on y trouve maintenant couchés sur le
sable et pétrifiés.
Pou r faire de beau verre dans leur laboratoire
particulier, ils avoient soin de purifier le sable par
la calcination et le la vage, de débarrasser le natron
de toute matière étrangère, à l ’aide de la lixiviation
et de la cristallisation, èt d’éviter de l’associer au
sable en excès ( ce qui rend le verre décomposable
h l’air );*de soumettre le mélange de sable et d’al-
c a li, d’abord à un feu ménagé de manière à ne lui
donner que cette demi-fusion qui le mettoit dans
l’état qu’on a désigné sous le nom de fritte : ils
pratiquoient cette opération, parce qu’ils avoient
reconnu qu’en exposant immédiatement ce mélange
au feu de vitrification, le sable se déposôit dans
l ’alcali entré le premier en fus ion, et que l ’alcali
s’évaporait en partie avant d’avoir complété la dis-
■ solution du sable ; enfin ils recuisoient les pièces
de v erre, c ’est-à-dire qu’ils les fiiisoient passer lentement
et par degrés depuis l ’état d’incandescence,
où elles se trouvoient pendant leur fabrication, jusqu’à
la température de l’atmosphère.
[ d ] Sénèque, épître p i , attribue à Démocrite la
découverte du verre d’émeraude : mais, si l’on admet
que la statue faite du temps de Sésostris, celle dont
parle A p io n , e t le pilier d’émeraude que Théo-
phraste a vu dans le temple d’HercuIe à T y r , ont
ex is té , il faut rejeter l’opinion de Sénèque, et croire
que Démocrite, qui a voyag é en E g yp te , en a rapporté
le procédé qu’il aura fait exécuter dans sa
p a tr ie , et qui consistoit à employer I '¿es us turn,
préparation q u e , suivant C é sa lp in , on fàisoit autrefois
à Memphis nyeux qu’ailleurs.
Suivant PJine, l’émeraude étoit parfaitement imitée
de son temps. Non est smaragdo alia imitabilior
gemma mendacio vitri.
Q u e penser de cette émeraude de quatre coudées
de long et de trois coudées de la rg e , dont, suivant
Théophraste, au rapport de P l in e , un roi de Baby-
Ione fit présent à un roi d’E g ypte ! Q ue penser
de ces quatre autres émeraudes qui, en E g yp te ,
dans le temple d e J u p ite r , d’après le même auteur,
formoient un obélisque de quarante coudées de
haut ; et de cette belle chrysolithe de quatre coudées
de lo n g , avec laquelle Ptolémée Philadelphe fit
faire une statue en l’honneur de la reine A rsinoé,
sa soeur et sa femme ; et de ce jaspe de onze pouces
avec lequel on a fait l’effigie de l’empereur Néron
armé d’un corps de cuirasse! S i, ce qui n’est pas
croyable, toutes ces pierres étoient vraies, elles ont
pu déterminer les Egyptiens à les contrefaire, et
ils ont eu la gloire de réussir.
[ e] C e verre noir leur servoit à remplacer, dans
la fabrication d’une multitude de b ijou x, non-seulement
le ja y e t, substance dont fut faite cette statue
de Ménélas q u i, existant dans le temple d’Hélio-
p olis, fut enlevée, portée à Rome par un gouverneur
de l’E g yp te , et renvoyée dans le même temple
par l’empereur Tib ère; mais encore la pierre obsidienne
d’Éthiopie, dont la matière et la couleur
plaisoient tellement à l ’empereur A ugu s te, qu’il en
fit faire sa statue, e t , en outre, quatre éléphans qui
furent placés dans le temple de la Concorde. Gemmas
multi ex eo faciunt, vidimusque et solidas imagines
D iv i Augusti ; dicavitque ipse pro miraculo in tem-
plo Concordioe obsidianos quatuor elephantos. (Plin.)
C e s statues,faites avec la pierre obsidienne vraie,
étoient-elles travaillées à la main! Nous sommes fondés
à le croire, et parce que Mayol dit que cette
pierre est susceptible d’être sculptée, et parce qu’avec
un bloc de pierre semblable, tiré du volcan de l’H é-
c la , un sculpteur à Copenhague fit , de grandeur
naturelle, le buste d’un roi de Danemarck, et parce
que dans cette v ille , comme on le fàisoit chez les
Égyptiens et chez les Romains, on la taille pour
faire des pendans d’oreilles, des colliers, & c . , et
enfin parce que les anciens habitans du P é ro u , avec
une matière vitreuse, également volcanique, qui
existe dans le p a y s , et qu’on appelle pierre de galli-
nace à cause de sa couleur d’un vert tirant sur le
noir, fabriquoient ces miroirs, soit pians, soit con vexes,
qu’on désigne sous le nom de miroirs des
inçps, et les haches que portoient ces souverains.
Quant aux statues faites àvec la pierre obsi*
dienne fa c tice , c’est-à-d ire, avec le Verre noir de
la scorie des métaux, ou avec celui qui résulte de
la fusion du marmor Alabandicum de P lin e , n’ayant
point de preuves bien évidentes qu’elles ont été
coulées, nous nous contenterons de citer le passage
suivant de P line : Marmor Alabandicum ,in Orienté,
liquatur igne, ac Jùnditur ad usum vitri.
[ f ] L e faux murrhin, fabriqué à Memphis, étoit
bien connu de P l in e , qui lui trouvoit beaucoup
de ressemblance avec le véritable ; mais il n’en a
point donné la composition. Martial parle souvent
des vases inurrhins ; il lui sembïoit qu’ils don-
noient au vin une couleur de feu et une saveur plus
agréable :
Si calidum potas, ardenti myrrha falerno
Convenit, et melior fit sapor irtde tnero.
[ g ] L ’auteur du Mémoire, s’étant réservé de
donner quelques renseignemens sur les procédés
employés en Égypte pour colorer les faux inurrhins,
nous apprendra sans doute si ces procédés étoient
à peu près semblables à ceux que Neri a décrits, et
par lesquels il obtenoit des vases q u i , étant unis
et p olis, offraient toutes les couleurs du jaspe, de
la calcédoine, de l’agate Orientale, et qui parois-
soient rouges comme du feu quand on les regardoit
du côté du jour. C ’étoit sans doute aussi un murrhin
artificiel, le verre que Cardan dit avoir vu et qui
présentoit en même temps du b lanc , du b le u , du
noir, du pourpre, du v e r t, et q u i, par la beauté, la
variété de ces couleurs, imitoit parfaitement l’agate.
[ h ] C he z les Romains, un miroir concave servoit
aux vestales à rallumer le feu sacré.
H ic ignis, s i casu aliquo extinguatur, accendere
eum ab alio igne non licere tradunt, sed renovandum
esse flammamqut eliciendam à solis radiis puram et
sinceram : eam a d rem instruments utuntur quee sca-
pheia nominant ,& c . (Plutarch.)
Spécula concava , adversa solis radiis, faciliùs
accenduntur quam ullus alius ignis. ( Plin. )
Archimedes catoptrico incendio hostem patriis h
moenibus avertit, quippe radiis a sole mutuatis et
speculo exceptis Romanam classem e Syracusanis tur-
ribus exussit. ( Galen. )
C e dernier miroir étoit-il de verre! Fàisoit—il le
pendant de cette sphère, autre ch e f-d ’oeuvre du
même Archimède ! Quelques auteurs l ’ont pensé ;
m ais , quoi qu’il en so it, les miroirs concaves , ou
de métal ou de ve r re , faits par les modernes, sont
loin d’être aussi puissans que l’é toient, dit-on, ceux