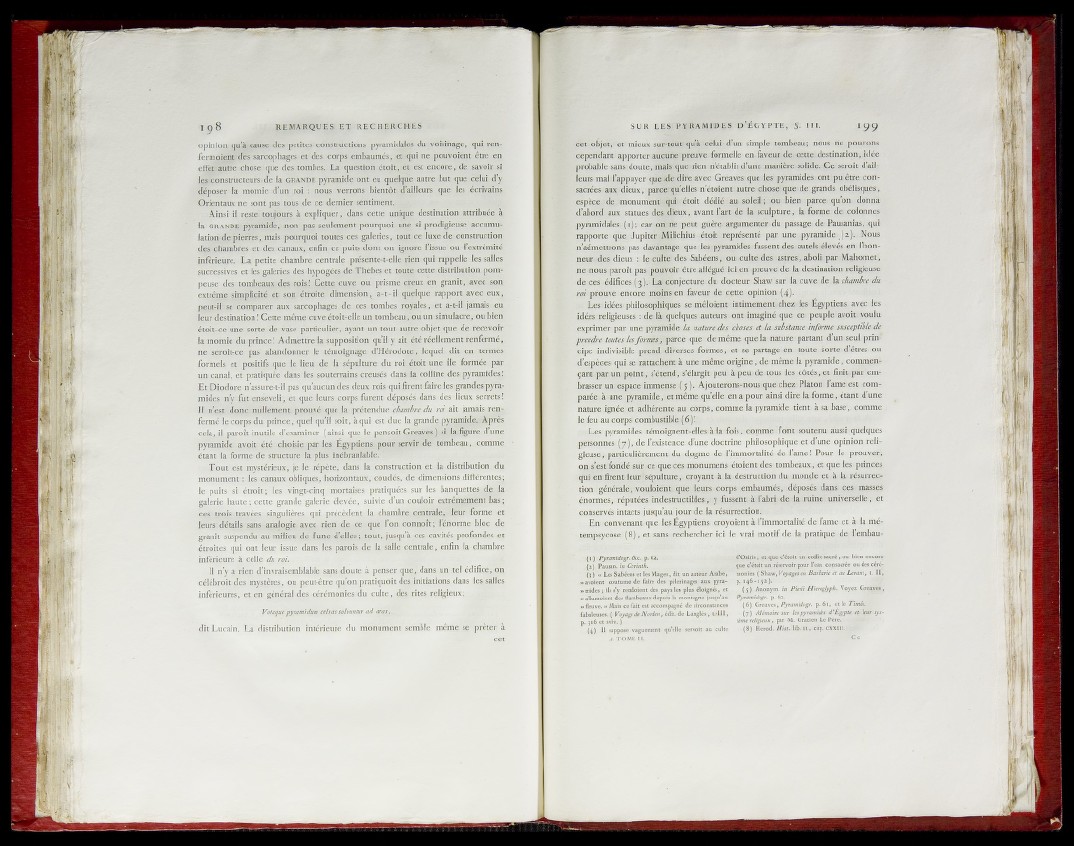
opinion cju’à cause des petites constructions pyramidales du voisinage, qui ren-
fermoient des sarcophages et des corps embaumés, et qui ne pouvoient être en
effet autre chose que des tombes. La question étoit, et est encore, de savoir si
les constructeurs.-de la g r a n d e pyramide ont eu quelque autre but que celui d’y
déposer la momie d’un roi : nous verrons bientôt d’ailleurs que les écrivains
Orientaux ne sont pas tous de ce dernier sentiment.
Ainsi il reste toujours à expliquer, dans cette unique destination attribuée a
la g r a n d e pyramide, non pas seulement pourquoi une si prodigieuse accumulation
de pierres, mais pourquoi toutes ces galeries, tout ce luxe de construction
des chambres et des canaux, enfin ce puits dont on ignore l’issue ou l’extrémité
inférieure. La petite chambre centrale présente-t-elle rien qui rappelle les salles
successives et les galeries des hypogées de Thèbes et toute cette distribution pompeuse
des tombeaux des rois' Cette cuve ou prisme creux en granit, avec son
extrême simplicité et son étroite dimension, a-t-il quelque rapport avec eux,
peut-il se comparer aux sarcophages de ces tombes royales, et a-t-il jamais eu
leur destination ! Cette même cuve étoit-elle un tombeau, ou un simulacre, ou bien
étoit-ce une sorte de vase particulier, ayant un tout autre objet que de recevoir
la momie du prince! Admettre la supposition qu’il y ait été réellement renfermé,
ne seroit-ce pas abandonner le témoignage d’Hérodote, lequel dit en termes
formels et positifs que le lieu de la sépulture du roi étoit une île formée par
un canal, et pratiquée dans les souterrains creusés dans la colline des pyramides!
Et Diodore n’assure-t-il pas qu’aucun des deux rois qui firent faire les grandes pyramides
n’y fut enseveli, et que leurs corps furent déposés dans des lieux secrets!
Il n’est donc nullement prouvé que la prétendue chambre du roi ait jamais renfermé
le corps du prince, quel qu’il soit, à qui est due la grande pyramide. Après
cela, il paroît inutile d’examiner (ainsi que le pensoit Greaves) si la figure dune
pyramide avoit été choisie par les Égyptiens pour servir de tombeau, comme
étant la forme de structure la plus inébranlable.
Tout est mystérieux, je le répète, dans la construction et la distribution du
monument : les canaux obliques, horizontaux, coudés, de dimensions différentes;
le puits si étroit; les vingt-cinq mortaises pratiquées sur les banquettes de la
galerie haute; cette grande galerie élevée, suivie d un couloir extrêmement bas;
ces trois travées singulières qui précèdent la chambre centrale, leur forme et
leurs détails sans analogie avec rien de ce que l’on connoît; l’énorme bloc de
granit suspendu au milieu de l’une d’elles ; tout, jusqu’à ces cavités profondes et
étroites qui ont leur issue dans les parois de la salle centrale, enfin la chambre
inférieure à celle du roi.
II n’y a rien d’invraisemblable sans doute à penser que, dans un tel édifice, on
célébroit des mystères, ou peut-être qu’on pratiquoit des initiations dans les salles
inférieures, et en général des cérémonies du culte, des rites religieux;
Votaque pyramidum celsas solvuntur ad aras,
dit Lucain. La distribution intérieure du monument semble même se prêter a
SUR LES P Y RA MIDE S d ’ÉG Y P T E , §. III. 1 9 9
cet objet, et mieux sur-tout qu’à celui d’un simple tombeau; nous ne pouvons
cependant apporter aucune preuve formelle en faveur de cette destination, idée
probable sans doute, mais que rien n’établit d’une manière solide. Ce seroit d’ailleurs
mal l’appuyer que .de dire avec Greaves que les pyramides ont pu être consacrées
aux dieux, parce qu’elles n’étoient autre chose que de grands obélisques,
espèce de monument qui étoit dédié air soleil ; ou bien parce quon donna
d’abord aux statues des dieux, avant l’art de la sculpture, la forme de colonnes
pyramidales (1); car on ne peut guère argumenter du passage de Pausanias, qui
rapporte que Jupiter Milichius étoit représenté par une pyramide (2). Nous
n’admettrons pas davantage que les pyramides fussent des autels élevés en l’honneur
des dieux : le culte des Sabéens, ou culte des astres, aboli par Mahomet,
ne nous paroît pas pouvoir être allégué ici en preuve de la destination religieuse
de ces édifices (3)., La conjecture du docteur Shaw sur la cuve de la chambre du
roi prouve encore moins en faveur de cette opinion (4).
Les idées philosophiques se mêloient intimement chez les Égyptiens avec les
idées religieuses : de là quelques auteurs ont imaginé que ce peuple avoit voulu
exprimer par une pyramide la -nature des choses et la substance informe susceptible de
prendre toutes les formes, parce que de même que la nature partant dun seul principe
indivisible prend diverses formes, et se partage en toute sorte d’êtres ou
d’espèees qui se rattachent à une même origine, de meme la pyramide, commençant
par un point, s’étend, s’élargit peu à peu de tous les côtés, et finit par embrasser
un espace immense (y). Ajouterons-nous que chez Platon lame est comparée
à une pyramide, et même quelle en a pour ainsi dire la forme, étant dune
nature ignée et adhérente au corps, comme la pyramide tient à sa base, comme
le feu au corps combustible (6) !
Les pyramides témoignent-elles à la fois, comme l’ont soutenu aussi quelques
personnes (7), de l’existence d’une doctrine philosophique et d une opinion religieuse,
particulièrement du dogme de l’immortalité de l’ame! Pour le prouver,
on s’est fondé sur ce que ces monumens étoient des tombeaux, et que les princes
qui en firent leur sépulture, croyant à la destruction du monde et à la résurrection
générale, vouloient que leurs corps embaumés, déposés dans, ces masses
énormes, réputées indestructibles, y fussent à l’abri de la ruine universelle, et
conservés intacts jusqu’au jour de la résurrection.
En convenant que les Égyptiens croyoient à l'immortalité de l’ame et à la métempsycose
(8), et sans rechercher ici le vrai motif de la pratique de l’embau-
( i ) Pyramidogr. &c. p. 62.
(2) Pausan. in Corinth.
(3 ) « Les Sabéens et les Mages, dit un auteur Arabe,
» avoient coutume de faire des pèlerinages aux pyra-
» mides ; ils s’y rendoient des pays les plus éloignés, et
» allumoient des flambeaux depuis la montagne jusqu’au
» fleuve. » Mais ce fait est accompagné de circonstances
fabuleuses. ( Voyage de Norden, édit. de Langlès, t.» lll,
p. 316 et suiv. )
(4) 11 suppose vaguement qu’elle servoit au culte
A. TOME M
d’Osiris, et que c’étoit un coffre sacré, ou bien encore
que c’étoit un réservoir pour l’eau consacrée ou des cérémonies
( Shaw, Voyages en Barbarie èt au Levant, t. II,
p. 14 6 -152 ).
(5 ) Anonym, in Pierii Hieroglyph. Voyez Greaves,
Pyramidogr. p. 60.
(6) Greaves, Pyramidogr. p. 61, et le Timée.
(7 ) Mémoire sur les pyramides d’Egypte et, leur système
religieux, par M. Gratien Le Père.
(8) Herod. Hist. lib. 11, cap. c x x in .
Ce