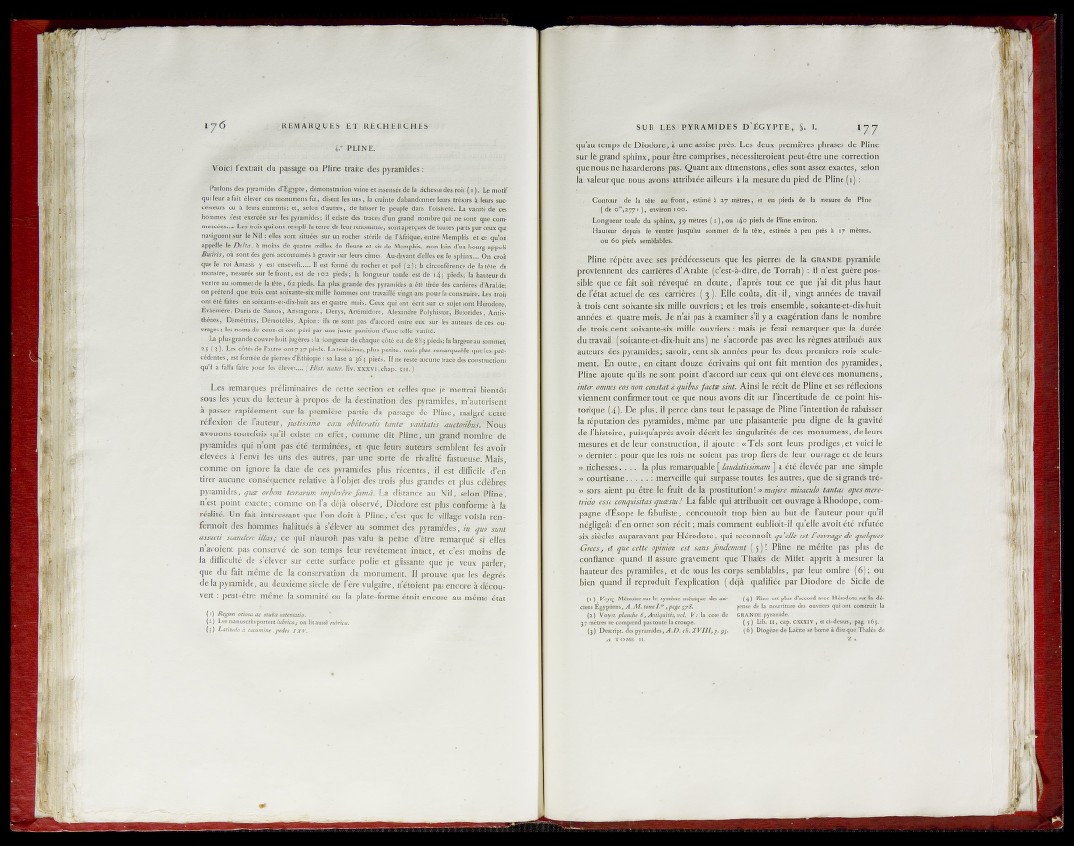
4-“ P L I N E .
Voici l’extrait du passage où Pline traite des pyramides :
Parlons des pyramides d’E g y p te , démonstration vaine et insensée de la richesse des rois ( i ) . Le motif
qui leur a fait élever ces tnonumens fut, disent les u n s , la crainte d’abandonner leurs trésors il leurs successeurs
ou ît leurs ennemis; e t , selon d’autres, de laisser le peuple dans l’oisiveté. La vanité de ces
hommes s’est exercée sur les pyramides; il existe des traces d’un grand nombre qui ne sont que commencées....
Les trois qui ont rempli la terre de leur renommée, sont aperçues de toutes parts par ceux qui
naviguent sur le N il ; elles sont situées sur un rocher stérile de l’Afrique, entre Memphis et ce qu’on
appelle le D e lta , à moins de quatre milles du fleuve et six de Memphis, non loin d’un bourg appelé
Busiris, où sont des gens accoutumés à gravir sur leurs cimes Au-devant d’elles est le sphinx... O n croit
que le roi Amasis y est enseveli Il est formé du rocher et poli ( 2 ) ; la circonférence de la tête du
monstre, mesurée sur le fron t, est de 102 pieds; la longueur totale est de 143 pieds; la hauteur du
ventre au sommet de la tê te , 62 pieds. La plus grande des pyramides a été tirée des carrières d’Arabie;
o n prétend que trois cent soixante-six mille hommes ont travaillé v ing t ans pour la construire. Les trois
ont été faites en soixante-et-dix-huit ans et quatre mois. C eu x qui ont écrit sur ce sujet sont Hérodote,
Evhémére, Duris de Samos, Aristagoras, Denys, Artémidore, Alexandre Polyhistor, Butorides, Antis-
thènes, Démétrius, Démotélè s, A p io n : ils ne sont pas d’accord entre eux sur les auteurs de ces ouvrages
; les noms de ceux-ci ont péri par une juste punition d’une telle vanité.
L a plus grande couvre huit jugères : la longueur de chaque côté est de 883 pieds; lalargeurau sommet,
~5 ( 3}- Le s cotés de 1 autre ont 7 3 7 pieds. La troisième, plus petite , mais plus remarquable que les précédentes
, est formée de pierres d Ethiopie : sa base a 363 pieds. I l ne reste aucune trace des constructions
qu’il a fallu faire pour les élever.... [ H is t. natur. lîv. x x x v t , chap. XI I . )
Les remarques préliminaires de cette section et celles que je mettrai bientôt
sous les yeux du lecteur à propos de la destination des pyramides, m’autorisent
a passer rapidement sur la première partie du passage de Pline, malgré cette
reflexion de 1 auteur, justissimô casu obliteratis tantoe vanitatis auctoribus. Nous
avouons toutefois qu’il existe en effet, comme dit Pline, un grand nombre de
pyramides qui n’ont pas été terminées, et que leurs auteurs semblent les avoir
élevées à l’envi les uns des autres, par une sorte de rivalité fastueuse. Mais,
comme on ignore la date de ces pyramides plus récentes, il est difficile d’en
tirer aucune conséquence relative à l’objet des trois plus grandes et plus célèbres
pyramides, quoe orbem terrarum implevêre famâ. La distance au Nil, selon Pline,
nest point exacte; comme on l’a déjà observé, Diodore est plus conforme à la
réalité. Un fait intéressant que l’on doit à Pline, c’est que le village voisin ren-
fermoit des hommes habitués.à s’élever au sommet des pyramides, in quo sunt
assueti scandere illas; ce qui n’auroit pas valu la peine d’être remarqué si elles
n’avoient pas conservé de son temps leur revêtement intact, et c’est moins de
la difficulté de s’élever sur cette surface polie et glissante que je veux parler,
que du fait même de la conservation du monument. Il prouve que les degrés
de la pyramide, au deuxième siècle de l’ère vulgaire, n’étoient pas encore à découvert
: peut-être même la sommité ou la plate-forme étoit encore au même état
( I ) Regum otiosa ac stulta ostentatîo,
(2 ) Les manuscrit?portentiuhncay on lit aussi rubricu.
( 3 ) Batîtudo à cacumine, pedes XXV.
qu’au temps de Diodore, à une assise près. Les deux premières phrases de Pline
sur le grand sphinx, pour être comprises, nécessiteroient peut-être une correction
que nous ne hasarderons pas. Quant aux dimensions, elles sont assez exactes, selon
la valeur que nous avons attribuée ailleurs à la mesure du pied de Pline (1) :
Contour de la tête au fro n t , estimé il 27 mètres, et en pieds de la mesure de Pline
( de om,2 7 7 1 ) , environ 100.
L on gueu r totale du sphinx, 39 mètres ( 2 ) , ou 14o pieds de Pline environ.
Hauteur depuis le ventre jusqu’au sommet de la tê te , estimée à peu près à 1 7 mètres,
ou 60 pieds semblables.
Pline répète avec ses prédécesseurs que les pierres de la g r a n d e pyramide
proviennent des carrières d’Arabie (c’est-à-dire, de Torrah) ; il n’est guère possible
que ce fait soit révoqué en doute, d’après tout ce que j’ai dit plus haut
de l’état actuel de ces carrières ( 3). Elle coûta, dit-il, vingt années de travail
à trois cent soixante-six mille ouvriers; et les trois ensemble, soixante-et-dix-huit
années et quatre mois. Je n’ai pas à examiner s’il y a exagération dans le nombre
de trois cent soixante-six mille ouvriers : mais je ferai remarquer que la durée
du travail (soixante-et-dix-huit ans) ne s’accorde pas avec les règnes attribués aux
auteurs des pyramides; savoir, cent six années pour les deux premiers rois seulement.
En outre, en citant douze écrivains qui ont fait mention des pyramides,
Pline ajoute qu’ils ne sont point d’accord sur ceux qui ont élevé ces monumens,
inter omnes eos non constat à qu'tbus jactce sint. Ainsi le récit de Pline et ses réflexions
viennent confirmer tout ce que nous avons dit sur l’incertitude de ce point historique
(4 )- De plus, il perce dans tout le passage de Pline l’intention de rabaisser
la réputation des pyramides, même par une plaisanterie peu digne de la gravité
de l’histoire, puisqu’après avoir décrit les singularités de ces monumens, de leurs
mesures et de leur construction, il ajoute : «Tels sont leurs prodiges, et voici le
» dernier : pour que les rois ne soient pas trop fiers de leur ouvrage et de leurs
» richesses. . . . la plus remarquable [ laudatissimam ] a été élevée par une simple
» courtisane : merveille qui surpasse toutes les autres, que de si grands tré-
» sors aient pu être le fruit de la prostitution ! » majore miraculo tantas opes mere-
rricio esse conquisitas quoestu! La fable qui attribuoit cet ouvrage à Rhodope, compagne
d’Ésope le fabuliste, concouroit trop bien au but de l’auteur pour qu’il
négligeât d’en orner son récit ; mais comment oublioit-il qu’elle avoit été réfutée
six siècles auparavant par Hérodote , qui reconnoît quelle est l ’ouvrage de quelques
Grecs, et que cette opinion est sans fondement ( 5 ) î Pline ne mérite pas plus de
confiance quand il assure gravement que Thaiès de Milet apprit à mesurer la
hauteur des pyramides, et de tous les corps semblables, par leur ombre (6); ou
bien quand il reproduit l’explication ( déjà qualifiée par Diodore de Sicile de
( 1 ) Voye^ Mémoire sur le système métrique des an- (4) Pline est plus d’accord avec Hérodote sur la déciens
Égyptiens, A. M . tome/ . " , page <¡78. pense de la nourriture des ouvriers qui ont construit la
( 2 ) Voyez planche 6, Antiquités, vol. V : la cote de GRANDE pyramide.
3 7 mètres n e com pren d pas to u te la c ro u p e . ( 5 ) Lib. I l , cap . CXXXIV , e t c i-d e s su s , p a g . 16 5 .
( 3 ) Descript. des pyramides ,A .D . c h .X V I I I , p. 95. ( 6 ) Diogène de Laërte se borne à dire que Thaiès de
A. TOM E II. 11