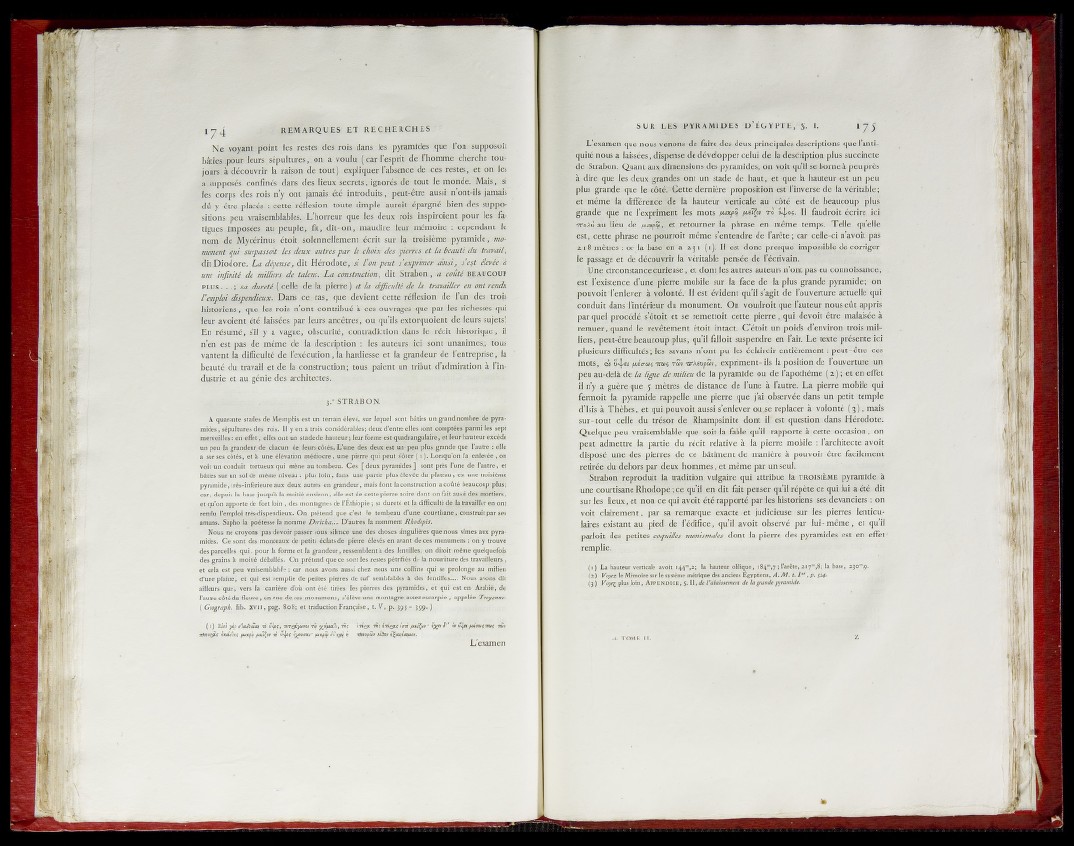
Ne voyant point les restes des rois dans les pyramides que Ion supposoit
bâties pour leurs sépultures, on a voulu (car l’esprit de l’homme cherche toujours
à découvrir la raison de tout) expliquer l’absence de ces restes, et on les
a supposés confinés dans des lieux secrets, ignorés de tout le monde. Mais, si
les corps des rois n’y ont jamais été introduits, peut-être aussi n’ont-ils jamais
dû y être placés : cette réflexion toute simple auroit épargné bien des suppositions
peu vraisemblables. L’horreur que les deux rois inspiroient pour les fatigues
imposées au peuple, fit, dit-on, maudire leur mémoire : cependant le
nom de Mycérinus étoit solennellement écrit sur la troisième pyramide, monument
qui surpassait les deux autres par le choix des pierres et la beauté du travail,
ditDiodore. La dépense, dit Hérodote, si l ’on peut s’exprimer ainsi, s ’est élevée à
une infinité de milliers de talens. La construction, dit Strabon, a coûté B E A U C O U P
P L U S sa dureté ( celle de la pierre) et la difficulté de la travailler en ont rendu
l ’emploi dispendieux. Dans ce cas, que devient cette réflexion de l’un des trois
historiens, que les rois n’ont contribué à ces ouvrages que par les richesses qui
leur avoient été laissées par leurs ancêtres, ou qu’ils extorquoient de leurs sujets!
En résumé, s’il y a vague, obscurité, contradiction dans le récit historique, il
n’en est pas de même de la description : les auteurs ici sont unanimes.; tous
vantent la difficulté de l’exécution, la hardiesse et la grandeur de l’entreprise, la
beauté du travail et de la construction; tous paient un tribut d’admiration à l’industrie
et au génie des architectes.
3." S T R A B O N .
A quarante stades de Memphis est un terrain élevé, sur lequel sont bâties un grand nombre de pyramides
, sépultures des rois. II y en a trois considérables; deux d’entre elles sont comptées parmi les sept
merveilles : en e ffe t , elles ont un stade de hauteur ; leur forme est quadrangulaire, et leur hauteur excède
un peu la grandeur de chacun de leurs côtés. L ’une des deux est un-peu plus grande que l ’autre : elle
a sur ses côtés , et à une élévation médio cre, une pierre qui peut s’ôter ( i ). Lorsqu’on l’a enlevée , on
voit un conduit tortueux qui mène au tombeau. C e s [d e u x pyramides] sont près l’une de l’autre, et
bâties sur un sol de même niveau ; plus lo in , dans une partie plus élevé e du p la teau, est une troisième
pyramide, très-inférieure aux deux autres en grandeur, mais dont la construction a coûté beaucoup plus;
car, depuis la base jusqu’à la moitié environ, elle est de cette pierre noire dont on fait aussi des mortiers,
et qu’on apporte de fort loin , des montagnes de l’Ethiopie ; sa dureté et la difficulté de la travailler en ont
rendu l’emploi très-dispendieux. O n prétend que c ’est le tombeau d’une cou rtisane, construit par ses
amans. Sapho la poétesse la nomme Doricha.... D ’autres la nomment Rhodopis.
Nous ne croyons pas devoir passer sous silence une des choses singulières que nous vîmes aux pyramides.
C e sont des monceaux de petits éclats de pierre élevés en avant de ces monumens : on y trouve
des parcelles q u i, pour la forme et la grandeur, ressemblent à des lentilles; on diroit même quelquefois
des grains à moitié déballés. O n prétend que ce sont les restes pétrifiés de la nourriture des travailleurs ,
e t cela est peu vraisemblable ; car nous avons aussi chez nous une colline qui se prolonge au milieu
d’une plaine, e t qui est remplie de petites pierres de tu f semblables à des lentilles.... Nous avons dit
ailleurs q u e , vers la- carrière d’où ont été tirées les pierres des pyramides, et q u i est en- A rabiè, de
l’autre côté du fleu v e , en vue de ces monumens, s’élève une montagne assez escarpée , appelée Troyenne.
( Geograph. lib. XVII, pag. 808; et traduction Française, t. V , p . 395 - 399. )
( I ) E/irî ydj> ffîa J icu a i tb tfyfoç, itT&Lyatroi rw , tS î i7 igÿt tHç iiiçt/LC ¿ tn i jutiÇwv ’ «T’ cv t y e t p i t r a ç tiwç twv
7&ivçffLç t x d ff% ç fuxpw fitîÇ o r 70 uyjaç iy o v tm i ' puypa Sx tfjq « nMvp ar htdoy tjécupioJfMV.
L’examen
L ’examen que nous venons de faire des deux principales descriptions que l’antiquité
nous a laissées, dispense de développer celui de la description plus succincte
de Strabon. Quant aux dimensions des pyramides, on voit qu’il se borne à peu près
à dire que les deux grandes ont un stade de haut, et que la hauteur est un peu
plus grande que le côté. Cette dernière proposition est l’inverse de la véritable;
et même la différence de la hauteur verticale au côté est de beaucoup plus
grande que ne l’expriment les mots /xixfZ /A,éïÇpv ro Il faudroit écrire ici
vroAÙ au lieu de (K .ijyS , et retourner la phrase en même temps. Telle qu’elle
est, cette phrase ne pourroit même s’entendre de l’arête ; car celle-ci n’avoit pas
218 mètres : or la base en a 231 (1). 11 est donc presque impossible de corriger
le passage et de découvrir la véritable pensée de l’écrivain.
Une circonstance curieuse, et dont les autres auteurs n’ont pas eu connoissaiice,
est l’existence d’une pierre mobile sur la face de la plus grande pyramide; on
pouvoit l’enlever à volonté. Il est évident qu’il s’agit de l’ouverture actuelle qui
conduit dans l’intérieur du monument. On voudrait que l’auteur nous eût appris
par quel procédé s’ôtoit et se remettoit cette pierre, qui devoit être malaisée à
remuer, quand le revêtement étoit intact. C’étoit un poids d’environ trois milliers,
peut-être beaucoup plus, qu’il falloit suspendre en l’air. Le texte présente ici
plusieurs difficultés; les savans n’ont pu les éclaircir entièrement : peut-être ces
mots, à v fAÀo-ac, im c , r m -arA su oS v , expriment - ils la position de l’ouverture un
peu au-delà de la ligne de milieu de la pyramide ou de l’apothême ( 2 ) ; et en effet
il n’y a guère que y mètres de distance de l’une à l’autre. La pierre mobile qui
fermoit la pyramide rappelle une pierre que j’ai observée dans un petit temple
d’Isis à Thèbes, et qui pouvoit aussi s’enlever ou se replacer à volonté (3), mais
sur-tout celle du trésor de Rhampsinite dont il est question dans Hérodote.
Quelque peu vraisemblable que soit la fable qu’il rapporte à cette occasion, on
peut admettre la partie du récit relative à la pierre mobile : l’architecte avoit
disposé une des pierres de ce bâtiment de manière à pouvoir être facilement
retirée du dehors par deux hommes, et même par un seul.
Strabon reproduit la tradition vulgaire qui attribue la t r o i s i èm e pyramide à
une courtisane Rhodope ; ce qu’il en dit fait penser qu’il répète ce qui lui a été dit
sur les lieux, et non ce qui avoit été rapporté par les historiens ses devanciers : on
voit clairement, par sa remarque exacte et judicieuse sur les pierres lenticulaires
existant au pied de l’édifice, qu’il avoit observé par lui - même, et qu’il
parloit des petites coquilles numismates dont la pierre des pyramides est en effet
remplie.
( 1) La hauteur verticale avoit > Ia hauteur obliq u e, 184m>7 » l'arête, 2.171" ,8; la base, 23o1"»9 *
( 2 ) Voyez le Mémoire sur le système métrique des anciens Égyptiens, A . A I . t. l . tT, p . 524.
( 3 ) Voye^ plus lo in , A p p e n d i c e , §. I I , de l ’abaissement de la grande pyramide.
A. TOME I I. Z