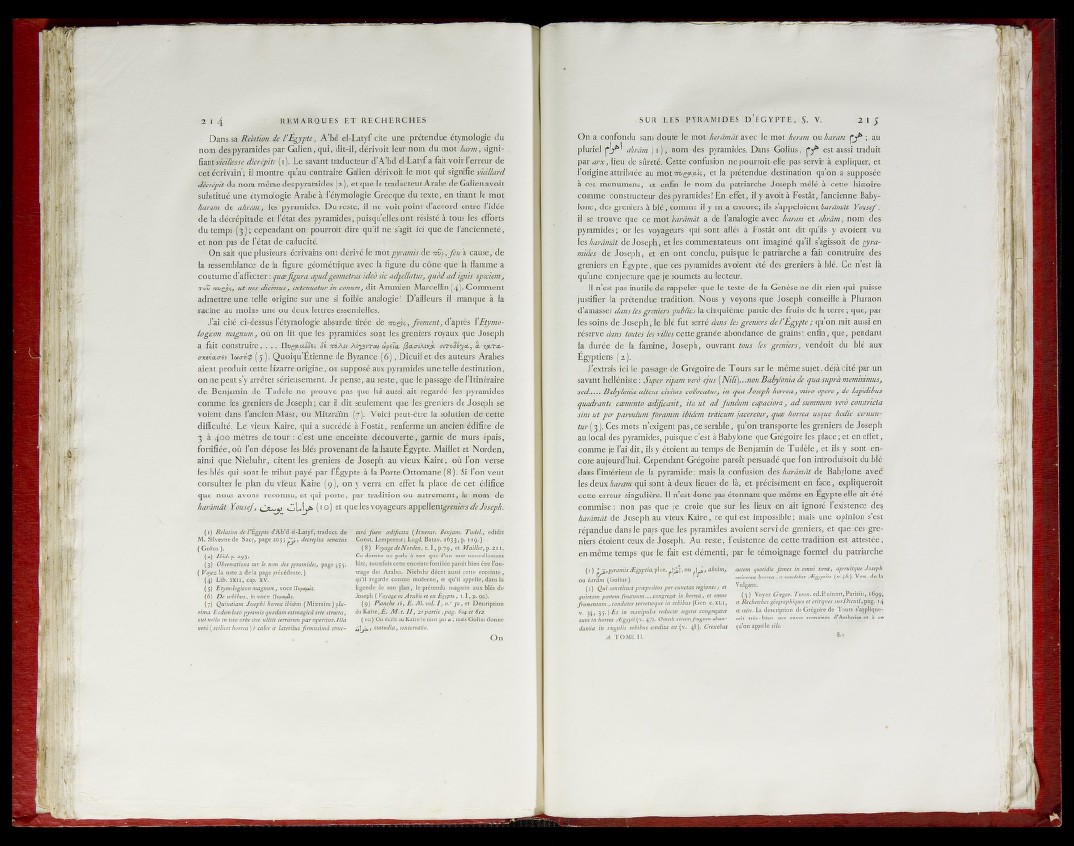
Dans sa Relation de l'Égypte, A ’bd el-Latyf cite une prétendue étymologie du
nom des pyramides par Galien, qui, dit-il, dérivoit leur nom du mot harm, signifiant
vieillesse décrépite (i). Le savant traducteur d’A ’bd el-Latyf a fait voir l’erreur de
cet écrivain; il montre qu’au contraire Galien dérivoit le mot qui signifie vieillard
décrépit du nom même des pyramides (a), et que le traducteur Arabe de Galien avoit
substitué une étymologie Arabe à l’étymologie Grecque du texte, en tirant le mot
haram de alirâm, les pyramides. Du reste, il ne voit point d’accord entre l’idée
de la décrépitude et l’état des pyramides, puisqu’elles ont résisté à tous les efforts
du temps (3); cependant on pourroit dire qu’il ne s’agit ici que de l’ancienneté,
et non pas de l’état de caducité.
On sait que plusieurs écrivains ont dérivé le motpyramis de nvp.feu à cause, de
la ressemblance de la figure géométrique avec la figure du cône que la flamme a
coutume d’affecter : quoefigura apudgeometras ideo sic adpellatur, quodad ignis speciem,
tov mjçyi, ut nos dicimus, extenuatur in conum, dit Ammien Marcellin (4)- Comment
admettre une telle origine sur une si foible analogie! D’ailleurs il manque à la
racine au moins une ou deux lettres essentielles.
J’ai cité ci-dessus l’étymologie absurde tirée de m/çyç, froment, d’après XEtymo-
logicon magnum, où on lit que les pyramides sont les greniers royaux que Joseph
a fait construire. . . . n t o A ü i A e j s m q àpéïa. ¿Scto-iAum, tr r r eS iy a ., a. x s c ra .-
o-xetlcto-eii ’Iamitp (y). Quoiqu’Étienne de Byzance (6), Dicuil et des auteurs Arabes
aient produit cette bizarre origine, ou supposé aux pyramides une telle destination,
on ne peut s’y arrêter sérieusement. Je pense, au reste, que le passage de l’Itinéraire
de Benjamin de Tudèle ne prouve pas que lui aussi ait regardé les pyramides
comme les greniers de Joseph; car il dit seulement que les greniers de Joseph se
voient dans l’ancien Masr, ou Mitzraïm (7). Voici peut-être la solution de cette
difficulté. Le vieux Kaire, qui a succédé à Fostât, renferme un ancien édifice de
3 à 400 mètres de tour : c’est une enceinte découverte, garnie de murs épais,
fortifiée, où l’on dépose les blés provenant de la haute Egypte. Maillet et Norden,
ainsi que Niebuhr, citent les greniers de Joseph au vieux Kaire, où l’on verse
les blés qui sont le tribut payé par l’Egypte à la Porte Ottomane (8). Si l’on veut
consulter le plan du vfeux Kaire (9), on y verra en effet la place de cet édifice
que nous avons reconnu, et qui porte, par tradition ou autrement, le nom de
harâmât Yousef, LàlJyt» (10) et que les voyageurs appellentgreniers de Joseph.
(1 ) Relation de l ’Egypte d’A b ’d el-Latyf, traduct.de turâ fuere oedificata ( Itinerar. Benjam. T u d e l edidit
M. Silvestre de Sacy, page 205; decrepita senectus Const. Lempereur; Lugd. Batav. 1633, p. 119.)
( Golius ). ( 8 ) Voyage de Norden , 1.1 , p. 79, et Mailler, p. 211.
(2) Ibid. p. 293. Ce dernier ne parle à tort que d’un mur nouvellement
(3 ) Observations sur le nom des pyramides, page 455. bâti; toutefois cette enceinte fortifiée paroît bien être l’ou-
( Voyez la. note 2 delà page précédente.) vrage des Arabes. Niebuhr décrit aussi cette enceinte,
(4) Lib. x x i i , cap. x v . qu’il regarde comme moderne, et qu’il appelle, dans la
(5) Etymologicon magnum, voce litwapuc. légende de son plan, le prétendu magasin aux blés de
(6 ) De urbibus, in voce Uupapiç. Joseph ( Voyage en Arabie et en Egypte, 1 .1, p. 99).
(7 ) Quinetiam Josephi horrea ibidem (Mitzraïm ) plu- (9) Planche ¡6 , E . A l. vol. / , n." $0, et Description
rima. Eodem loco pyramis queedam est magicâ arte structa, du Kaire, E. M . t. I I , 2.» partie, pag. 604. et 612.
cui nttlla in toto orbe sive ullibi terrarum par reperitur. Ilia (10) On écrit au Kaire le mot par e> ; mais Golius donne
vero ( scilicet horrea ) i calce et lateribus firmissimâ struc- ¿¡1^» custodia, conservatio.
On
On a confondu sans doute le mot harâmât avec le mot heram ou haram C f ; au
pluriel alirâm ( i ), nom des pyramides. Dans Golius, ç f i est aussi traduit
par arx, lieu de sûreté. Cette confusion ne pourroit-elle pas servir à expliquer, et
1 origine attribuée au mot Twçy-fii, et la prétendue destination qu’on a supposée
à ces monumens, et enfin le nom du patriarche Joseph mêlé, à cette histoire
comme constructeur des pyramides! En effet, il y avoit à Fostât, l’ancienne Baby-
lone, des greniers à blé, comme il y en a encore; ils s’appeloient harâmât Yousef:
il se trouve que ce mot harâmât a de l’analogie avec haram et ahrâm, nom des
pyramides; or les voyageurs qui sont allés à Fostât ont dit qu’ils y avoient vu
les harâmât de Joseph, et les commentateurs ont imaginé qu’il s’agissoit de pyramides
de Joseph, et en ont conclu, puisque le patriarche a fait construire des
greniers en Egypte, que ces pyramides avoient été des greniers à blé. Ce n’est là
qu’une conjecture que je soumets au lecteur.
Il n’est pas inutile de rappeler que le texte de la Genèse ne dit rien qui puisse
justifier la prétendue tradition. Nous y voyons que Joseph conseille à Pharaon
d’amasser dans les greniers publics la cinquième partie des fruits de la terre ; que, par
les soins de Joseph, le blé fut serré dans les greniers de l'Egypte ; qu’on mit aussi en
réserve dans toutes les villes cette grande abondance de grains ; enfin, que, pendant
la durée de la famine, Joseph, ouvrant tous les greniers, vendoit du blé aux
Égyptiens (2). .
J’extrais ici le passage de Grégoire de Tours sur le même sujet, déjà cité par un
savant helléniste : Super ripam vero ejus [Nili)...non Babylonia de qua suprà meminimus,
sed..... Babylonia altéra civitas collocatur, in qua Joseph horrea, miro opere, de lapidibus
quadrante coemento oedificavit, ila ut ad fundum capaciora, ad summum vero constricla
sint ut per parvulum foramen ibidem triticum jaceretur, quoe horrea usque hodie cemun-
tur ( 3 ). Ces mots n’exigent pas, ce semble, qu’on transporte les greniers de Joseph
au local des pyramides, puisque c’est à Babylone que Grégoire les place ; et en effet,
comme je l’ai dit, ils y étoient au temps de Benjamin de Tudèle, et ils y sont encore
aujourd’hui. Cependant Grégoire paroît persuadé que l’on introduisoit du blé
dans l’intérieur de la pyramide ; mais la confusion des harâmât de Babylone avec
les deux haram qui sont à deux lieues de là, et précisément en face, expliqueroit
cette erreur singulière. Il n'est donc pas étonnant que même en Egypte elle ait été
commise : non pas que je croie que sur les lieux on ait ignoré l’existence des
harâmât de Joseph au vieux Kaire, ce qui est impossible; mais une opinion s’est
répandue dans le pays que les pyramides avoient servi de greniers, et que ces greniers
étoient ceux de Joseph. Au reste, l’existence de cette tradition est attestée,
en même temps que le fait est démenti, par le témoignage formel du patriarche
( j ) pyramisÆgyptia,piu r. [-¿"j, ou \J>, ahrâm, autem quotidie famés in omni terra, aperuitque Joseph
ou haram (Golius ) universa horrea, et vendebat Ægypùis (v‘. 56). Vers, de la
(2) Qui constituât preepositos per cunctas regiones ; et Vulgate.
quintam partem fructuum congreget in horrea, et omne (3) Voyez Gregor. Turon. ed .Ruinait,Parisiis, 1699,
frumentum... condatur servent rque m urbibus (G en .c .X Li, et Recherches géographiques et critiques sur Dicuil, pag. 14
v j 4 ? E t in manipulos redactoe segetes congregatce etsuiv. La description de Grégoire de Tours sapplique-
sunt in horrea Ægypti (v. 47). Otnnis etiamfrugum abun- roit très-bien aux caves romaines d’Amboise et à ce
dantia in singulis urbibus condita est (v. 48). Crescebat qu’on appelle silo.