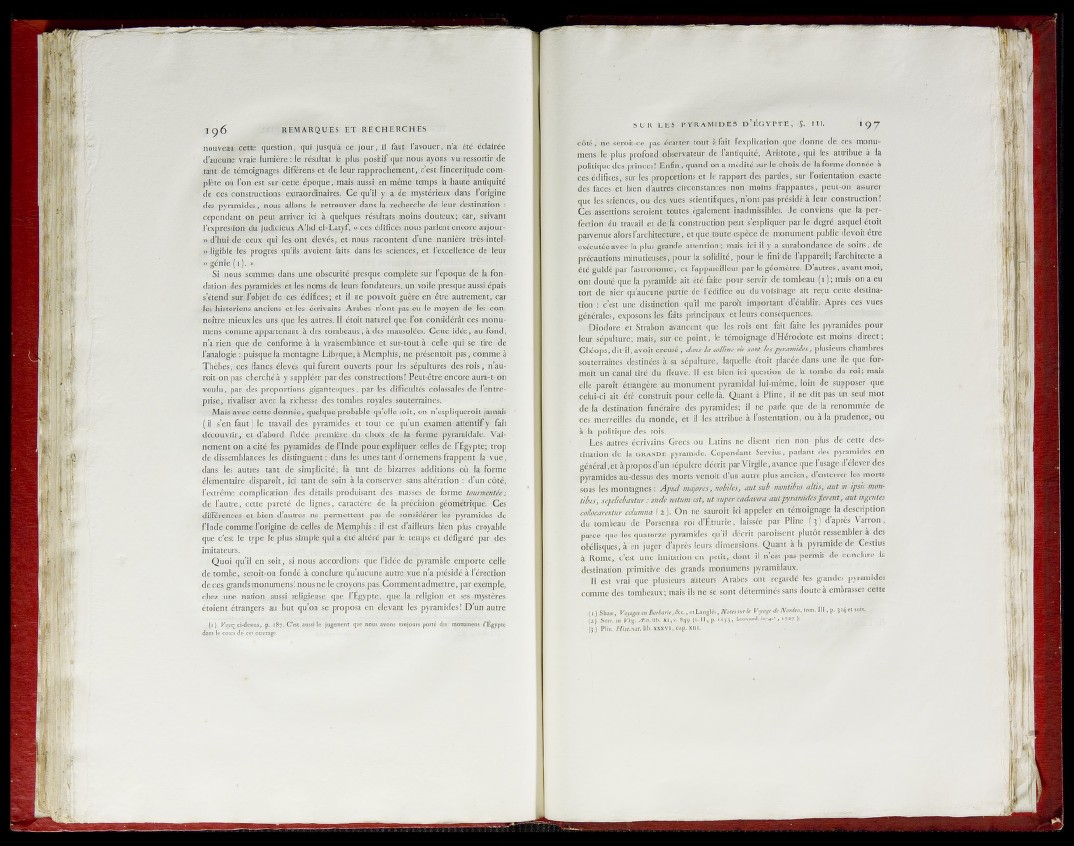
nouveau cette question, qui jusqu’à ce jour, il faut l’avouer, n’a été éclairée
d’aucune vraie lumière : le résultat le plus positif que nous ayons vu ressortir de
tant de témoignages différens et de leur rapprochement, c’est l’incertitude complète
où l’on est sur cette époque/mais aussi en même temps la haute antiquité
de ces constructions extraordinaires. Ce qu’il y a de mystérieux dan? l’origine
des pyramides, nous allons le retrouver dans la recherche de leur destination :
cependant on peut arriver ici à quelques résultats moins douteux; car, suivant
l’expression du judicieux A ’bd el-Latyf, « ces édifices nous parlent encore aujour-
» d’hui de ceux qui les ont élevés, et nous racontent d’une manière très-intel-
« iigible les progrès qu’ils avoient faits dans les sciences, et l’excellence de leur
» génie (i). »
Si nous sommes dans une obscurité presque complète sur l’époque de la fondation
des pyramides et les noms de leurs fondateurs, un voile presque aussi épais
s’étend sur l’objet de ces édifices; et il ne pouvoit guère en être autrement, car
les historiens anciens et les écrivains Arabes n’ont pas eu le moyen de les con-
noître mieux les uns que les autres. Il étoit naturel que l’on considérât ces monumens
comme appartenant à des tombeaux, à des mausolées. Cette idée, au fond,
n’a rien que de conforme à la vraisemblance et sur-tout à celle qui se tire de
l’analogie : puisque la montagne Libyque1, àMemphis, ne présentoit pas, comme à
Thèbes, ces flancs élevés qui furent ouverts pour les sépultures des rois, n’au-
roit-on pas cherché à y suppléer par des constructions! Peut-être encore aura-t on
voulu, par des proportions gigantesques, par les difficultés colossales de l’entreprise,
rivaliser avec la richesse des tombes royales souterraines.
Mais avec cette donnée, quelque probable qu’elle soit, on n’expliqueroit jamais
( il s’en faut ) le travail des pyramides et tout ce qu’un examen attentif y fait
découvrir, et d’abord l’idée première du choix de la forme pyramidale. Vainement
on a cité les pyramides de l’Inde pour expliquer celles de l’Egypte; trop
de dissemblances les distinguent: dans les unes tant d’ornemens frappent la vue,
dans les autres tant de simplicité ; là tant de bizarres additions où la forme
élémentaire disparoît, ici tant de soin à la conserver sans altération : d’un côté,
l’extrême complication des détails produisant des masses de forme tourmentée ;
de l’autre, cette pureté de lignes, caractère de la précision géométrique. Ces
différences et bien d’autres ne permettent pas de considérer les pyramides de
l’Inde comme l’origine de celles de Memphis : il est d’ailleurs bien plus croyable
que c’est le type le plus simple qui a été altéré par le temps et défiguré par des
imitateurs.
Quoi qu’il en soit, si nous accordions que l’idée de pyramide emporte celle
de tombe, seroit-on fondé à conclure qu’aucune autre vue n’a présidé à l’érection
de ces grands monumens! nous ne le croyons pas. Comment admettre, par exemple,
chez une nation aussi religieuse que l’Egypte, que la religion et ses mystères
étoient étrangers au but qu’on se proposa en élevant les pyramides! D’un autre
( i ) Voye^ ci-dessus, p. 187. C’est aussi le jugement que nous avons toujours porté des - monumens d’Egypte
dans le cours de cet ouvrage.
côté,' ne seroit-ce pas écarter tout à fait l’explication que donne de ces monumens
le plus profond observateur de 1 antiquité, Aristote, qui les attribue à la
politique des princes! Enfin, quand on a médité sur le choix de la forme donnée à
ces édifices, sur les proportions et le rapport des. parties, sur 1 orientation exacte
des faces et bien d’autres circonstances non moins frappantes, peut-on assurer
que les sciences, ou des vues scientifiques, n’ont pas présidé à leur construction!
Ces assertions seroient toutes.également inadmissibles. Je conviens que la perfection
du travail et de la construction peut s’expliquer par le degré auquel étoit
parvenue alors l’architecture, et que toute espèce de monument public devoit être
exécutée avec la plus grande attention ; mais ici il y a surabondance de soins, de
précautions minutieuses, pour la solidité, pour le fini de 1 appareil; 1 architecte a
été guidé par l’astronome, et l’appareilleur par le géomètre. D ’autres, avant moi,
ont douté que la pyramide ait ete faite pour servir de tombeau ( i ) ; mais on a eu
tort de nier qu’aucune partie de l’édifice ou du voisinage ait reçu cette destination
: c’est une distinction qu’il me paroît important d établir. Apres ces vues
générales, exposons les faits principaux et leurs conséquences.
Diodore et Strabon avancent que les rois ont fait faire les pyramides pour
leur sépulture; mais, sur ce point, le témoignage d’Hérodote est moins direct;
Chéops, dit-il, avoit creusé, dans la colline où sont les pyramides, plusieurs chambres
souterraines destinées à sa sépulture, laquelle étoit placée dans une île que for-
moit un canal tiré du fleuve. II est bien ici question de la’ tombe du roi; mais
elle paroît étrangère au monument pyramidal lui-même, loin de supposer que
celui-ci ait été construit pour celle-là. Quant à Pline, il ne dit pas un seul mot
de la destination funéraire des pyramides; il ne parle que de la renommée de
ces merveilles du monde, et il les attribue a I ostentation, ou a la prudence, ou
à la politique des rois.
Les autres écrivains Grecs ou Latins ne disent rien non plus de cette destination
de la g r a n d e pyramide. Cependant Servius, parlant des pyramides en
général, et à propos d’un sépulcre décrit par Virgile, avance que l’usage d’élever des
pyramides au-dessus des morts venoit d un autre plus ancien, d enterrer les morts
sous les montagnes : Apud majores, nobiles, aut sub montibus altis, aut in ipsis mon-
tibus, sepeliebantur : unde natum est, ut super cadavera aut pyramides fièrent, aut in ¡rentes
collocarentur columnæ {2). On ne sauroit ici appeler en témoignage la description
du tombeau de Porsenna roi d’Étrurie, laissée par Pline (3) d après Varron,
parce que les quatorze pyramides qu’il décrit paroissent plutôt ressembla à des
obélisques, à en juger d’après leurs dimensions. Quant a la pyramide de Cestius
à Rome,, c’est une imitation en petit, dont il n est pas permis de conclure la
destination primitive des grands monumens pyramidaux.
Il est vrai que plusieurs auteurs Arabes ont regardé les grandes pyramides
comme des tombeaux; mais ils ne se sont déterminés sans doute a embrasser cette
( Ï ) Shaw, Voyages en Barbarie, & c „ et Langlès , Notes sur le Voyage de Norden, ton.. I I I , p. 3 14 et suiv.
(2) Serv. in Virg. /En. Iib. XI, v. 849 ( t. I I , p. 1153, Leovard. i11-4.’ , 1727 ).
( 3 ) Plin. Hist.nat. Iib. X X X V I, c a p . x i u .