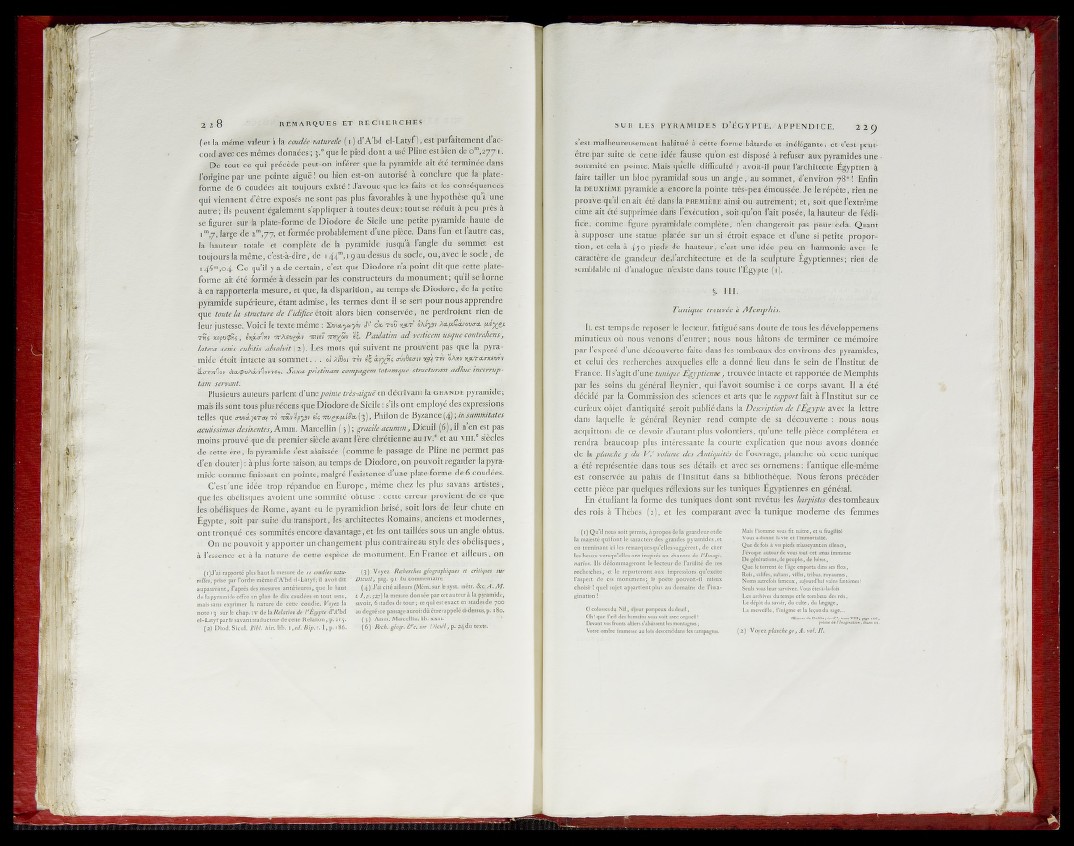
(et la même valeur à la coudée naturelle ( i ) d’A ’bd el-Latyf), est parfaitement d accord
avec ces mêmes données; 3,° que le pied dont a usé Pline est bien de om,2 y y i.
De tout ce qui précède peut-on inférer que la pyramide ait été terminée dans
l’origine par une pointe aiguë! ou bien est-on autorisé à conclure que la plateforme
de 6 coudées ait toujours existé ! J’avoue que les faits et les conséquences
qui viennent d’être exposés ne sont pas plus favorables à une hypothèse qu’à une
autre; ils peuvent également s’appliquer à toutes deux : tout se réduit a peu près a
se figurer sur la plate-forme de Diodore de Sicile une petite pyramide haute de
1 m,y, large de zm,yy, et formée probablement d’une pièce. Dans 1 un et 1 autre cas,
la hauteur totale et complète de la pyramide jusqu’à l’angle du sommet est
toujours la même, c’est-à-dire, de 144m, 19 au dessus du socle, ou, avec le socle, de
i4 6m,o4. C e qu’il y a de certain, c’est que Diodore n’a point dit que cette plateforme
ait été formée à dessein par les constructeurs du monument; qu il se borne
à en rapporter la mesure, et que, la disparition, au temps de Diodore, de la petite
pyramide supérieure, étant admise, les termes dont il se sert pour nous apprendre
que toute la structure de l ’édifice étoit alors bien conservée, ne perdroient rien de
leur justesse. Voici le texte même : Zv]/d.ye>y>n A’ ox. roi; xstr ¿A¡■gv Ao./a£cî.vova-a. p-iyyj.
Tris xôf'jtpr.ç, êj&erlyv nrAevgfv nviei 7njypv e£. Paulatun ad vcrticem usque contrahens,
latera seuls cubitis absolvit (2). Les mots qui suivent ne prouvent pas que la pyramide
étoit intacte au sommet. . . 0! a/Soi m'v &, ¿-pyfi <ruv0e<m xÿ)-™ oAtui user a-o-xz vit
Îcrv-irloii <ha,<pvA<iflovT£i. Saxa pristinam compagem totamque structurant adhuc incorrup-
tant servant.
Plusieurs auteurs parlent d’une pointe très-aiguë en décrivant la g r a n d e pyramide;
mais ils sont tous plus récens que Diodore de Sicile : s ils ont employé des expressions
telles que tjvvâ.yiTai to imv ’¿¡rg)/ fjp ’nvçy.uAëa. (3], Philon de Byzance (4) ;111 sumfhitates
acutissimas desinentes, Amm. Marcellin (y); gracile acumen, Dicuil (6 ),il nen est pas
moins prouvé que du premier siècle avant l’ère chrétienne au iv .e et au v iii.' siècles
de cette ère, la pyramide s’est abaissée (comme le passage de Pline ne permet pas
d’en douter) : à plus forte raison, au temps de Diodore, on pouvoit regarder la pyramide
comme finissant en pointe, malgré l’existence d une plate-forme de 6 coudées.
C ’est'une idée trop répandue en Europe, même chez les plus savans artistes,
que les obélisques avoient une sommité obtuse : cette erreur provient de ce que
les obélisques de Rome, ayant eu le pyramidion brisé, soit lors de leur chute en
Egypte, soit par suite du transport, les architectes Romains, anciens et modernes,
ont tronqué ces sommités encore davantage, et les ont taillees sous un angle obtus.
On ne pouvoit y apporter un changement plus contraire au style des obélisques,
à l’essence et à la nature de cette espèce de monument. En France et ailleurs, on
( i)J ’ai rapporté plus haut la mesure de // coudées natu- (3) Voyez Recherches géographiques et critiques sur
reliesj prise par l’ordre même d’A ’bd el-Latyf; il avoitdit Dicuil, pag. 91 du commentaire.
auparavant, d’après des mesures antérieures, que le haut ( A) J’ai cité ailleurs (Mém.sur le syst. métr. & c . A .M .
de la pyramide offre un plan de dix coudées en tout sens, t. I,p.yzy) la mesure donnée par cet auteur a la pyramide,
mais sans exprimer la nature de cette coudée. Voyez la savoir, 6 stades de tour; ce qui est exact en stades de 700
note 13 sur le chap. IV de la Relation de l*Egypte d’A’bd au degré : ce passage auroit du etre rappelé ci-dessus, p. 180.
el-Latyfpar le savant traducteur de cette Relation, p. 215. (5) Amm. Marcellin. lib. x x i i .
( 2) Diod. Sicul. Bibl. hist. lib. 1, ed. Bip. 1.1 , p. 186. ( 6 ) Rech. géogr. & c. sur Dicuil| p. 2/3. du texte.
s’est malheureusement habitué à cétte forme bâtarde et inélégante, et c’est peut-
être.par suite de cette idée fausse qu’on est disposé à refuser aux pyramides une
sommité en pointe. Mais quelle difficulté y avoit-il pour l’architecte Égyptien à
faire tailler un bloc pyramidal sous un angle, au sommet, d’fenviron 78°! Enfin
la d e u x i è m e pyramide a encore la pointe très-peu émoussée. Je le répète, rien ne
prouve qu’il en ait été dans la p r e m i è r e ainsi ou autrement; et, soif que l’extrêmfe
cime ait été supprimée dans l’exécution, soit qu’on l’ait posée, la hauteur de l’édifice,
comme figure pyrainidale complète, n’en changeroit pas pour cela. Quant
à supposer une statue placée sur un si étroit espace et d’une si petite proportion,
et cela à 4 jo pieds de hauteur, c’est une idée peu en harmonie avec le
caractère de grandeur de,l’architecture et de la sculpture Égyptiennes; rien de
semblable ni d’analogue n’existe dans toute l’Égypte (1).
§. III.
Tunique trouvée à Memphis.
I l est temps de reposer le lecteur, fatigué sans doute de tous les développemens
minutieux où nous venons" d’entrer ; nous nous hâtons de terminer ce mémoire
par 1 exposé d’une découverte faite dans les tombeaux des environs des pyramides,
et celui des recherches auxquelles elle a donné lieu dans le sein de l’Institut de
France. Il s’agit d’une tunique Egyptienne, trouvée intacte et rapportée de Memphis
par les soins du général Reynier, qui l’avoit soumise à ce corps savant. Il a été
décidé par la Commission des sciences et arts que le rapport fait à l’Institut sur ce
curieux objet d’antiquité seroit publié dans la Description de l’Egypte avec la lettre
dans laquelle le général Reynier rend compte de sa découverte : nous nous
acquittons de ce devoir d’autant plus volontiers, qu’une telle pièce complétera et
rendra beaucoup plus intéressante la courte explication que nous avons donnée
de la planche y du V.‘ volume des Antiquités de l’ouvrage, planche où cette tunique
a été représentée dans tous ses détails et avec ses ornemens : l’antique elle-même
est conservée au palais de l’Institut dans sa bibliothèque. Nous ferons précéder
cette pièce par quelques réflexions sur les tuniques Égyptiennes en général.
En étudiant la forme des tuniques dont sont revêtus les harpistes des tombeaux
des rois à Thèbes (2), et les comparant avec la tunique moderne des femmes
Mais l’homme vous fit naître, et sa fragilité
Vous a donné la vie et l’immortalité.
Que de fois à vos pieds m’asseyant en silence,
J’évoque autour de vous tout cet amas immense
De générations, de peuples, de héros,
Que le torrent de l’âge emporta dans ses flots,
Rois, califes, sultans, villes, tribus, royaumes,
Noms autrefois fameux, aujourd’hui vains fantômes!
Seuls vous leur survivez. Vous êtes à-Ia-fois
Les archives du temps et le tombeau des rois,
Le dépôt du savoir, du culte, du langage,
La merveille, l’énigme et la leçon du sage....
OEuvres de D clillc, in-S.’, tome VIII, page 166,
poème de l’Imagination, chant 111.
( 2 ) Voyez planche p i , A . vol. I I .
(1) Qu’il nous soit permis, à propos de la grandeur et de
la majesté qui font le caractère des grandes pyramides, et
en terminant ici les remarques qu’elles suggèrent, de citer
les beaux vers qu’elles ont inspirés au chantre de l’Imagination.
Ils dédommageront le lecteur de l’aridité de ces
recherches, et le reporteront aux impressions qu’excite
l’aspeçt de ces monumens; le poëte pouvoit-il mieux
choisir ! quel sujet appartient plus au domaine de l’imagination
!
O colosses du Nil, séjour pompeux du deuil,
Oh! que l’oeil des humains vous voit avec orgueil !
Devant vos fronts alders s’abaissent (es montagnes ;
Votre ombre immense au loin descend dans les campagnes.