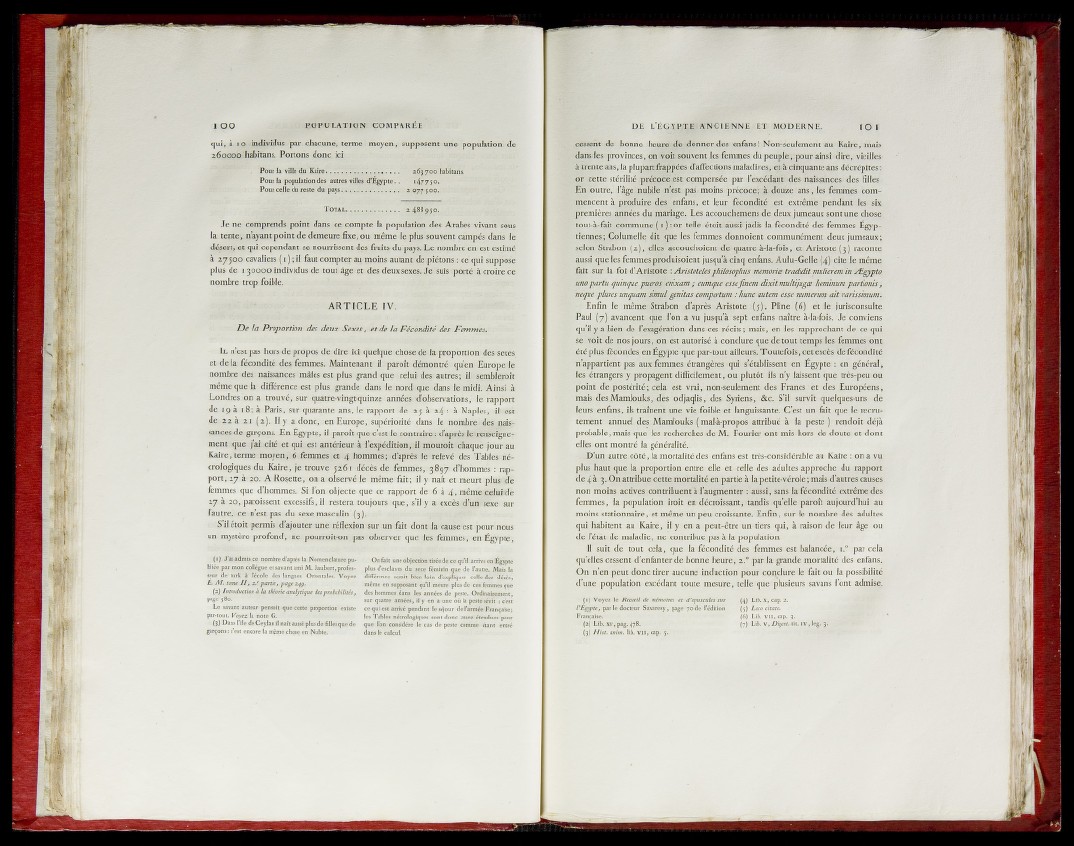
qui, à 10 individus par chacune, terme moyen, supposent une population de
260000 habitans. Portons donc ici
Pou r la ville du K a ire .................................................. 2 6 3 700 habitans.
Pou r fa population des autres villes d’E g y p t e . . 1 4 7 7 5 0 .
P ou r celle du reste du p a y s ....................................... 2 0 7 7 5 00.
T o t a l .................................................. 2 4 8 8 9 5 0 .
Je ne comprends point dans ce compte la population des Arabes vivant sous
la tente, n’ayant point de demeure fixe, ou même le plus souvent campés dans le
désert, et qui cependant se nourrissent des fruits du pays. Le nombre en est estimé
à 27500 cavaliers ( i ) ; il faut compter au moins autant de piétons : ce qui suppose
plus de 130000 individus de tout âge et des deux sexes. Je suis porté à croire ce
nombre trop foible.
A R T I C L E IV.
D e la Proportion des deux Sexes, et de la Fécondité des Femmes.
Il n est pas hors de propos de dire ici quelque chose de la proportion des sexes
et de la fécondité des femmes. Maintenant il paroît démontré qu’en Europe le
nombre des naissances mâles est plus grand que celui des autres; il sembleroit
meme que la différence est plus grande dans le nord que dans le midi. Ainsi à
Londres on a trouvé,- sur quatre-vingt-quinze années d’observations, le rapport
de 19 à 18; à Paris, sur quarante ans, le rapport de 25 à 24 : à Naples, il est
de 22 à 21 (2). Il y a donc, en Europe, supériorité dans le nombre des naissances
de garçons. En Egypte, il paroît que c’est le contraire : d’après le renseignement
que j ai cité et qui est antérieur à l’expédition, il mouroit chaque jour au
Kaire, terme moyen, 6 femmes et 4 hommes; d’après le relevé des Tables nécrologiques
du Kaire, je trouve 5261 décès de femmes, 3897 d’hommes : rapport,
27 à 20. A Rosette, on a observé le même fait; il y naît et meurt plus de
femmes que d’hommes. Si l’on objecte que ce rapport de 6 à 4 , même celui de
27 à 20, paroissent excessifs, il restera toujours que, s’il y a excès d’un sexe sur
l’autre, ce n’est pas du sexe masculin (3).
S’il étoit permis d’ajouter une réflexion sur un fait dont la cause est pour nous
un mystère profond, ne pourroit-on pas observer que les femmes, en Egypte,
(1) J ai admis ce nombre d après la Nomenclature pu- On fait une objection tirée de ce qu’il arrive en Egypte
bliée par mon collègue et savant ami M. Jaubert, profes- plus d’esclaves du sexe féminin que de l’autre. Mais la
seur de turk a 1 école des langues Orientales. Voyez différence serait bien loin d’expliquer celle des décès,
E . M . tome I I , 2.* partie, page 24p. même en supposant qu’il meure plus de ces femmes que
(2) Introduction a la théorie analytique des probabilités, des hommes dans les années de peste. Ordinairement,
page 380. sur quatre années, il y en a une où la peste sévit : c’est
Le savant auteur pensoit que cette proportion existe ce qui est arrivé pendant le séjour de l’armée Française;
par-tout. Voyez la note G. les Tables nécrologiques sont donc assez étendues pour
(3) Dans 1 île de Ceyjan il naît aussi plus de filles que de que l’on considère le cas de peste comme étant entré
garçons : c’est encore la même chose en Nubie. dans le calcul.
cessent de bonne heure de donner des enfans! Non-seulement au Kaire, mais
dans les provinces, on voit souvent les femmes du peuple, pour ainsi dire, vieilles
àtrente ans,la plupart frappées d’affections maladives, et à cinquante ans décrépites:
or cette stérilité précoce est compensée par l’excédant des naissances des filles
En outre, l’âge nubile n’est pas moins précoce; à douze ans, les femmes commencent
à produire des enfans, et leur fécondité est extrême pendant les six
premières années du mariage. Les accouchemens de deux jumeaux sont une chose
tout-à-fait commune ( t ) : or telle étoit aussi jadis la fécondité des femmes Égyptiennes;
Columelle dit que les femmes donnoient communément deux jumeaux;
selon Strabon (2), elles accouchoient de quatre à-la-fois, et Aristote (3) raconte
aussi que les femmes produisoient jusqu’à cinq enfans. Aulu-Gelle (4 ) cite le même
fait sur la foi d’Aristote : Aristotelesphilosophas memorioe tradidit mulierem in Ægypto
uno partit quinquc pueros enixam ; eumque essefinem dixit mulhjugce hominum partionis,
neque pliires unquam simili genitas compertum : hune autem esse numerum ait rarissimum.
Enfin le même Strabon d’après Aristote (5), Pline (6) et le jurisconsulte
Paul (7) avancent que l’on a vu jusqu’à sept enfans naître à-la-fois. Je conviens
qu’il y a bien de l’exagération dans ces récits ; mais, en les rapprochant de ce qui
se voit de nos jours, on est autorisé à conclure que de tout temps les femmes ont
été plus fécondes en Egypte que par-tout ailleurs. Toutefois, cet excès de fécondité
n’appartient pas aux femmes étrangères qui s’établissent en Egypte : en général,
les étrangers y propagent difficilement, ou plutôt ils n’y laissent que très-peu ou
point de postérité; cela est vrai, non-seulement des Francs et des Européens,
mais des Mamlouks, des odjaqlis, des Syriens, &c. S’il survit quelques-uns de
leurs enfans, ils traînent une vie foible et languissante. C ’est un fait que le recrutement
annuel des Mamlouks ( mal-à-propos attribué à la peste ) rendoit déjà
probable, mais que les recherches de M. Fourier ont mis hors de doute et dont
elles ont montré la généralité.
D ’un autre côté., la mortalité des enfans est très-considérable au Kaire : on a vu
plus haut que la proportion entre elle et celle des adultes approche du rapport
de 4 à 3. On attribue cette mortalité en partie à la petite-vérole ; mais d’autres causes
non moins actives contribuent à l’augmenter : aussi, sans la fécondité extrême des
femmes, la population iroit en décroissant, tandis qu’elle paroît aujourd’hui au
moins stationnaire, et même un peu croissante. Enfin, sur le nombre des adultes
qui habitent au Kaire, il y en a peut-être un tiers qui, à raison de leur âge ou
de l’état de maladie, ne contribue pas à la population.
Il suit de tout cela, que la fécondité des femmes est balancée, i.° par cela
qu’elles cessent d’enfanter de bonne heure, 2.0 par la grande mortalité des enfans.
On n’en peut donc tirer aucune induction pour conclure le fait ou la possibilité
d’une population excédant toute mesure, telle que plusieurs savans l’ont admise.
(1) Voyez le Recueil de mémoires et d’opuscules sur (4) Lib. x , cap. 2.
l’Egypte, par le docteur Savaresy, page 70 de l’édition (5) Loco citato.
Française. (6) Lib. v i l , cap. 3.
(2) Lib. x v , pag. 478. (7) Lib. v , Digest. rit. iv ,I e g . 3.
(3) Hist. anim. lib. VII, cap. 5.