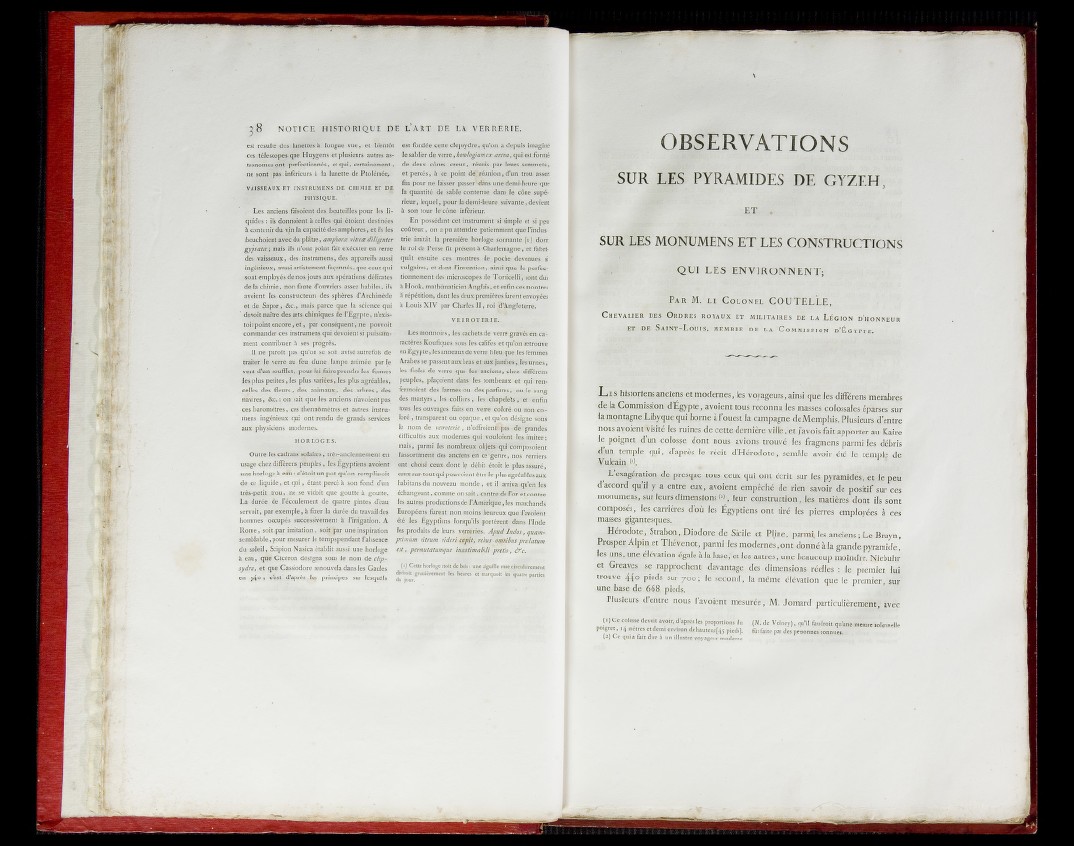
A
est résulté des lunettes à longue v u e , et bientôt
ces télescopes que Huygens et plusieurs autres astronomes
ont perfectionnés, et qui, certainement,
ne sont pas.inférieurs à la lunette de Ptolémée,
VAISSEAUX ET INSTRUMENS DE CHIMIE ET DE
PHYSIQUE.
Le s anciens fàisoient des bouteilles pour les liquides
: ils donnoient à celles qui étoient destinées
à contenir du vjn la capacité des amphores, e t ils les
bouchoient avec du p lâ tre , amphores vitreoe diligenter
gypsatoe ; mais ils n’ont point fait exécuter en verre
des vaisseaux, des instrumens, des appareils aussi
ingénieux, aussi artistement façonnés, que ceux qui
sont employés de nos jours aux opérations délicates
de la chimie, non faute d’ouvriers assez habiles, ifs
avoient les constructeurs des sphères d’Archimède
et de S ap o r , & c . , mais parce que fa science qui
' devoit naître des arts chimiques de l’E g yp te , n’exis-
toit point encore , e t , par conséquent, ne pouvoit
commander ces instrumens qui devoient si puissamment
contribuer h ses progrès.
II ne paroît pas qu’on se soit avisé autrefois de
traiter le verre au feu d’u n e . lampe animée par le
vent d’un soufflet, pour lui faire prendre les formes
les plus pe tite s , les plus variées, les plus agréables,
celles des fleu r s , des animaux, des arbres , des
navires, &q. : on sait que les anciens n’avoient pas
ces baromètres, ces thermômètres et autres instru-
mens ingénieux qui ont rendu de grands services
aux physiciens modernes.
H O R L O G E S .
Outre les cadrans solaires, très-anciennement en
usage chez differens p eu p le s , les Egyptiens avoient
une horloge à eau : c’étoit un pot qu’on reinplissoit
de ce liquide, et q u i , étant percé à son fond d’un
très-petit trou, ne se vidoit que goutte à g o u t te ..
La durée de l’écoulement de quatre pintes d’eau
servoit, par ex em p le , à fixer la durée du travail des
hommes occupés successivement à l ’irrigation. A
R om e , soit par imitation, soit par une inspiration
semblable, pour mesurer le temps pendant l’absence
du so le il, Scipion Nasica établit aussi une horloge
à eau, que Cicéron désigna sous le nom de clep-
sydra, e t que Cassiodore renouvela dans les Gaules
en 5 4 ° î c’est d’après les principes sur lesquéfs
est fondée cette clepsydre, qu’on a depuis imaginé
le sablier de verre, horologium ex arena, qui est formé
de deux cônes creux , réunis par leurs sommets,
et percés, à ce point dé 'réunion, d’un trou assez
fin pour ne laisser passer-dans une demi-heure que
la quantité de sable contenue dans le cône supérieur,
lequel, pour la demi-heure suivante, devient
à son tour le cône inférieur.
En possédant cet instrument si simple et si ppu
c oû te u x , on a pu attendre patiemment que l’industrie
imitât fa première horloge sonnante ( i ) dont
le roi de Perse fit présent à Charfemagne, et fabriquât
ensuite ces montres de poche devenues si
vulgaires, et dont l’invention, ainsi que le perfectionnement
des microscopes de Torriceffi, sont dus
à H o o k , mathématicien A nglais, e t enfin ces montres
â répétition, dont les deux premières furent envoyées
h Louis X IV par Charles I I , roi d’Angleterre.
V E R R O T E R IE .
Les monnoies, les cachets de verre gravés en caractères
Koufiques sous les califes et qu’on retrouve
en E g yp te , les anneaux de verre bleu que les femmes
Arabes se passent aux bras et aux jambes, les urnes,
les fioles de verre que les anciens, chez différens
peuples, plaçoient dans les.tombeaux e t qui ren-
fermoient des larmes ou des parfums, ou le sang
des martyrs, les co llie rs , les ch ap e le ïs , et enfin
tous les ouvrages faits en verre coloré ou non co loré
, transparent ou opaque , et qu’on désigne sous
le nom de verroterie, n’offroienf pas de grandes
difficultés aux modernes qui vouloient les imiter;
mais, parmi les nombreux objets qui composoient
l’assortiment des anciens en ce*genre, nos verriers
ont choisi ceux ,d on t le débit étoit le plus assuré,
ceux sur-tout qui pouvoient être le plus agréables aux
habitons du nouveau monde , e t il arriva qu’en les
. échangeant, comme on sait, contre de l’or et contre
les autres productions de l’Amérique, les marchands
Européens furent non moins heureux que l’avoient
été les Egyptiens lorsqu’ils portèrent dans l ’Inde
les produits de leurs verreries. Apud Indos, quam-
primùm vitrum videri coepit, rebus omnibus proelatum
e s t , permutatumque inoestimabili prètio, & c .
( i) Cette horloge étoit de bois : une aiguille mue circulairement
divisoit grossièrement les heures et marquoit les quatre parties
du jour.
OBSERVATIONS
SUR LES PYRAMIDES DE GYZEH,
E T .
SUR LES MONUMENS ET LES CONSTRUCTIONS
QUI LES ENVIRONNENT;
P a r M. l e C o l o n e l C O U T E L L E ,
C h e v a l i e r d e s O r d r e s r o y a u x e t m i l i t a i r e s d e l a L é g i o n d ’ h o n n e u r
e t d e S a i n t - L o u i s , m e m b r e d e l a C o m m i s s i o n d ’ É g y p t e .
L es historiens anciens et modernes, les voyageurs, ainsi cjue les difïerens membres
de la Commission d’Égypte, avoient tous reconnu les masses colossales éparses sur
la montagne Libyque qui borne à l’ouest la campagne deMemphis. Plusieurs d’entre
nous avoient visité les ruines de cette dernière ville, et j’avois fait apporter au Kaire
le poignet d un colosse dont nous avions trouvé les fragmens parmi les débris
d un temple qui, d après le récit d’Hérodote, semble avoir été le temple de
Vulcain ('l
^ L exagération de presque tous ceux qui ont écrit sur les pyramides, et le peu
d accord quil y a entre eux, avoient empêché de rien savoir de positif sur ces
monumens, sur leurs dimensions W, leur construction, les matières dont ils sont
composés, les carrières d’où les Égyptiens ont tiré les pierres employées à ces
masses gigantesques.
Hérodote, Strabon, Diodore de Sicile et Pline, parmi les anciens ; Le Bruyn,
Prosper Alpin et Thévenot, parmi les moderne^, ont donné àla grande pyramide,
les uns, une élévation égale a la base,'et les autres, une beaucoup moindre. Niebuhr
et Greaves se rapprochent davantage des dimensions réelles : le premier lui
trouve 44° pieds sur 700; le second, la même élévation que le premier, sur
une base de 668 pieds.
Plusieurs d entre nous i avoient mesurée, M. Jomard particulièrement, avec
( 0 Ce colosse devoit avoir, d’après les proportions du (M. de Volney), qu’il faudrait qu’une mesure solennelle
poignet, 14 mettes et demi environ de hauteur [45 pieds], fût faite par des personnes connues.
(2) Ce qui a fait dire à un illustre voyageur moderne