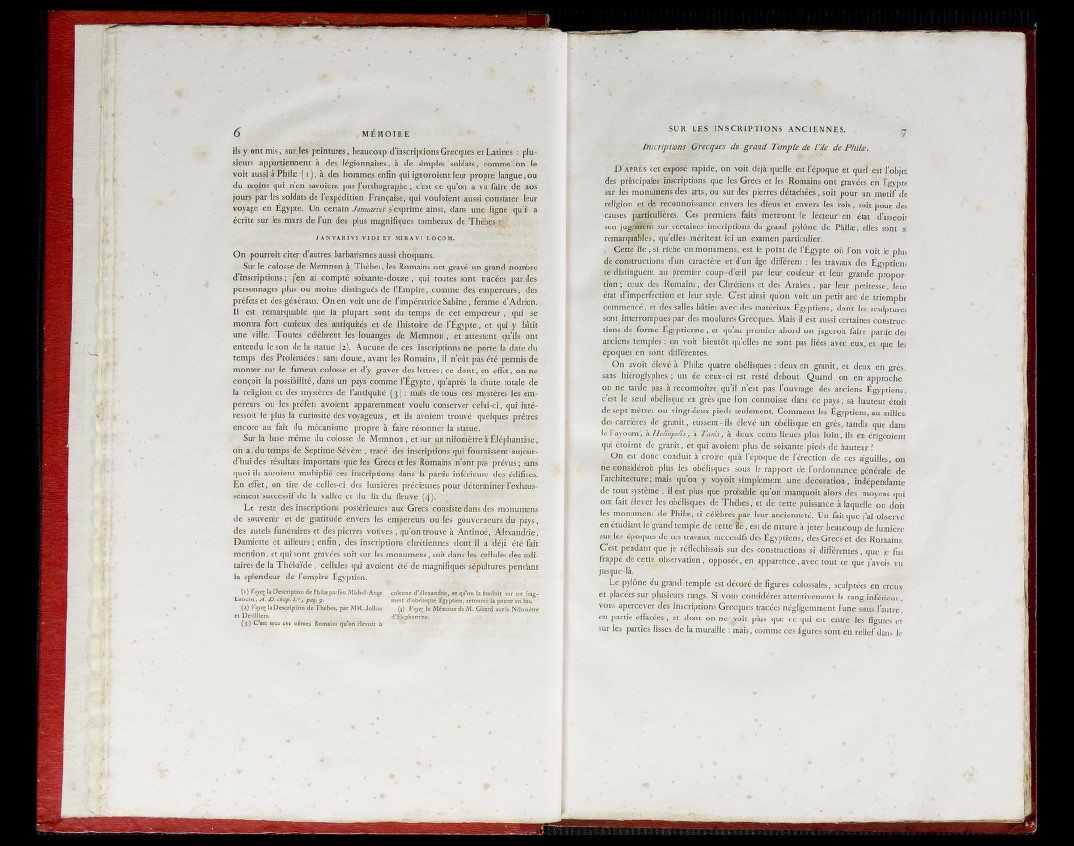
ils y ont mis, sur les peintures, beaucoup d’inscriptions Grecques et Latines : plusieurs
appartiennent à des légionnaires, à de simples soldats, comme on le
voit aussi à Philæ ( i ), à des hommes enfin qui ignoroient leur propre langue, ou
du moins qui n’en savoient pas l’orthographe ; c’est ce qu’on a vu faire de nos
jours par les soldats de l’expédition Française, qui vouloient aussi constater leur
voyage en Egypte. Un certain Januarius s’exprime ainsi, dans une ligne qu’il a
écrite sur les murs de l’un des plus magnifiques tombeaux de Thèbes
J A N V A R I V S V I D I E T M I R A V I L O C O M .
On pourroit citer d’autres barbarismes aussi choquans.
Sur le colosse de Memnon à Thèbes, les Romains ont gravé un grand nombre
d’inscriptions ; j’en ai compté soixante-douze, qui toutes sont tracées par des
personnages plus ou moins distingués de l’Empire, comme des empereurs, des
préfets et des généraux. On en voit une de l’impératrice Sabine, femme d’Adrien.
Il est remarquable que la plupart sont du temps de cet empereur , qui se
montra fort curieux des antiquités et de l’histoire de l’Egypte, et qui y bâtit
une ville. Toutes célèbrent les louanges de Memnon , et attestent qu’ils ont
entendu le son de la statue (2). Aucune de ces inscriptions ne porte la date du
temps des Ptolémées : sans doute, avant les Romains, il n’eût pas été permis de
monter sur le fameux colosse et d’y graver des lettres; ce dont, en effet, on ne
conçoit la possibilité, dans un pays comme l’Egypte, qu’après la chute totale de
la religion et des mystères de l’antiquité (3) : mais de tous ces mystères les em-
péreurs ou les préfets avoient apparemment voulu conserver celui-ci, qui inté-
ressoit le plus la curiosité des voyageurs, et ils avoient trouvé quelques prêtres
encore au fait du mécanisme propre à faire résonner la statue.
Sur la base même du colosse de Memnon , et sur un nilomètre à Éléphantine,
on a, du temps de Septime-Sévère , tracé des inscriptions qui fournissent aujourd’hui
des résultats importans que les Grecs et les Romains n’ont pas prévus; sans
quoi ils auroient multiplié cès inscriptions dans la partie inférieure des édifices.
En effet, on tire de celles-ci des lumières précieuses pour déterminer l’exhaussement
successif de la vallée et du lit du fleuve (4).
Le reste des inscriptions postérieures aux Grecs consiste dans des monumens
de souvenir et de gratitude envers les empereurs ou les gouverneurs du pays,
des autels funéraires et des pierres votives , qu’on trouve à Antinoé, Alexandrie,
Damiette et ailleurs; enfin, des inscriptions chrétiennes dont il a déjà été fait
mention, et qui sont gravées soit sur les monumens, soit dans les cellules des solitaires
de la Thébaïde , cellules qui avoient été de magnifiques sépultures pendant
la splendeur de l’empire Égyptien.
(1) Voye^ la Description dePhilæpar feu Michel-Ange colonne d’Alexandrie, et qu’on la fondoit sur un frag-
Lancret, A . D . chap. pag. p. ment d’obélisque Egyptien, retourné la pointe en bas.
(2) Voye^ la Description de Thèbes*, par MM. Jollois (4) Voye^ le Mémoire de M. Girard sur le Nilomètrè
et Deyilliers. d,’EIéphantine.
( 3 ) C’ est sous ces mêmes' Romains qu’on élevoit la
Inscriptions Grecques du grand Temple de l ’île de Philæ.
D ’a p r è s cet exposé rapide, on voit déjà quelle est l’époque et quel est l’objet
des principales inscriptions que les Grecs et les Romains ont gravées en Egypte
sur les monumens des arts, ou sur des pierres détachées, soit pour un motif de
religion et de reconnoissance envers les dieux et envers les rois, soit pour des
causes particulières. Ces premiers faits mettront le lecteur en état d’asseoir
son jugement sur certaines inscriptions du grand pylône de Philæ; elles sont si
remarquables, qu’elles méritent ici un examen particulier.
Cette île , si riche en monumens, est le point de l’Egypte où l’on voit Je plus
de constructions d’un caractère et d’un âge différens : les travaux des Égyptiens
se distinguent au premier coup-d’ceil par leur couleur et leur grande proportion
; ceux des Romains, des Chrétiens et des Arabes, par leur petitesse, leur
état d’imperfection et leur style. C’est ainsi qu’on Voit un petit arc de triomphe
commencé, et des salles bâties avec des matériaux Égyptiens, dont les sculptures
sont interrompues par des moulures Grecques. Mais il est aussi certaines constructions
de forme Égyptienne, et qu’au premier abord on jugeroit faire partie des
anciens temples : on voit bientôt qu’elles ne sont pas liées avec eux, et que les
époques en sont différentes.
On avoit élevé à Philæ quatre obélisques : deux en granit, et deux en grès,
sans hiéroglyphes ; un de ceux-ci est resté debout. Quand on en approche
on ne tarde pas à reconnoître qu’il n’est pas l’ouvrage des anciens Égyptiens ;
c’est le seul obélisque en grès que l’on connoisse dans ce pays ; sa hauteur étoit
de sept mètres ou vingt-deux pieds seulement. Comment les Égyptiens, au milieu
des carrières de granit, eussent-ils élevé un obélisque en grès, tandis que dans
le Fayoum, à Heliopolis, à Tanis, à deux cents lieues plus loin, ils en érigeoient
qui étoient de granit, et qui avoient plus de soixante pieds de hauteur
On est donc conduit à croire qu’à l’époque de l’érection de ces aiguilles, on
ne considéroit plus les obélisques sous le rapport de l’ordonnance générale de
1 architecture ; mais qu’on y voyoit simplement une décoration, indépendante
de tout système : il est plus que probable qu’on manquoit alors des moyens qui
ont fait elever les obélisques de Thèbes, et de cette puissance à laquelle on doit
les monumens de Philæ, si célèbres par leur ancienneté. Un fait que j’ai observé
en étudiant le grand temple de cette'lle, est de nature à jeter beaucoup de lumière
sur les époques de ces travaux successifs des Égyptiens, des Grecs et des Romains.
C est pendant que je réfléchissois sur des constructions si différentes, que je fiis
frappé de cette observation, opposée, en apparence, avec tout ce que j’avois vu
jusque -là.
Le pylône du grand temple est décoré de figures colossales, sculptées en creux
et placées sur plusieurs rangs. Si vous considérez attentivement le rang inférieur
vous apercevez des inscriptions Grecques tracées négligemment l’une sous l’autre,
en partie efïacees, et dont on ne voit plus que ce qui est entre les fio-ures et
sur les parties lisses de la muraille : mais , comme ces figures sont en relief dans le