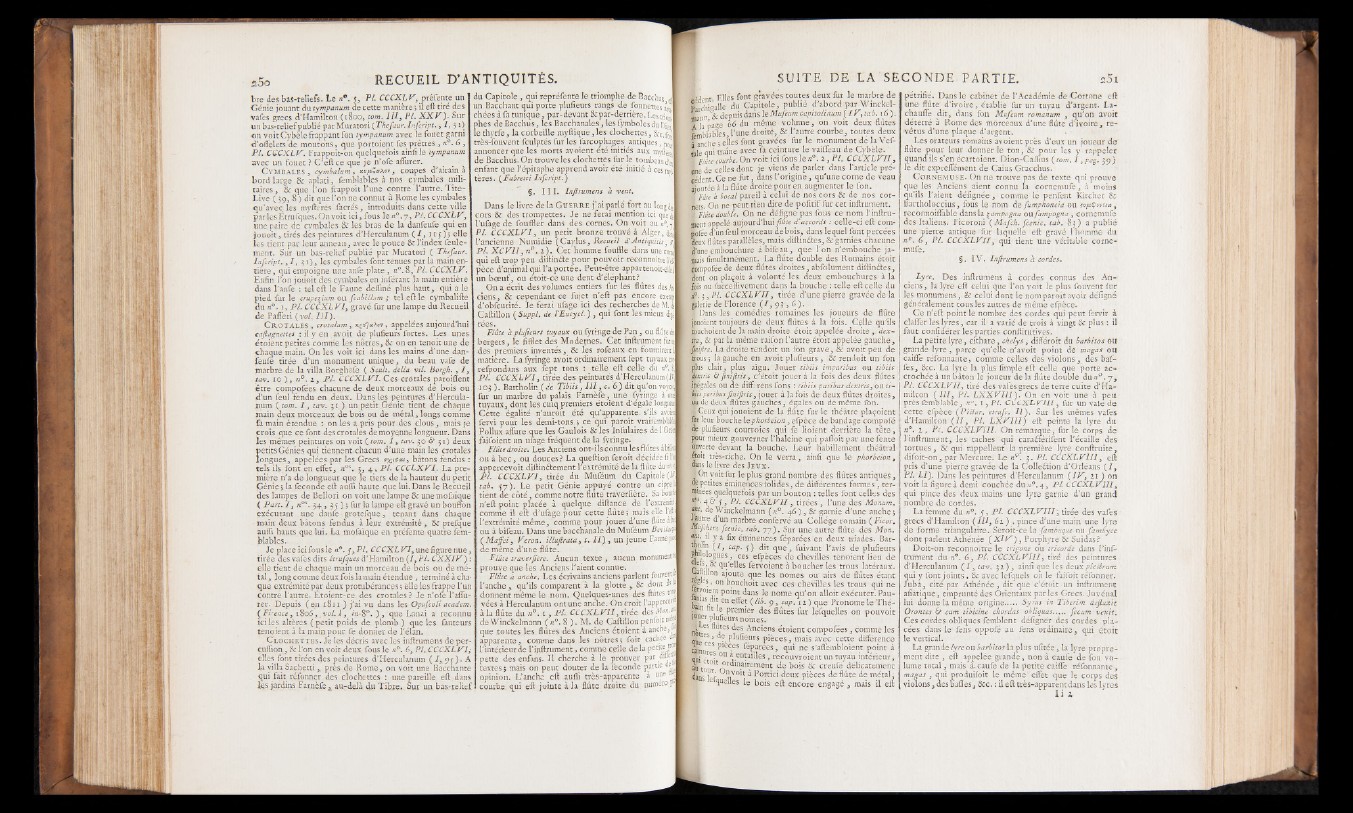
bre des bas-reliefs. Le n®. y, PL CCCXLV, préfente un
Génie jouant du tympanum de cette manière ; il eft tiré des
vafes grecs d’Hamilton (1800, tom. I I I3 PI. X X V ) . Sur
un bas-relief publié par Muratori (Thefaur. Infcript., I, 31)
on voit Cybèle frappant fon tympanum avec le fouet garni
d’oflelets de moutons, que portoient fes prêtres , n°. 6 ,
PI. CCCXLV. Frappoit-on quelquefois ainfï le tympanum
avec un fouet ? C’ eft ce que je n’ofe aflurer.
C ymbales , cymbalum, x.vp&*xov, coupes d’ airain a
bord large & aplati , femblables à nos cymbales militaires,
& que l’on frappoit F une contre l’autre. Tite-
Live ( 39, 8) dit que l’ on ne connut à Rome les cymbales
qu’avec les myfteres facrés, introduits dans cette ville
parles Étrufques. On voit ic i, fous le«0.7 , PI. CCCXLV,
une. paire de cymbales & les bras de la danfeufe qui en
joupit, tirés des peintures d’Herculanum ( I , 115)5 elle
les tient par leur anneau, avec le pouce & l’index feulement.
Sur un bas-relief publié par Muratori ( Thefaur.
Infcrîpt. , 1 , 31), les cymbales font tenues par la main entière
, qui empoigne une anfe plate, «°. 8, PL CCCXLV.
du Capitole, qui repréfente le triomphe de Bacchus 4 I
un Bacchant qui porte plufieurs rangs de fonnettes a l I
chées à fa tunique, par-devant & par-derrière. Les triou! I
ahes de Bacchus, les Bacchanales, les fymbolesduDien I
'ethyrfe, la corbeille myftique,les clochettes, &c,f0J
très-fouvent fculptés fur les farcophages antiques, p01l. I
annoncer que les morts avoient été initiés aux my(fèrç, I
de Bacchus. On trouve les clochettes fur le tombeau d’n I
enfant que l’ épitaphe apprend avoir été initié à ces niyf. I
tères. (Fabretti Infcrîpt.)
Enfin l’on jouoit des cymbales en inférant la main entière
dans l'anfe : tel eft le Faune defliné plus haut, qui a le
pied fur le crupefium ou fcabillum , tel eft le cymbalifte
du n°. 1, PI. CCCXL VI3 gravé fur une lampe du Recueil
de Pafîeri fvol, I I I ) .
C rotales , crotalum, , appelées aujourd’hui
cafta guettes : il y en avoit de pluiieurs fortes. Les unes,
étoient petites comme les nôtres, & on en tenoit une de
chaque main. On les voit ici dans les mains d’une dan-
ifeufe tirée d’un monument unique, du beau vafe de
marbre de la villa Borghèfe ( S cuit, délia vil. Borgk. , 7,
tav. 1 0 ) , «°. 2 , P L CCCXLVI. Ces crdtales paroiflent
être compofées chacune de deux morceaux de bois ou.
d’un feul fendu en deux. Dans les peintures d’Herculanum
(. tom. I , tav. 31 ) un petit Génie tient de chaque
main deux morceaux de bois ou de métal, longs comme
fa main étendue : on les a pris pour,des clous , mais je
crois que ce font des crotales de moyenne longueur. Dans
les mêmes peintures on voit (.tom. I , tav. 30 & 31) deux
petits Génies qui tiennent, chacun d’une main les crotales
longues, appelées par les Grecs bâtons fendus :
tels ils.font en.effet, nqs. _3, 4 , PL CCCLXVI. ,La première
n’a de longueur que le tiers.de la hauteur du petit
Génie ; la fécondé eft aufli haute que lui. Dans le Recueil
des lampes de Bellori on voit unelampe & une mofaïque
( Pan. 7, «os.'3 4,3 5 ) ; fur la lampe eft gravé un bouffon
exécutant une danfe - grqtefque, tenant dans chaque
main deux bâtons fendus, à le,ur extrémité, & prefque.
auffi hauts que lui. La mofaïque en préfente quatre femblables.
...
Je place ici fous le «°. 5, PI. CCCXL VI3 une figure nue ,
tirée des vafes dits étrufques d’Hamilton (/, PL C X X IV ) :
elle tient de chaque main un morceau de bois ou de métal
, long comme deux fois la. main étendue, terminé à chaque
extrémité par deux protubérances ; elle les frappe l’un
contre l'autre. Etoient-ce, des crotales ? Je n’ofe l’ allure
r. Depuis ( en 1811 ) j’ai vu dans les Opufcolt academ.
( Firence,. 1806, vol. I , in-8°. ) , que Lanzi a reconnu
ici les altères-( petit poids de plomb ) que les fauteurs
tenoient à la main pour fe donner de l’élan.
C lochettes. Je les décris avec les inftrumens de per-
çufiïon,, & l'on en voit deux fous le «°. 6, PL CCCXLVlj
elles font tirées des peintures d’Herculanum ( 7, 95). A
la villa Sachetti,, près de Rome, on voit une Bacchante
. qui fajt réfonner des clochettes :. une pareille eft.dans
fes jardins Farnèfe,. au-delà, du Tibre., Sur un bas -relief
§. I I I . Inftrumens a vent.
Dans le livre de la Guerre j’ ai parlé fort au longdej
cors & des trompettes. Je ne ferai mention ici que de
l ’ufagede fouffler dans des cornes. On voit au«0.
PL CCCXLVI, un petit bronze trouvé à Alger, da®
l’ancienne Numidie (Caylus, Recueil d‘Antiquités| y
Pl. X C V I I , «p. 2). Cet homme fouffle dans une corné
qui eft trop peu diftinéle pour pouvoir reconnoître l’ef.
pèce d’animal qui l’a portée. Peut-être appartenoit-ellel
un boeuf, ou étoit-ce une dent d’éléphant?
On a écrit des volumes entiers fur les flûtes des k
ciens, & cependant ce fujet n’ eft pas encore exem»
d’obfcurité. Je ferai ufage ici des recherches de M. è
Caftillon ( Suppl, de lEncyçl. ) , qui font les mieux digérées.
Flûte a plufieurs tuyaux ou fyringe de Pan, ou flûte da
bergers, le fifflet des Modernes . Cet inftrument fut a
des premiers inventés, & les rofeaux en fournirent !
matière. La fyringe avoit ordinairement fept tuyaux coi-
refpondans aux fept tons : telle eft celle du nü. 8,
PL CCCXLVI, tirée des peinturés d’Herculanum(1F,
103 ). Bartholin ( de Tibiis, I I I , c. 6 ) dit qu’on voyoii,
fur un marbre du palais Farnèfe, une fÿringe à oioe
tuyaux, dont les cinq premiers étoient d’ egale longues
Cette égalité n’auroit été qu’apparente, s’ils avoiets
fervi pour les demi-tons 5 ce qui paroît vraifemblabk
PoHux affure que les Gaulois & le s Infulaires de l’Océa
faifoient un ufage fréquent de, la fyringe.
Flûte droite. Les Anciens ont-ils connû tes flûtes àbifesi
ou à b e c , ou douces? La queftion feroit décidée fi T«
appercevoit diftinétement l’extrémité de la flûte du n°.$,
P L CCCXLVI, tirée du Mùféum du Capitole (/F,
tab. 57). Le petit Génie appuyé contre un cippe h
tient de côté, comme notre flûte traverfière. Sa bouche
n’eft point placée. à quelque diftance de l’extremiKi
comme il eft d’ ufage pour cette flûte; mais elle l’eji
l’extrémité même, comme pour jouer d’iine flûte à bec
ou à bifeau. Dans une bacchanale du Muféüm Bevilncf
( Majfei, Véron. . illufirata , t. II.) , un jeune Faune joK
de même d’une flûte..
Flûte traverfière. .Aucun te x te , aucun monuments
prouve que les Anciens l’ aient connue. .
Flûte à anche. Les écrivains anciens partent fouvent*
l’anche qu’ils comparent à la glotte , & dont ils ®
donnent même le nom. Quelquesrunes d.es flûtes trouvées
à Herculanum ont une anche. On croit l’appercev
à la flûte .du n°. 1 , P L CCCXL V I I , tirée des
de Winckelmann ( h°. 8 ) . M.. de Caftillon penfoitro .
que toutes, tes flûtes des Anciens étoient à anche,
apparente, comme dans tes nôtres; foit cachee
l’ intérieur de l’inftrument j comme celle de la Pet^ JL
pette des enfans. Il cherche à 1e prouver par dîner»
textes ; mais on peut douter de la fécondé partie tÊ '
opinion. L’anche eft auffi très-apparente à une
courbe qui eft jointe à.la flûte droite du numéro ”
■ dent. Elles font gravées toutes deux fur 1e marbre de
fl rchigalle du Capitole, publié d’abord par Winckel-
i ainn & depuis dans 1e Mufeum capitolinum ( I V 3 tab. 16 ).
f la page 06 du même volume, on voit deux flûtes
femblables, l’ une droite, l’autre courbe, toutes deux
Manche ; elles font gravées fur le monument dë la'Vef-
| je aui traîne avec fa ceinture 1e vaiffeau de Cybèle.
K Flûte courbe. On voit ici fous le n°. 2, Pl. CCCXLVII
|ne de celtes dont je viens de parler dans l’article précédent.
Ce ne fut, dans l’origine, qu’une corne de veau
fjoutée à la flûte droite pour en augmenter le fon.
■ Fûte a bocal pareil à celui de nos cors & de nos cor-
iecs. On ne peut rien dire de pofitif fur cet inftrument.
Flûte double. On ne défigne pas fous ce nom l’inftru-
lient appelé aujourd’hui flûte d'accords : celle-ci eft com-
Sofée d’un feul morceau de bois, dans lequel font percées
leux flûtes parallèles, mais diftinêtes, & garnies chacune
l’une embouchure à bifeau, que l'on n’embouche ja-
Ëais fimultanément. La flûte double des Romains étoit
eompofée de deux flûtes droites, abfolùment diftinéles,
Ûont on plaçoit à volonté les deux embouchures à la
fois ou fucceffivement dans la bouche : telle eft celle du
b 0 . 3 Pl. CCCXLVII, tirée d’une pierre gravée de la
^lerie de Florence (T , 93, 6).
■ Dans les comédies romaines tes joueurs de flûte
jouoient toujours de deux flûtes à la fois. Cçlle qu’ils
||>uchoient de la main droite étoit appelée droite dex-
tra3 & par la même raifon l’autre étoit appelée gauche, r
Mnifira. La droite rendoit un fon grave, & avoit peu de
-trous ; la gauche en avoit plufieurs , & rendoit un fon
pus clair, plus aigu. Jouer tibiis imparibus ou tibiis
dexcris & finifiris, c’étoit jouer à la fois des deux flûtes
inégales ou de diff: rens fons : tibiis paribus dextris3 ou. tibiis
paribus finifiris, jouer à la fois de deux flûtes droites,
pu de deux flûtes gauches, égales ou de même fon.
■ Ceux qui jouoient de la flûte fur 1e théâtre plaçoient
fur leur bouche 1ephorbeion, efpèce de bandage compofé
de plufieurs courroies qui fe lioient derrière la tê te ,
pour mieux gouverner l’naleine qui paffoit par une fente
i®iverte devant la bouche. Leur habillement théâtral
®toit très-riche. On le verra, ainfi que le phorbeion,
dians le livre des Jeux .
BOn voit fur 1e plus grand nombre des flûtes antiques,
de petites éminences-folides, de différentes formes, terminées
quelquefois par un bouton : telles font celles des
4 & 5? PL CCCXLVII, tirées»,' l ’une des Monum.
dnt. de Winckelmann (n°. 4 6 ) , & garnie d’une anche;
f»tre d’un marbre confervé au Collège romain ( Ficor.
Maf,her& fcenic. tab. 77 ) . Sur une autre flûte des Mon.
il y a fix éminences fépârées en deux triades. Bar-
H?. , j caP- 5) dit que, fuivant l’ avis de plufieurs
lulologues, ces efpèces de chevilles tenoient lieu de
I f t 11^ <^ti e^es ^vo ien t à boucher tes trous latéraux.
T 1. , l°n ajoute que tes nomes ou airs de flûtes étant
p l-e; > on bouchoit avec ces chevilles tes trous qui ne
|ryoient point dans le nome qu’ on alloit exécuter. Pau-
ha? r 'Ï en e^ef ( 9 3 caP - 12.) que Pronome leThé-
K , “ , ® premier des flûtes fur lefquelles on pouvoit
jguer plufieursnomes.
i es ^ tes des Anciens étoient compofées, Comme tes
que ^ ’ ■ ' P^ufle,urs pièces, mais avec cette différence
râinu-65 ^lec,es i®Parees , qui ne s’affembloient point à qui 011^entailles', recouvroient un tuyau intérieur,
auL 01t ordinairement de bois & creufé délicatement
dâncTir ^I},V0i't a Portici deux pièces de flûte de métal,
K 1 el<luelles le bois eft encore engagé , mais il eft
pétrifié. Dans 1e cabinet d'e l’Académie de-Cortone eft
une flûte' d’ ivoire, établie fur un tuyau d’argent. La-
chauffe dit, dans fon Mufeum romanum , qu’on avoit
déterré à Rome des morceaux d’ une flûte d’ivoire, revêtus
d’ une plaque d’ argent.
Les orateurs romains avoient près d’eux un joueur de
flûte pour leur donner le ton, & pour les y • rappeler
quand ils s’ en écartoient. Dïon-Caffius {tom. 1 3pag. 39)
le dit expreffément de Caius Gracchus.
Cornemuse. On ne trouve pas de texte qui prouve
que tes Anciens aient connu la eôrnemufe, à moins
qu’ils l’aient défignée , comme lé penfent Kircher &
Bartholoccius, fous le nom de fumphoneia ou sv^omta t
reconnoiffable dans la \ampogna ou fampogna, cornemüfe
des Italiens. Ficoroni (Mafch. fcenic. tab. 83) a publié
une pierre antique fur laquelle eft gravé l’homme du
n9. 6 , Pl. CCCXLVII3 qui tient une véritable corne-
mufe.
§. IV . Inftrumens et cordes-.
Lyre. Des inftrumens à cordes connus des Anciens,
la lyre eft celui que l’on voit 1e plus fouvent fur
les monumens, & celui dont le nom paroît avoir défigné
généralement tous tes autres de même efpèce.
Ce n’eft point le nombre des cordes-qui peut fervir à
claffer les lyres, car il a varié de trois à vingt & plus : il
faut confiderer tes parties conftitutives.
La petite lyre, cithare, chelys, différoit du barbitos ou
grande lyre, parce qu’elle n’ avoit point dé magas ou
caifïè réfonnante, comme celles des violons, des baffes,
&c. La lyre la plus fimple eft celle que porte ac-*
crôchéeà un bâton 1e joueur de la flûte double du«0. 7 ,
Pl. CCCXLVII, tiré des vafes grecs de terre cuite d’Hamilton
( 111, Pl. L X X V I l l) . On en voit une à peu
près femblable, n°. 1 , Pl. CCCXL VU 1, fur un vafe de
cette efpèce ( Pictur. etrufc. I I ) .. Sur les mêmes vafes
d’Hamilton ( 17, Pl. LX V I1I ) eft peinte la lyre du
n°. 2 , Pt. CCCXLVIII. On remarque,- fur le corps de
rinftrument, les taches qui caraétérifent l’ écaille des
tortues, & qui rappellent la première lyre conftruite,
difoit-on, par Mercure; Le «0. 3. Pl. CCCXLVIII, eft
pris d’ une pierre gravée de la Collection d’Orléans ( 7,
Pl. L l). Dans les peintures d'Herculanum ( IV , 21 ) on
voit la figure à demi couchée du «°. 4 , PL CCCXLVIII,
qui pincé des deux mains-une lyre garnie d’un grand
nombre de cordes.
La femme du ra0. 5, PL CCCXLVIII', tirée dés vafes
grecs d’Hamilton ( 71/, 62 ) , pince d’une main une lyre
de forme triangulaire. Seroit-Ce la fambuque ou fambyce
dont partent Athénée ( X IV ) , Porphyre & Suidas?
Doit-On reconnoître le trigone ou tricorde dans l’inf-
trumént du «°. 6 , PL CCCXLVIII, tiré des peintures
d’Herculanum ( 7, tav. 3 2 ) , ainfi que tes deuxplectrunz
qui y font joints, & avec lêfquels on 1e faifoit réfonner.
Jubà, cité par Athénée, dit que c’étoit un inftrument
afiâtique, emprunté des Orientaux parles Grecs. Juvénal
lui donne la même origine..... Syrus in Tiberim defluxit
Orontès & cum tibicine ckordas obliquas..... fecum vexit.
Ces cordes obliques femblent défignër des cordes placées
dans le; fens oppofé au fens ordinaire, qui étoit
le vertical.
La grande lyre ou barbitos la plus ufitée, la lyre proprement
dite , eft appelée, grande, non à caufe de fon volume
total, mais à-caufe de la petite caiffe réfonnante-,
magas , qui produifoit le même'effet que 1e corps des
violons, des Baffes, &c. : il eft très-apparent dans tes lyres
li 2.