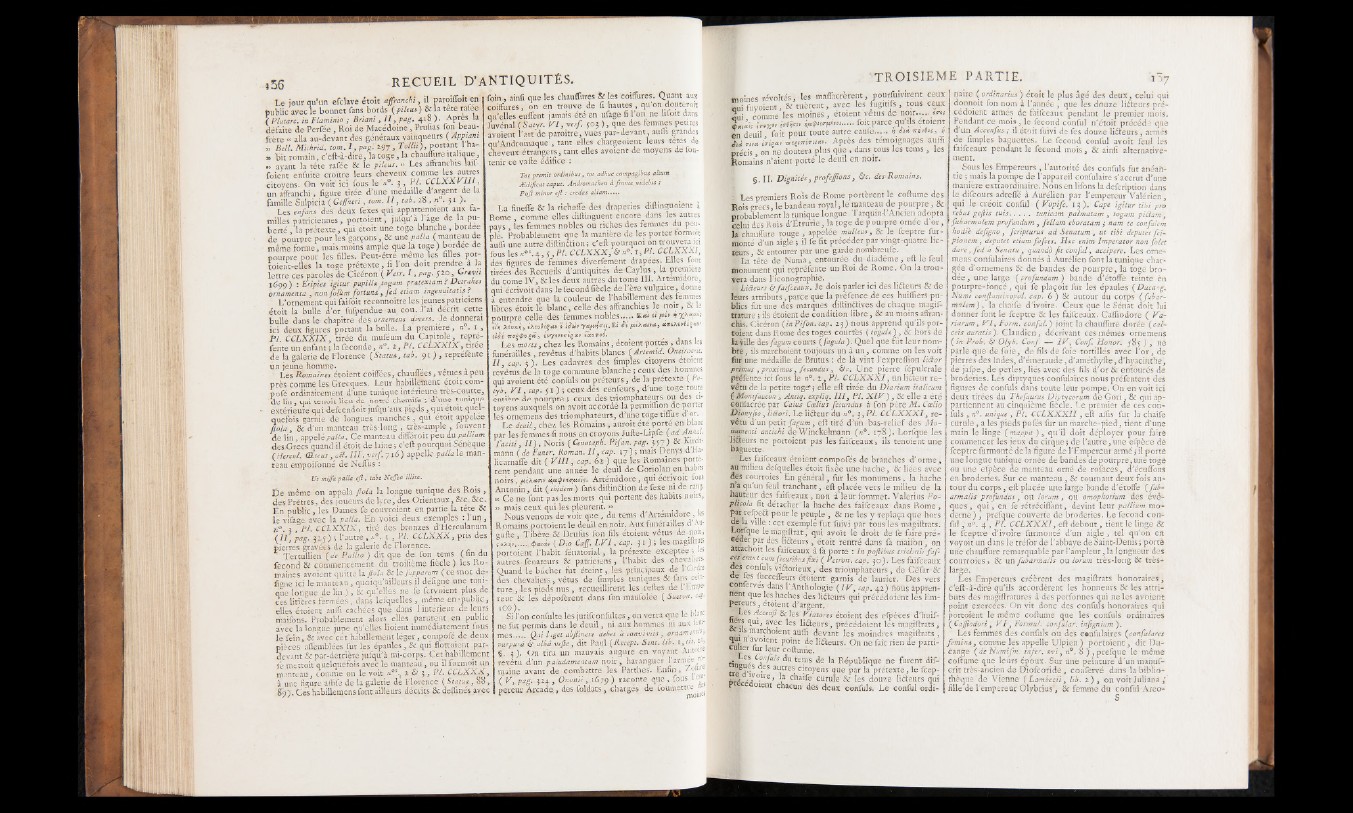
RECUEIL D’ANTIQUITÉS. j 36
Le jour qu’un efclave étoit affranchi, il paroiflbit en
public avec le bonnet fans bords ( pileus ) & la tete rafee
( Plutarc. in Fiaminio ; Briani , 11, pag. 418 ) . Après la
défaite de Perfée , Roi de Macédoine, Prufias fon beau-
frère « alla au-devant des généraux vainqueurs ( Appiani
„ Bell. Mithrid. iom. 1, pag'. 297, Tollii) , portant 1 ha-
as tfit romain, c’eft-à-dire, la toge , la chauflure italique 3
„ ayant la tête rafée & le pileus. » Les affranchis laif-
foient enfuite croître leurs cheveux comme les autres
citoyens. On voit ici fous le n°. 3, P/. CCLXX VU l ,
un affranchi, figure tirée d’une médaille d argent de la
famille Sulpicia ( Gejfieri, tant. U , tab. 28, n°. 31 ).
Les enfans des deux fexes qui appartenoient aux familles
patriciennes, portoient, jufqu’ a 1 âge de la puberté
, la prétexte, qui étoit une toge blanche, bordee '
de pourpre pour les garçons, & une palla ( manteau de
même forme, mais.moins ample que la toge) bordee de
pourpre pour les filles. Peut-être même les hiles por-
toient-elles la toge prétexte, fi l'on doit prendre a la
lettre ces paroles de Cicéron {Verr. I , pag. 510 ,Gr *vu
: Eripies igitur pupille(togam pritextam f Detrahes
ornamenta , non folumfortuné. , fed etiam ingenuitati? ?
L’ornement qui fâifoit reconnoître les jeunes patriciens
étoit la bulle d’or fufpendùe-au cou. J’ ai décrit cette
bulle dans le chapitre des ornemens divers. Je donnerai
ici deux figures portant la bulle. La première 3 n . i 3
PI. CCLXXIX, tirée du muféum du Capitole , repre-
fente un enfant; la fécondé, n°. 2, Pi. CCLXXIX »tirée
de la galerie de Florence {Statue, tab. 91 ) , reprefente
un jeune homme. g A v
foin, ainfi que les chauffures & les coiffures. Quant aux
coiffures, on en trouve de fi hautes, qu'on douteroit
qu’elles euflent jamais été en ufage fi l’on ne lifoit dans
juvénal ( Satyr. V I 3 verf. 303 ) , que des femmes petites ;
avoient l’art de paroître, vues par-devant, auffi grandes
qu’Andromaque.j tant elles chargement leurs têtes de |
cheveux étrangers, tant elles avoient de moyens dé fou-
tenir ce vafte édifice :
Les Romaines étoient coiffées, chauffes, vetues a peu
près comme les Grecques. Leur habillétnent étoit çom-
pofé ordinairement d’ une tunique intérieure très-courte,
de lin, qui tenoit lieu de notre chemife_> dune tunique,
extérieure qui defcendoit jufqu’aux piçds, qui étoit quelquefois
garnie de longues, manches, qui etoit appelée
fiola, & d’un manteau très-long , très-ample, fouvent
de lin, appelé palla. Ce manteau differoit peu du pallium
d é s iré e s quand il étoit de laine ; c-eft pourquoi Sénèque
(Hercul. GLceus, ccî. IIF, verf. 7 16 ) appelle palla le manteau
empoifonné de Nefliis :
Ut mijfa palla .eft, tabt Nefea illita.
De même on appela fiola la longue tunique des R o is ,
des Prêtres, des joueurs de lyre, des Orientaux, &c. & c.
En public, lés Dames fe couvroient en partie la tête &
le vifage avec la palla, En. voici deux exemples : l’un,
p<> . f p i ' CCLXXIX, .tiré des bronzes d’Herculanum
{ I I , pag. 32J) 5 l’autre,.a°. 1 , PL CCLXXX, pris des
pierres gravées de la galerie de Florence. .
• Tertullien'(ae Palho ) dit que de fon tems (fin du
fécond & commencement du troifième fièclef les Re-
maïnes avoient quitté la fiola & le j'upparum ( ce; mot de-
figne ici le manteau , quoiqu’âilleurs il défigne une tunique
longue de lin.) , & qu’elles ne fe ferypient plus de.
ces litières fermées , dans lefquelles_, meme en •public ,
elles étoient auffi cachées que dans 1 intérieur de leurs
maifons. Probablement alors, elles parurent en public'
avec la longue jupe qu’elles lioient immédiatement fous
le fein, & avec cet habillement léger, compofé de deux
pièces aflèmblées fur les épaules , & qui flottoient .par-
devant & par-derrière jufqu’ à mi-corps. Cet: habillement
le mettoit quelquefois avec le manteau, ou il fonmo'it.un
manteau, comme on le voit nos., 2 & 3 , PL CCLXXX,
à une figure aflîfe de la galerie de Florence ( Statua, 88,
89). Ces habilleraens font ailleurs décrits 8c deffinés avec
Tôt premit ordinibus, tôt- adhuc compagibus altum
Ædificat cap ut. Andromachen à fronuvidebis ; ,
Pofi minor efi : -credas aliam.....
La fineffe & la richsffe des draperies diftinguoient à
Rome, comme elles diftinguent encore dans les autres j
pays, les femmes nobles ou riches des femmes du peu- jl
pie. Probablement que la manière de les porter formoit
auffi une autre diftinétion; c’eft pourquoi on trouvera ici
fous les nos.4 , 5 3 PL CCLXXX, & n°. i , PL CCLXXXI,
des figures de femmes diverfement drapées. Elles font |
tirées des Recueils d’antiquités de Caylus , la première |
du tome IV , & le s deux autres du tome III. Artemidore, |
qui écrivoit dans le fécond fiècle de l’ère vulgaire, donne I
1. à entendre que la couleur de l’habillement dés femmes j
libres étoit le blanc, celle des affranchies le noir, &le
pourpre celle -des femmes nobles....* ei^e» ? XM44"5
uy Xtoxij, tteuÉtÇctv 0 iê'àv yapyo-u. E< S'i ftXatia, eiirttoollîçuv j
tiM iroçtpuçét, toytitrtgM iitoroo.
Les -morts, chez les Romains, étoient portés, dans les
funérailles ».revêtus d’habits blancs CArtemid. Oneirocnt.
I l , cap. 3 ) , Les cadavres des fimples citoyens etoient
revêtus .de.la toge commune blanche; ceux des hommes j
qui avoient été confuls ou préteurs, de la pretexte ( Po-
lyb. V I , cap. 5 1 ) ; ceux des cenfeurs, d’une toge toute
entière de pourpre ; ceux des triomphateurs ou des-citoyens
auxquels on avoir accordé la permiffion de porter
les ornemens. des. triomphateurs, d’ une toge tiffue d or.
Le deuil, chez les Romains,. auroit été porté en-blanc
par les femmes fi nous en croyons Jufte-Lip.fe {ad Annal,
l'aciti, I I ) , Noris ( Cenotaph. Pifan. pag. ^ 7 } & '
mann ( de Faner. Roman. I l , cap.-17 ) î rnais Denys d Ha-
licarnaffe dit ( V I I I , cap. 6z ) que les Romaines portèrent
pendant une année le deuil de Coriolan en habits
noirs, ftiXetm rfiois. Aftémrdorë, qui écrivoit fous I
Antpnin, dit ( ibidem ) fans diftinétion de fexe ni de rang. I
« Ce ne font pas les morts qui portent des habits noirs, |
» mais ,ceux qui les pleurent. » ■ ‘j ' . I
Nous venons de voir qu e , du tems d’ Artemidore;, les I
Romains portoient le deuil en,noir. Aux funérailles d’Au*
eufte -, Tibère & Drufus fon fils étoient vêtus dé noir,
loziy.....,<p*'ù> { Dio Cajf. L V I , cap. 31 ) ; les magiftrats
portoient l’habit fénatorial-, la prétexte exceptée ; ’es ;
autres-.fénateurs & patriciens f l’habit des chevaliers- >
Quand le bûcher fut éteint,. les principaux de l’Ordrej
des chevaliers, vêtus de fimples tuniques & fans ceinture.,
les pieds nus, recueillirent les ,relies de l’Empereur
& les dépofèrent .dans fon maufolée ( Suetoa. e#
ico ) . ’ ' ; i *' • ,
Si l’on confulte les jurifcon.fultes, on verra que le b.anc
ne fut permis dans le deuil, ni. aux hommes ni aux Et- ;
mes...... Qui liget abflirure debet a conviviis, ornamentn,
purpura & albâ vefie , dit Paul {Recept. Sent. lib,. t, tit. lh
§ . 3 )'. ,(;n tira un mauvais augure en voyant Antoine j
revêtu d’un paludamentum noir, haranguer 1 armée ro
maine avant de combattre les Parthes’. Enfin, Zof»®®
{ V , pag. 3 14, Or.oniï ,.,1679 ) raconte que, fous l em‘
pereur Arcade., des foldats, chargés de foumettte de
TROISIEME PARTIE.
moines révoltés, les maffaerkent, pourfmvirent ceux
oui fuyoient, & tuèrent, avec les fugitifs, tous ceux
oui, comme les moines, étoient vêtus de noir.....
Ciatuts £tv%ov ÿft<pie<rftevoi..... foit parce qu ils etoient
en deuil, foit pour toute autre caufe....^ W m g ^ f g g
hei riva tTsçav ■ srtçtntTiioiv. Après des témoignages auffi
précis, on ne doutera plus que . dans tous les tems, les
Romains n’aient porté le deuil en noir.
§. II. Dignités, profejfions, &c. des'Romains.
■ Les premiers Rois de Rome portèrent le coftume des.Rois grecs, le bandeau royal,le manteau de pourpre, &
probablement la tunique longue Tarquin-1’Ancien adopta
celui des Rois d’Étrurie, la toge de pourpre ornee d’or,
la chauffure rouge, appelée mulleus-, 8c le feeptre fur-
monté d’un aigle ; il fe fit précéder par vingt-quatre lie-
leurs, & entourer par une garde nombreufe.
|§La tête de Numa, entourée du diadème, e ftlefeu l
trionument qui repréfente un Roi de Rome. On la trouvera
dans i’iconographie. . . ..
■ LiSeurs & faifceaüx. Je dois parler ici des liéteurs & de
leurs attributs, parce que la préfence de ce s huifliers publics
fut une des marques diftinétives de chaque magif-
frature ; ils étoient de condition libre, & au moins affranchis.
Cicéron {in Pifon. cap. 23 ) nous apprend qu’ils portaient
dans Rome des toges courtes ( toguls) , 8c hors de
la: ville des fagum courts {fagula). Quel que fut leur nombre
, ils marchoient toujours un à un, comme on les voit
fur une médaille de Bfutus : de là vint l ’expreffion liëtor
primas, proximus, fecundus, &c. Une pierre fépulcrale
pféfente ici fous le «°. 2, PL CCLX X X I, un licteur revêtu
de la petite togef; elle eft tirée du Diarbum italicum
f iMontfaucon , Antiq. expliq. I I I , PL X IV ) , & elle a été
cdnfacrée par Caius Coelius fecundus à fon père M. Coelio
Dionyfio, liotori. Le liéteur du n°. 3, PL C C LX X X I, revêtu
d’un petit fagum , eft tiré d’un bas-relief des Mo-
nyfiientl antichi de Winckelmanm ( 1 7 8 ).-Lorfque les
liseurs ne portoient pas les faifceaüx, ils tenoient une
baiguette.
au milieu aeiquelies etoit hxee une hache, & liees avec
des courroies. En général, fur lés monumens , la hache
n’a qu’un feul tranchant, eft placée vers le milieu de la
hauteur des faifceaüx, non à leur fommet. Valeritis Po-
plicola fit détacher la haché des faifceaüx dans Rome,
par refpeft pour le peuple , & ne les y replaça que hors
de la ville : cet exemple fut fuivi pair tous*les magiftrats.
Lorfque le magiftrat, qui avoit le droit de fè faire pré-
Éeder par des liéteurs, étoit rentré dans fa maifôn, on
attachoit les faifceaüx à fa porte : In pofi'ibus triclinii faf-
ces erant cum fecurîbus fixi ( Pctrbn. cap. 30).- Les faifceaüx
des confins vidorieux, des triomphateurs ^ de Cefar &
de les fuccefleurs étoient garnis de laurier. Des-vers
cgnferves dans l’Anthologie { IV , cap. 42) hoüs apprennent
que les haches des liéteurs qui précédoiènt les Em-
pereurs , etoient d’argent.
raLes ^ccenfi & les Viatores étoient des efpèees d’huif-
i p f ^ve.c les liéteurs, précédoiènt les magiftrats ,
3 s marchoient auffi devant les moindres magiftrats ,
qui n avoient point de liéteurs. On ne fait rien de parti-
cuüer fur leur coftume.
Les Confis du tems de la République ne furent dif-
- s aiîtres citoyens que par la prétexte, le feep-
nr4 Avo.lreh chaife curule & les douze liéteurs qui
‘‘mm, ÛOient chacun des deux confuls. Lé conful ordinaire
( ordir.arius ) étoit le plus âgé des deux, celui qui
donnoit fon nom à l’année, que les douze liéteurs pré-
cédoient armés de faifceaüx pendant le premier mois.
Pendant ce mois, le fecond conful n’étoit précédé que
d un Accenfus ; il étoit fuivi de fes douze liéteurs , armés
de fimples baguettes. Le fécond conful avoit feul les
faifceaüx pendant le fécond mois, & ainfi alternative-
. ment.
. Sous les Empereurs , l ’autorité des confuls fut abéah-
. tie ; mais la pompe de l ’appareil confulaire s’ accrut d’ une
manière extraordinaire. Nous en lifons la defeription dans
.
le difeours adreffé à Aurélie n par l’empereur Valérien
qui le créoit conful ( Vopifc. 15 ) . Cape igitur tibi pro
rebus geftis tuis..........tunicam palmatam , togam piclam,
fubàrmalem profundum , fellam eboratam ; nam te confulem
] kodi'e defigno , feripturus ad Senatum , ut tibi deputet fei*
pionem , deputet etiam fafees. H&c enim Imperator non folet
dare, fed h Senatu , quandb fit Conful, accipere. Les ornemens
confulaires donnés à Aurélien font la tunique chargée
d’ ornemens & de bandes de pourpre, la toge brodée
, une large ( profundum ) bande a’ étoffe teinte èn
pourpre-foncé, qui fe plaçoit fur les épaules {Ducang.
Numi conftantinopol. cap. 6 ) & autour au corps (fubar-
mttlem) , la chaife d’ivoire. Ceux que le Sénat doit lui
donner font le feeptre & les faifceaüx. Cafliodore ( Va-
riarum, V I , Form. conful. ) joint la chauflure dorée {cal-
ceis auratis ). Claudien, décrivant ces mêmes ornemens
{in Pro b. & Olyb. Conf. — IV , Conf Honpr. y8y ) , nè
parle que de foie, de fils de foie tortillés avec l ’o r , de
pierres des Indes, d’émeraude, d’améthyfte, d’hyacinthe,
de jafpe, de perles, liés avec des fils d’ or & entourés de
broderies. Les diptyques-confulaires nous préfentent des
figures de confuls dans toute leur pompe. On en voit ici
deux tirées du Thefaurus Diptycorum de G ori, & qui appartiennent
au cinquième fiècle. Le premier de ces confuls
, n°. unique, PL CCLX X X IÏ, eft affis fur la chaife
curule, a les pieds pofos fur un marche-pied, tient d’une
main le linge {mappa ) , qu’il doit déployer pour faire
commencer les jeux du cirque; de l’autre,une efpèce dé
feeptre furmonté de là figure de l’Empereur armé ; il porté
une longue tunique ornée de bandes de pourpre, une toge
ou une efpèce de manteau orné de rofaces, d’écuflons
en broderies. Sur ce manteau, & tournant deux fois autour
du corps, eft placée une large bande d’étoffe ( fub-
armalis profiindus -, ou lorum, pu omophorium des évêques
, qui, en fe rétréciflant, devint leur pallium moderne
) , préfque couverte de broderies. Le fécond conful
,' n°. 4 , PI. CCLXXXI, eft debout, tient le linge &
le feeptre d’ivoire ftirmonté d’un aigle, tel qu’on en
voyoit un dans le tréfor de l’abbaye de Saint-Denis ; porté
une chauflure remarquable par l’ampleur, la longueur des
courroies, & un fub arm ails ou lorum très-long & très-
large. 5 •
Les Empereurs créèrent des magiftrats honoraires ,
c ’eft-à-dire qu’ils accordèrent les honneurs & les attributs
des-magiftratures à des perfonnes qui ne les avoient
point exercées. Oh vit donc des confuls honoraires qui
portoient le même coftume que lés confuls ordinaires
{Cajfiodori, V I , Formai.' confular. infignium).
Les femmes des confuls ou des confulaires {confulares
fe-mbui, comme les appelle Ulpién) portoient, dit Du-
cange {de Numifini, infer. &vi, n°. 8 ) , prefque le même
coftume que leurs époux. Sur une peinture d ’un manuf-
crit très-ancien de Diofcoride, confervé dans la bibliothèque’de
Vienne ( Lambe'cii, lib. 2 ) , on voit Julian a
fille de l’empereur Olybrius, & femme du conful Areo-
/I