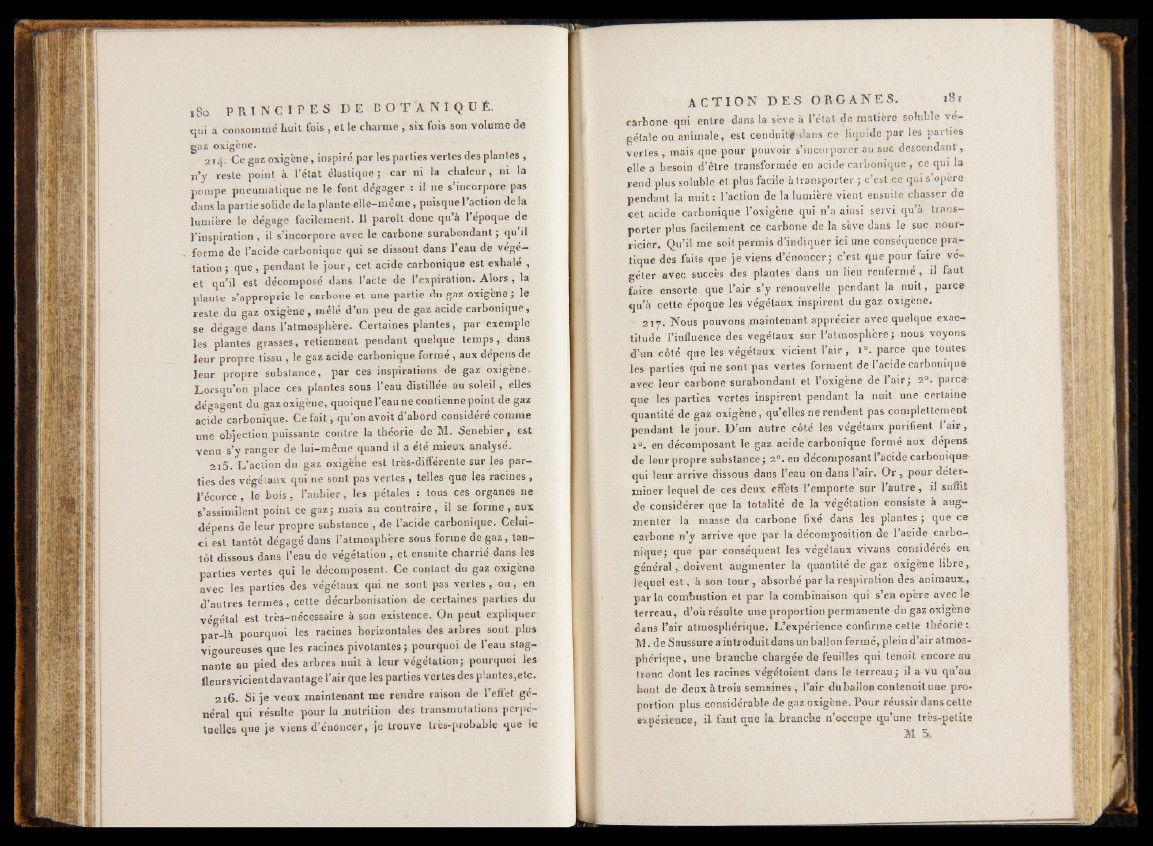
,So P R I N C I P E S DE B O T A N I Q U É .
<jui a c o n s om m é huit fois , et le charme , six fois son volume de
gaz2 1o4x.i gCèen eg.az oxigène, inspiré par les parties vertes des plantes ,
n’y reste point à l’état élastique; car ni la chaleur, ni la
pompe pneumatique ne le font dégager : il ne s’incorpore pas
dans la partie solide de la plante elle-meme, puisque 1 action de la
lumière le dégage facilement. Il paroît donc qu’à 1 époque de
l’inspiration , il s’incorpore avec le carbone surabondant ; qu il
forme de l’acide carbonique qui se dissout dans l’eau de végétation
; que , pendant le jour, cet acide carbonique est exhale ,
et qu’il est décomposé dans l’acte de l’expiration. Alors , la
plante s’approprie le carbone et une partie du gaz oxigène ; le
reste du gaz oxigène, mêlé d’un peu de gaz acide carbonique,
se dégage dans l’atmosphère. Certaines plantes, par exemple
les plantes grasses, retiennent pendant quelque temps, dans
leur propre tissu , le gaz acide carbonique formé , aux dépens de
leur propre substance, par ces inspirations de gaz oxigène.
Lorsqu’on place ces plantes sous 1 eau distillée au soleil, elles
dégagent du gaz oxigène, quoique l’eau ne contienne point de gaz
acide carbonique. Ce fait, qu’on avoit d’abord considéré comme
une objection puissante coutre la théorie de M. Senebier, est
venu s’y ranger de lui-même quand il a été mieux analysé.
2i5. L’action du gaz oxigène est très-différente sur jes parties
des végétaux qui ne sont pas vertes , telles que les racines ,
l’écorce , le bois, l’aubier, les pétales : tous ces organes ne
s’assimilent point ce gaz; mais au contraire, il se forme , aux
dépens de leur propre substance , de l’acide carbonique. Celui-
ci est tantôt dégagé dans l’atmosphère sous forme de gaz, tantôt
dissous dans l’eau de végétation , et ensuite charrié dans les
parties vertes qui le décomposent. Ce contact du gaz oxigène
avec les parties des végétaux qui ne sont pas vertes , ou , en
d’autres termes, cette decarbomsation de certaines parties du
végétal est très-nécessaire à son existence. On peut expliquer
par-là pourquoi les racines horizontales des arbres sont plus
vigoureuses que les racines pivotantes ; pourquoi de l’eau stagnante
au pied des arbres nuit à leur végétation; pourquoi les
fleurs vicient davantage l’air que les parties vertes des plantes,etc.
216. Si je veux maintenant me rendre raison de l’effet général
qui résulte pour la .nutrition des transmutations perpétuelles
que je viens d’énoncer, je trouve très-probable que le
carbone qui entre dans la sève à l’état de matière soluble végétale
ou animale, est conduite dans ce liquide par les parties
vertes , mais que pour pouvoir s’incorporer au suc descendant,
elle a besoin d’être transformée en acide carbonique, ce qui la
rend plus soluble et plus facile à transporter ; c’est ce qui s’opère
pendant la nuit : l’action de la lumière vient ensuite chasser de
cet acide carbonique l’oxigène qui n’a ainsi servi qu’à transporter
plus facilement ce carbone de la sève dans le suc nourricier.
Qu’il me soit permis d’indiquer ici une conséquence pratique
des faits que je viens d’énoncer; c’est que pour faire végéter
avec succès des plantes dans un lieu renfermé , il faut
faire ensorte que l’air s’y renouvelle pendant la nuit, parce
qu’à cette époque les végétaux inspirent du gaz oxigène.
217. Nous pouvons piainlenant apprécier avec quelque exactitude
l’influence des végétaux sur l’atmosphère; nous voyons
d’un côté que les végétaux vicient l’air , i°. parce que toutes
les parties qui ne sont pas vertes forment de l’acide carbonique
avec leur carbone surabondant et l’oxigène de l’air; 20. parce
que les parties vertes inspirent pendant la nuit une certaine
quantité de gaz oxigène, qu’elles ne rendent pas complettement
pendant le jour. D’un autre côté les végétaux purifient l’air ,
i°. en décomposant le gaz acide carbonique formé aux dépens
de leurpropre substance; 20. en décomposant l’acide carbonique
qui leur arrive dissous dans l’eau ou dans l’air. Or , pour déterminer
lequel de ces deux effets l’emporte sur 1 autre, il suffit
de considérer que la totalité de la végétation consiste à augmenter
la masse du carbone fixé dans les plantes ; que ce
carbone n’y arrive que par la décomposition de l’aeide carbonique;
que par conséquent les végétaux vivans considérés en
général, doivent augmenter la quantité de gaz oxigène libre,
lequel est, à son tour, absorbé par la respiration des animaux.,
parla combustion et par la combinaison qui s’en opère avec le
terreau, d’où résulte une proportion permanente du gaz oxigène
dans l’air atmosphérique. L’expérience confirme cette théorie i
M. de Saussure a introduit dans un ballon fermé, plein d’air atmosphérique,
une branche chargée de feuilles qui tenoit encore au
tronc dont les racines végétoient dans le terreau; il a vu qu’au
bout de deux à trois semaines, l’air du ballon contenoit une proportion
plus considérable de gaz oxigène. Pour réussir dans cette
«xnérience, il faut que la branche n’occupe qu’une très-petite
M 54