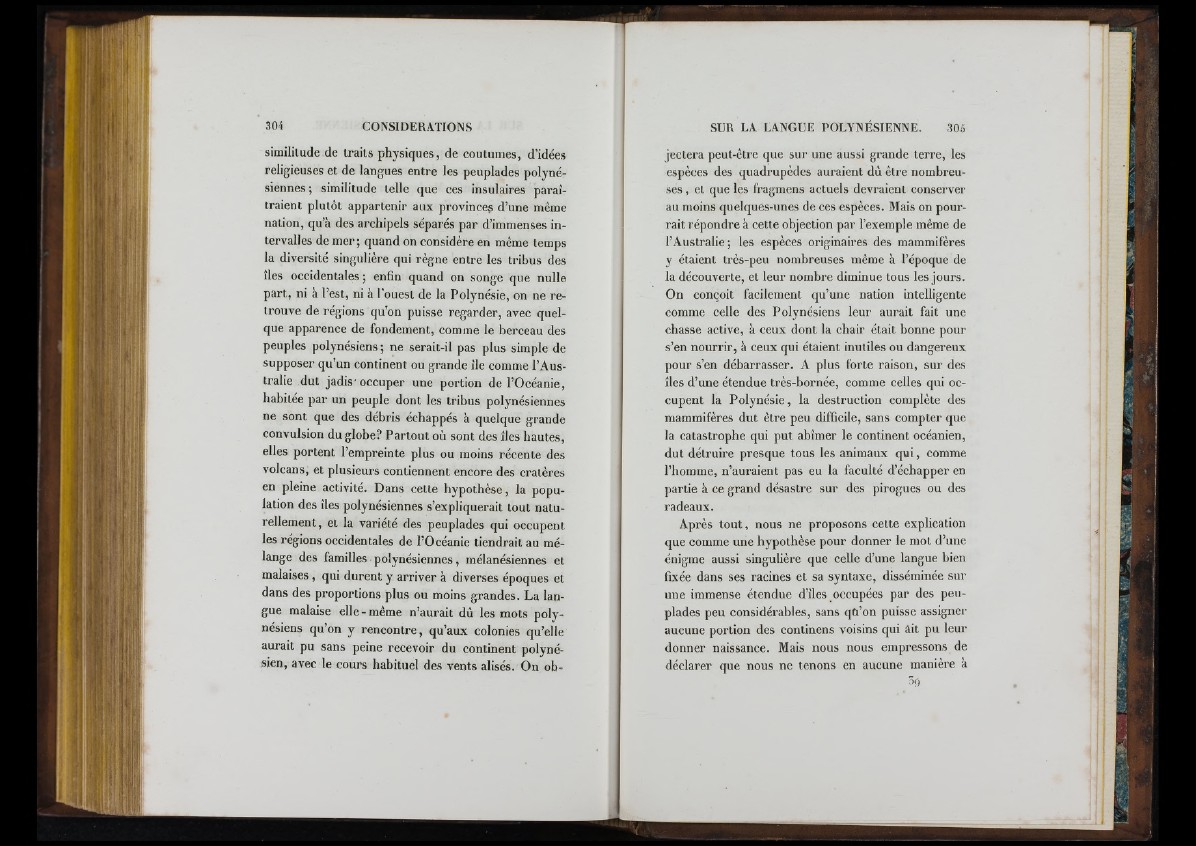
I,
J «
similitude de trails physiques, de coutumes, d’idées
religieuses et de langues entre les peuplades polynésiennes
; similitude lelle que ces insulaires parai-
traient plutôt appartenir aux provinces d’une même
nation, qu’à des archipels séparés par d’immenses intervalles
de mer; quand on considère en même temps
la diversité singulière qui règne entre les tribus des
îles occidentales ; enfin quand on songe que nulle
part, ni a l’est, ni à l'ouest de la Polynésie, on ne retrouve
de régions qu’on puisse regarder, avec quelque
apparence de fondement, comme le berceau des
peuples polynésiens ; ne serait-il pas plus simple de
supposer qu’un continent ou grande île comme l’Australie
dut jadis'occuper une portion de l’Océanie,
habitée par un peuple dont les tribus polynésiennes
ne sont que des débris échappés à quelque grande
convulsion du globe? Partout où sont des îles hautes,
elles portent l’empreinte plus ou moins récente des
volcans, et plusieurs contiennent encore des cratères
en pleine activité. Dans celle hypothèse, la population
des îles polynésiennes s’expliquerait tout naturellement,
et la variété des peuplades qui occupent
les régions occidentales de î’Océanie tiendrait au mélange
des familles polynésiennes, mélanésiennes et
malaises, qui durent y arriver à diverses époques et
dans des proportions plus ou moins grandes. La langue
malaise elle-même n’aurait dù les mots polynésiens
qu’on y rencontre, qu’aux colonies qu’elle
aurait pu sans peine recevoir du continent polynésien,
avec le cours habituel des vents alisés. On objectera
peut-être que sur une aussi grande terre, les
espèces des quadrupèdes auraient dù être nombreuses
, el que les fragmens actuels devraient conserver
au moins quelques-unes de ces espèces. Mais on pourrait
répondre à cette objection par l’exemple même de
l’Australie; les espèces originaires des mammifères
y étaient très-peu nombreuses même à l’époque de
la découverte, et leur nombre diminue tous les jours.
On conçoit facilement qu’une nation intelligente
comme celle des Polynésiens leur aurait fait une
chasse active, à ceux dont la chair était bonne pour
s’en nourrir, à ceux qui étaient inutiles ou dangereux
pour s’en débarrasser. A plus forte raison, sur des
îles d’une étendue très-bornée, comme celles qui occupent
la Polynésie, la destruction complète des
mammifères dut être peu difficile, sans compter que
la catastrophe qui put abîmer le continent océanien,
dut détruire presque tous les animaux qui, comme
l’homme, n’auraient pas eu la faculté d’échapper en
partie à ce grand désastre sur des pirogues ou des
radeaux.
Après tout, nous ne proposons celte explication
que comme une hypothèse pour donner le mot d’une
énigme aussi singulière que celle d’une langue bien
fixée dans ses racines et sa syntaxe, disséminée sur
une immense étendue d’iles occupées par des peuplades
peu considérables, sans qa’on puisse assigner
aucune portion des continens voisins qui ait pu leur
donner naissance. Mais nous nous empressons de
déclarer que nous ne tenons en aucune manière à